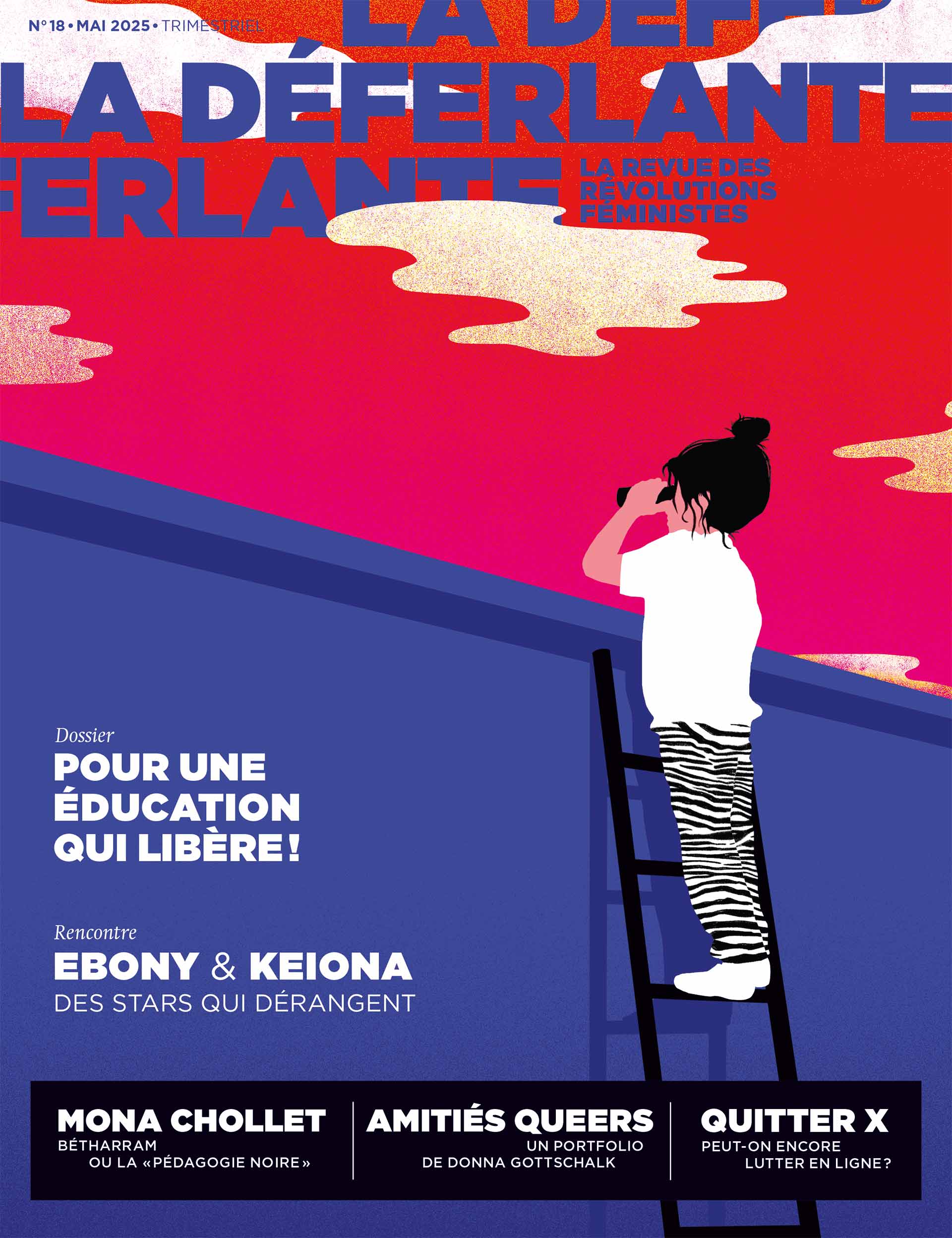Le 27 novembre 2024, Laure Chabaud, avocate générale dans le procès des violeurs de Mazan, concluait son réquisitoire à l’adresse du jury : « Par votre verdict, vous nous guiderez dans l’éducation de nos fils car, au-delà de la justice, c’est dans l’éducation que devra se faire le changement pour qu’il s’inscrive dans la durée. »
Collée sur un mur du boulevard Voltaire, à Paris, le 23 novembre 2019 lors de la marche nationale contre les violences sexistes et sexuelles organisée par le collectif #NousToutes, l’apostrophe « Éduquez vos fils pour protéger vos filles » est retravaillée par la graphiste belge Aude Gaspar. En janvier 2020, elle publie sur sa page Instagram le post : « Protégez vos filles, éduquez vos fils ». En récoltant plus de 100 000 likes, elle permet au slogan de devenir viral et de matérialiser le basculement féministe à la fin des années 2010.
À la même époque, au Chili, le collectif Las Tesis danse sur des paroles sans équivoque – « Ce n’est pas ma faute, quoi que je porte, où que je sois. Le violeur, c’est toi » –, tandis que la France découvre l’existence d’une foule de militantes, armées de brosses et de seaux de colle, qui recouvrent les murs des villes et des villages des noms des victimes de violences sexuelles et de féminicides. Matérialisant leur ampleur, ces collages accompagnent le changement de regard sur les auteurs de ces violences. Le fantasme du loup solitaire en quête de proies s’effondre. Sur le plateau de Mediapart, la comédienne Adèle Haenel accuse le réalisateur Christophe Ruggia 1Christophe Ruggia a été condamné le 3 février 2025 à quatre ans de prison dont deux ferme avec bracelet électronique pour agression sexuelle sur mineure. Il a fait appel de cette décision. de l’avoir agressée sexuellement entre ses 12 et ses 15 ans : « Les monstres n’existent pas, affirme-t-elle. […] C’est notre société, c’est nous, c’est nos pères. »
Pensé par des militantes féministes pour exprimer le rejet radical de la culpabilisation des femmes victimes, en même temps que la banalité des violences, le slogan « Éduquez vos fils ! » sonne aux oreilles de certaines comme une nouvelle injonction. « Encore une fois, c’est à nous de tout faire. Toujours. On est responsables de tout », s’agace Aliénor, quatre enfants, interviewée par la journaliste Aurélia Blanc dans son livre Tu seras une mère féministe ! (Marabout, 2022). Au micro de la documentariste Charlotte Bienaimé, dans l’épisode « Comment élever les garçons » d’Un podcast à soi #44 (Arte Radio, 2023), une autre mère confie son sentiment d’impuissance : l’éducation dégenrée qu’elle encourage « à la maison » se fait pulvériser « dès qu’il remet un pied à l’école ». Une autre souligne que l’éducation se fait d’abord par l’imitation : « Il faudrait plutôt regarder nos mecs, hein. Et qu’ils se regardent aussi, surtout ! »
De nombreuses mères des classes moyennes et supérieures embrassent alors l’idée que chaque garçon, en raison de la position sociale qu’il occupe dans nos sociétés sexistes, peut devenir un violeur. Elles deviennent des protagonistes politiques du féminisme occidental des années post-#MeToo.
« Je suis heureuse que nous ayons commencé à élever nos filles davantage comme nos fils, mais cela ne suffira pas si nous n’élevons pas davantage nos fils comme nos filles. »
Aux États-Unis, la prise de conscience a commencé dès 2013 sur les campus universitaires. Des étudiantes s’organisent pour dénoncer l’ampleur des violences sexuelles dont elles sont victimes dans les dortoirs ou lors des soirées étudiantes. À grand renfort de plaintes, de conférences de presse, de manifestations et de témoignages, elles révèlent aux parents que leurs fils violent des filles. Elles sont relayées par des journalistes, des réalisateur·ices ou blogueur·euses, issu·es des mêmes milieux sociaux. Début 2015, The Hunting Ground (« Le terrain de chasse »), documentaire sur la culture du viol au sein des universités, est sélectionné au festival du film de Sundance. En novembre de la même année, le Huffington Post publie une vidéo intitulée I’m Raising My Son As A Feminist (« J’élève mon fils en féministe ») qui fait le tour du web. Face caméra, quatre journalistes partagent leurs conseils de « mères féministes » pour éduquer des « garçons qui seraient une part de la solution, pas le problème ». Une semaine plus tard, l’éditorialiste féministe Gloria Steinem renchérit sur sa page Facebook : « Je suis heureuse que nous ayons commencé à élever nos filles davantage comme nos fils, mais cela ne suffira pas si nous n’élevons pas davantage nos fils comme nos filles. »
Nous défendre nous-mêmes
Cette focalisation sur l’éducation des garçons constitue une double rupture historique. D’une part, les féministes occidentales avaient, jusque dans les années 2010, peu embrassé les questions liées à la famille et à la maternité de manière positive. D’autre part, le mouvement féministe s’était, depuis deux siècles, exclusivement et fermement attaché à l’éducation des filles et des femmes. En 1914, la psychiatre féministe Madeleine Pelletier fut l’une des premières à proposer d’investir l’éducation avec l’objectif de transformer les rapports sociaux de genre : dans son manifeste intitulé Pour l’éducation féministe des filles, elle proposait de les « viriliser ».
Parmi les jeunes manifestantes qui, dans les cortèges, brandissent des pancartes arborant le slogan « Protégez vos filles, éduquez vos fils ! », beaucoup concentrent toute leur attention sur les mots barrés. Loin des préoccupations éducatives, elles mettent l’accent sur la nécessité pour les femmes de continuer à se protéger des violences.
« Les petites filles sont dressées pour ne jamais faire de mal aux hommes », écrivait Virginie Despentes dans King Kong Théorie (Grasset, 2006), ajoutant : « Je suis furieuse contre une société qui m’a éduquée sans jamais m’apprendre à blesser un homme s’il m’écarte les cuisses de force, alors que cette même société m’a inculqué l’idée que c’était un crime dont je ne devais pas me remettre. » Confrontée aux incapacités de la justice, à la surdité des universités, des familles mais aussi des espaces militants, une génération de féministes promeut une politique de l’autodéfense. À la banalité du viol, ces féministes opposent l’empouvoirement des femmes, mettant à distance toute stratégie fondée sur le dialogue entre les genres.
Les féministes des années #MeToo ont beau espérer que l’éducation féministe des garçons, si ardemment promue, produise un jour des effets, le fait est, rappelle Susie Kahlich, fondatrice de la fédération d’autodéfense féministe états-unienne Pretty Deadly Self Defense, que « la violence contre les filles et les femmes se produit maintenant ». C’est la raison pour laquelle, cette survivante de viol, par ailleurs mère d’un petit garçon, encourage les mères à donner à leurs filles « les moyens de se protéger elles-mêmes ». Autrement dit : éduquons nos fils à ne pas violer, oui. Mais d’ici là, éduquons nos filles à se défendre elles-mêmes.
Injonction redoublée pour les mères racisées
Auto-organisées et intransigeantes face aux violences masculines, des mères non blanches ou issues des classes populaires se mettent, elles aussi, en réseau dans la même décennie. On peut citer Mamans toutes égales contre l’exclusion des mères portant le hijab lors des sorties scolaires (2011), le collectif des mères de Mantes-la-Jolie (Yvelines) en lutte contre les violences policières (2018) ou le collectif des mères isolées de Montreuil (Seine-Saint-Denis), issu du mouvement des « gilets jaunes » (2019). Rompues au combat quotidien contre le racisme, la précarité et les violences policières, éducatives ou judiciaires, ces femmes sont les premières visées par l’injonction à éduquer les garçons, les leurs – lorsqu’ils ne sont pas blancs – étant considérés dès l’enfance comme des criminels en puissance. Elles proposent par conséquent de s’organiser en tant que mères. Parmi elles, la politiste Fatima Ouassak, cofondatrice, en 2016, du syndicat de parents des quartiers populaires, Front de mères, plaide pour la constitution de ces collectifs en force « politique et stratégique » du féminisme. D’autres organisations émergent par la suite : le festival Very Bad Mother à Concarneau (2019) ou encore la communauté de mères lesbiennes Matergouinités (2021).
Dans ces collectifs, les petites filles et les petits garçons sont avant tout considéré·es comme cibles des violences – rappelons qu’en France un enfant est victime d’inceste, de viol ou d’agression sexuelle toutes les trois minutes (Civise, 2022). « On ne dit pas assez que la culture du viol […] touche spécifiquement et majoritairement les enfant 2Fatima Ouassak, La Puissance des mères, La Découverte, 2020 ; réédition Points, 2023. », analyse Fatima Ouassak, qui propose d’observer les combats féministes à hauteur d’enfant. Elle décrit la « désenfantisation » des enfants non blancs qui fait d’eux « des adultes problématiques en devenir, des problèmes à régler », exposant les filles à des violences sexuelles spécifiques 3Comme cette fillette noire de 11 ans de Montmagny (Val‑d’Oise), dont le violeur a soutenu pour sa défense qu’elle faisait « plus que son âge » et qu’elle n’avait pas dit non. Lors de son procès en première instance en 2022, il n’a pas été poursuivi pour viol mais pour le simple délit d’atteinte sexuelle. et les garçons à des violences qui menacent leur vie. Comme Zyad (17 ans) et Bouna (15 ans), morts électrocutés à Clichy-sous-Bois en 2005 lors d’une course poursuite avec la police. Comme Nahel Merzouk (17 ans) tué à bout portant par un policier à Nanterre en juillet 2023.
Lire aussi : Lire la carte blanche de Fatima Ouassak dans le n° 15 de La Déferlante, août 2024
Ainsi, ces femmes des quartiers populaires ou des zones périurbaines reformulent-elles la question posée par les féministes blanches issues de milieux aisés. Il ne s’agit pas pour elles de s’interroger sur la bonne manière d’éduquer des garçons dans une société qui les adule et leur autorise tout. Mais plutôt de savoir comment changer cette société qui ne respecte pas plus leurs fils à elles que les femmes.
Résonnent ici les mots que la militante et poétesse africaine-américaine Audre Lorde adressait à ses camarades lesbiennes qui, à la fin des années 1970, l’invitaient à participer à une conférence interdite aux adolescents et aux hommes adultes. Refusant de laisser son fils seul à New York car il y était exposé aux violences racistes, elle explique lui avoir enseigné qu’elle n’était « pas là pour ressentir les émotions à sa place » mais pour lui apprendre à les embrasser dans un monde qui les méprise, sans avoir besoin d’une femme pour réaliser ce travail émotionnel. « Je veux élever un homme Noir capable de comprendre que sa légitime colère ne peut pas se diriger contre les femmes, mais contre les mécanismes d’un système qui le conditionne à craindre et mépriser tant les femmes que sa propre identité Noire. 4Audre Lorde, « Petit homme : réponse d’une lesbienne féministe Noire », dans Sister Outsider. Essais et propos sur la poésie, l’érotisme, le racisme, le sexisme…, Mamamelis, 2018 (1979 pour sa première édition aux États-Unis). »
Les différents usages et critiques du slogan « Éduquez vos fils ! » rappellent que le combat féministe se mène depuis des expériences socialement situées. Il dit aussi la richesse et le dynamisme du mouvement féministe contemporain, qui permet le déploiement d’approches stratégiques multiples – et l’épanouissement de sujets politiques nouveaux, comme les mères et, finalement, les enfants. •