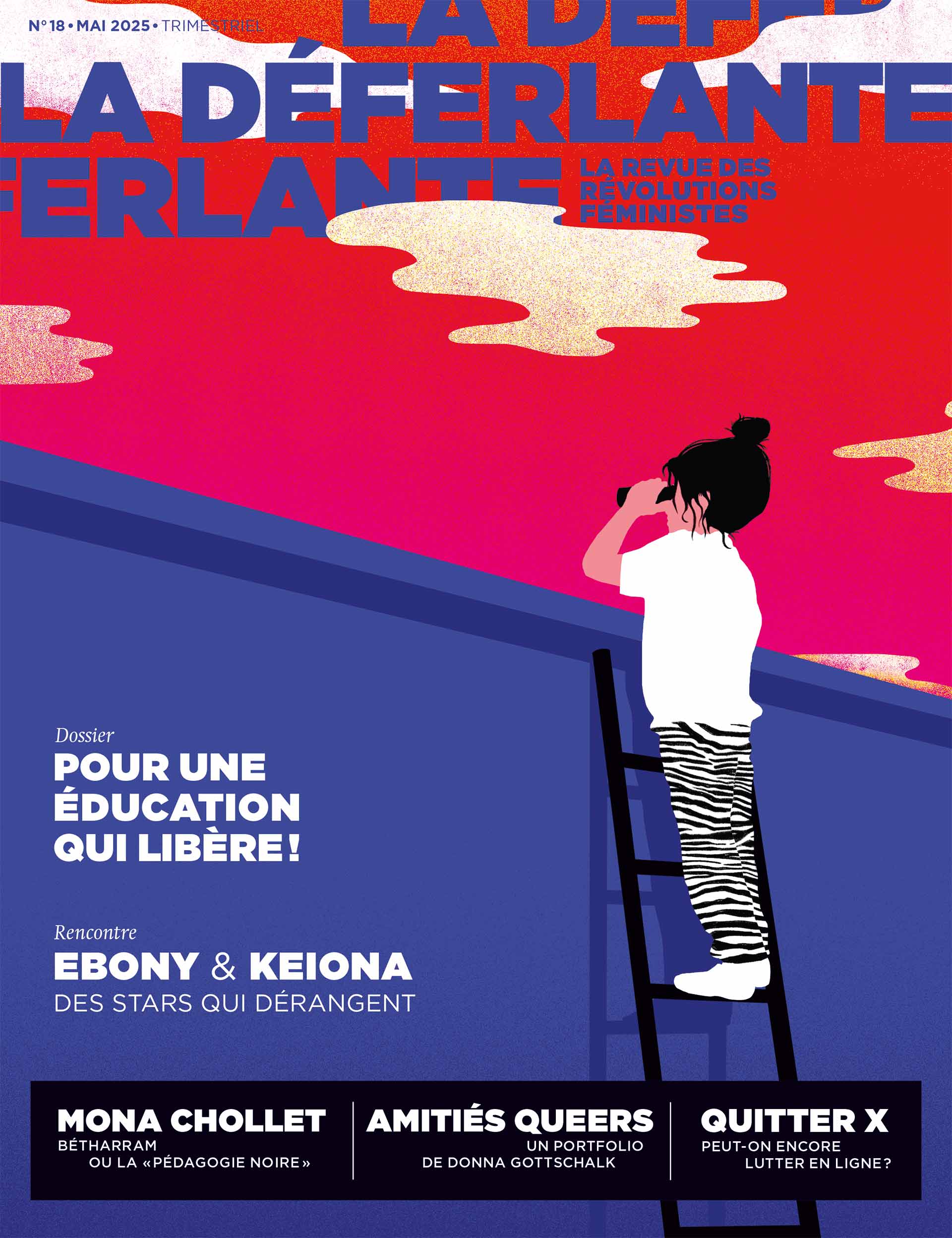Construit dans les années 1950, le quartier de Maurepas, au nord-est de Rennes, est en pleine phase de rénovation urbaine : le musée des Beaux-Arts y a ouvert un lieu d’exposition en février 2025, au rez-de-chaussée d’un immeuble de logements sociaux emblématique surnommé « la Banane ». Quelques mois plus tôt, entre juillet et octobre 2024, neuf fusillades liées au trafic de stupéfiants y avaient éclaté ; un enfant a même été blessé.
Cet espace, elles l’ont créé au pôle associatif Marbaudais (PAM), en face de « la Banane ». Dans ce bâtiment discret qui abrite une trentaine d’associations ainsi que la bibliothèque municipale, les adhérent·es de Front de mères – pour une écrasante majorité des femmes – se réunissent toutes les semaines. Sur les tables de leurs bureaux, des flyers sur l’accompagnement des enfants en situation de handicap côtoient les affiches des événements festifs de l’association. C’est à l’occasion de l’un d’eux que Rahma 1Elle ne souhaite pas donner son nom de famille., la dernière arrivée, a rencontré le syndicat de parents en mai 2024 : « Les discussions ont fait écho à ce que je faisais dans le quartier : être dans le partage, se refiler des tuyaux sur les activités des enfants, s’entraider face aux institutions, etc. » Avec Amandine, une membre active de Front de mères qu’elle connaît par l’école de ses enfants, elles ont alors l’idée d’organiser régulièrement un café des mères dans les locaux d’un autre centre socioculturel du quartier, près du grand parc des Gayeulles. « C’était pendant la période des élections législatives, le contexte politique était très stressant alors que l’extrême droite risquait d’arriver en tête, se souvient-elle. Quand on a commencé à discuter entre mères, ça a permis de libérer la parole sur toutes ces angoisses, et de se donner du courage. On a proposé aussi de se donner des conseils sur comment intervenir au niveau de l’école quand on a des soucis. »

Crédit photo : Louise Quignon pour La Déferlante
Les mères racisées trop peu représentées
En septembre 2024, Rahma, mère d’origine somalienne, ancienne aide à domicile et à la recherche d’un emploi, a fait le choix de devenir l’une des représentant·es des parents d’élèves 2Chaque année, les parents d’élèves élisent leurs représentant·es dans les instances de l’école, en particulier au conseil d’école qui se tient avec l’équipe enseignante chaque trimestre.au sein de l’école de ses enfants. Une décision qui n’était pas anodine tant la composition sociologique de ce groupe était peu diversifiée. « On était jusqu’ici plusieurs dizaines de parents délégués et d’enseignants, tous blancs, CSP+, indique Amandine, artisane, propriétaire dans le quartier et parent déléguée depuis un an et demi. Quand on était en réunion, ça m’a frappée, je me suis demandé qui représente vraiment l’école, sachant qu’elle est classée REP+. 3Dans les établissements REP (Réseau d’éducation prioritaire) et REP+, les enseignant·es bénéficient de conditions professionnelles particulières (effectifs de classes réduits, heures de formation supplémentaires…) afin de corriger l’impact des inégalités sociales sur le niveau scolaire. Dans une autre école du quartier, pas moins de cinquante nationalités différentes ont été recensées par le biais d’une étude. La multiculturalité est aussi très riche dans la nôtre. »
Ce manque de diversité des associations de parents impacte les conditions de dialogue dans l’établissement, ainsi que les choix faits pour la vie scolaire. « En cas de problème, les mères racisées ne vont pas vers les parents de la classe en breton, qui compte pourtant beaucoup de délégués », explique Rahma, car ils donnent le sentiment de former un groupe à part : « Leurs enfants sont scolarisés dans la même classe de la petite section au CM2, sans fréquenter les autres élèves de l’école. » Pendant la dernière fête de l’école, aucune alternative aux traditionnelles galettes saucisses n’a été proposée aux enfants et aux parents qui ne mangeaient pas de porc, ou pas de viande. « Toute une partie des parents qui avaient participé au financement de l’événement n’ont pas pu manger ce jour-là, poursuit Rahma. Quand on a parlé avec les parents délégués, ils ont dit qu’ils n’y avaient pas pensé. »
« La charge raciale, le fait d’être toujours en hypervigilance, chaque mère racisée peut les ressentir à différents niveaux. Entre le racisme, le sexisme et le mépris de classe, on n’a jamais la paix. »
Dans le quartier, c’est aussi sur la question sécuritaire que des divergences sont devenues sensibles. Les affrontements entre trafiquants de drogues, à quelques pas du pôle associatif, ont suscité les craintes des parents, inquiet·es quant à la sécurité des enfants sur les trajets allant de l’école à la bibliothèque municipale. Un enseignant a avancé l’idée de déménager celle-ci dans un autre bâtiment public. Une solution à laquelle se sont opposées des membres de Front de mères, soucieuses de conserver ce service public au sein du quartier. « On a été deux mères à dire non, se rappelle Amandine. Un parent a même proposé que les enfants soient accompagnés par un policier sur le trajet. Ils ne se rendent pas compte combien leurs expériences de vie, notamment avec la police, peuvent être différentes de celles des personnes non blanches. »
Pour l’heure, peu de mères racisées ont fait la démarche de se présenter aux élections des parents d’élèves. Selon Rahma, cela tient à un sentiment d’illégitimité : « Elles disent qu’elles ne se sentent pas à l’aise pour parler au nom des autres, parce qu’elles pensent ne pas maîtriser suffisamment la langue, ne pas connaître suffisamment les droits en tant que parents dans le cadre scolaire. » Des barrières qui pourraient être facilement levées, estime la militante, avec davantage de rencontres et de transmission entre parents délégué·es. « On demande souvent à ces mères de participer financièrement quand il y a des événements, de faire des gâteaux, d’accompagner pour les sorties scolaires. Ce sont toujours les mêmes qui le font d’ailleurs, mais on ne leur demande pas leur avis sur la vie de l’école. C’est comme si elles n’étaient pas assez bonnes pour y être réellement intégrées. »
Si Rahma, de son côté, a hésité à faire partie des représentant·es de parents, c’est surtout pour des questions d’organisation : compliqué d’assister à des réunions en soirée quand on a, comme elle, un conjoint qui travaille en horaires décalés, ou qu’on est famille monoparentale. Pour prendre en compte ces contraintes, de plus en plus de réunions sont calées le matin. « Ce qui est aussi plus pratique pour beaucoup de mères finalement », précise Amandine.
« Prendre confiance en nous »
Au sein de l’antenne rennaise de Front de mères, où les adhérentes sont pour plus de la moitié des cheffes de famille racisées en situation de monoparentalité, on réfléchit également aux moyens de favoriser l’implication des mères issues des classes populaires. À chaque tenue d’événement, l’accent est mis sur les solutions de garde : ce sont souvent les conjoint·es de membres de l’association ou les quelques hommes ayant adhéré au syndicat qui s’en occupent. « Les adhérentes qui sont blanches, issues de milieux plus favorisés, ont pris l’initiative de prendre en charge les tâches administratives et logistiques pour soulager au quotidien celles qui sont moins disponibles, et permettre aux mères racisées d’être davantage sur du plaidoyer, de la prise de parole et sur les orientations stratégiques », explique Priscilla Zamord.
Pour que ces dernières trouvent leur place dans le cadre scolaire, Front de mères multiplie les actions : dans les prochains mois, l’association lancera un programme à destination des parents délégué·es des quartiers populaires. Le but : leur donner des clés pour saisir le fonctionnement de l’Éducation nationale et avoir accès à une meilleure connaissance de leurs droits. Il s’agit aussi de les former à la prise de parole en public, ainsi qu’à l’autodéfense sexiste et antiraciste.
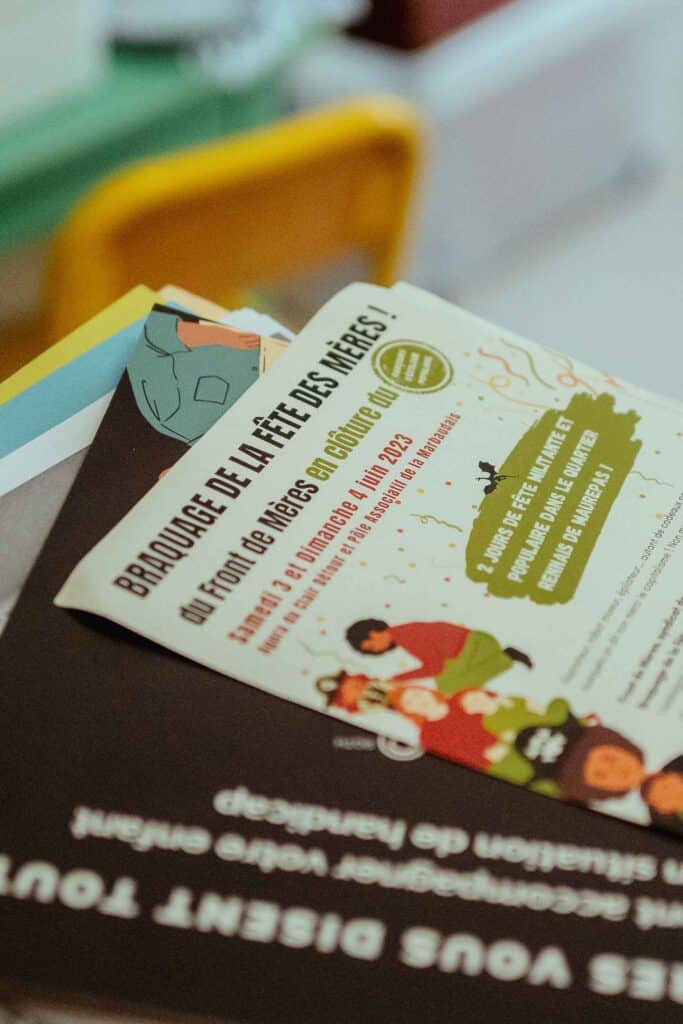
Une initiative qui pourrait se révéler utile pour celles qui souffrent encore d’un manque de légitimité, comme en témoigne Nour, adhérente de l’association, responsable, avec Amandine, du pôle de lutte contre le validisme 4Le validisme, aussi appelé capacitisme, est un système d’oppressions qui infériorise les personnes handicapées, en considérant les personnes valides comme la norme sociale. Consulter aussi notre glossaire de concepts sur revueladeferlante.fr à l’école. « Je parle parfois de mon engagement avec d’autres mères que je connais, explique-t-elle. Certaines aimeraient militer, mais n’ont pas forcément le temps ou n’osent pas encore le faire. En plus de la charge mentale à gérer au quotidien, il faut aussi un certain courage pour mener quelque chose de collectif. On se dit : “Est-ce que j’ai suffisamment de force pour parler et argumenter avec les gens ?” Il s’agit de prendre confiance en nous. »
Le syndicat de parents se voit aussi en acteur complémentaire des actions menées par la municipalité et les centres sociaux, comme les ateliers d’apprentissage du vélo proposés aux mères du quartier. « Souvent, on est approchées pour nous inviter à des conférences sur la parentalité, ce qui peut être un peu infantilisant, observe Amandine. Ce sont des regards plaqués sur nous, qui ne partent pas forcément de nos besoins réels, ou qui ne tiennent pas compte de nos compétences – à part quand il s’agit de nous proposer de partager des recettes ou des berceuses, ou d’autres trucs de bonnes femmes. »
Pour faire bouger les lignes dans les établissements scolaires, inclure davantage les parents des quartiers populaires et mieux prendre en compte leurs réalités, une autre initiative, venant d’enseignant·es cette fois, a vu le jour à Rennes en octobre 2024 : le collectif Pour une école antiraciste. Il comprend une quarantaine de membres, en majorité des enseignant·es, mais aussi des assistant·es d’éducation (AED), des accompagnant·es d’élèves en situation de handicap (AESH), des parents et des élèves. « L’idée était d’élargir l’organisation au-delà du milieu syndical, qui peut avoir tendance à rester corporatiste, axé sur la défense de nos droits de professionnel·les, et où les autres champs de la vie scolaire demeurent peu investis », indique Louise, enseignante en espagnol dans un lycée rennais du centre-ville et membre du collectif.
Celui-ci se veut un comité de vigilance, un espace au sein duquel des situations discriminantes, comme celles auxquelles les élèves racisé·es sont parfois confronté·es, au moment de l’orientation par exemple, peuvent être remontées. L’objectif étant que des enseignant·es, notamment, interviennent alors dans les établissements concernés. Les liens entre Pour une école antiraciste et Front de mères se construisent peu à peu, certain·es membres des deux organisations faisant office d’interface.
« Pour nous, la question de la coéducation est importante, estime de son côté Priscilla Zamord. On n’oppose pas l’école et les parents. On peut travailler ensemble. Mais on ne va pas banaliser des pratiques racistes, sexistes ou validistes. Il faut notamment mettre en place des formations pour les enseignants sur les questions d’égalité. »
L’idée est aussi, à la longue, de réfléchir à des modèles alternatifs, et à ce que pourrait être une « école du futur ». « Au quotidien, on n’a pas beaucoup de temps pour être dans autre chose que la réaction, ajoute Priscilla Zamord. Face à un monde qui brutalise, nous devons être des “guerriers de l’imaginaire”, pour reprendre les mots de l’écrivain martiniquais Patrick Chamoiseau. Cela passe aussi bien par le fait de s’organiser entre nous que par la transmission de nos histoires de militantes et la mémoire des luttes qui nous ont précédées. » •
Cet article a été édité par Diane Sultani Milelli.