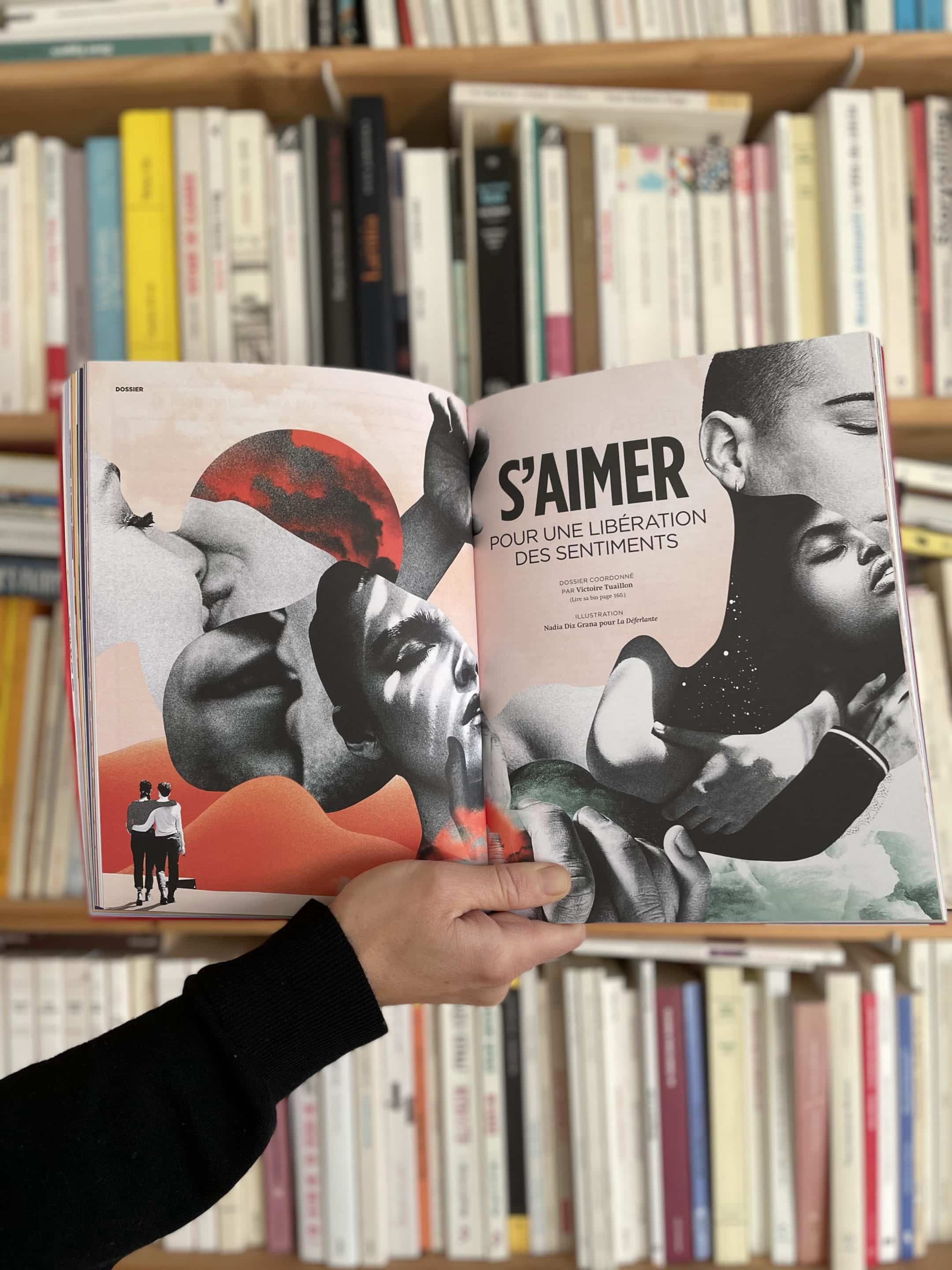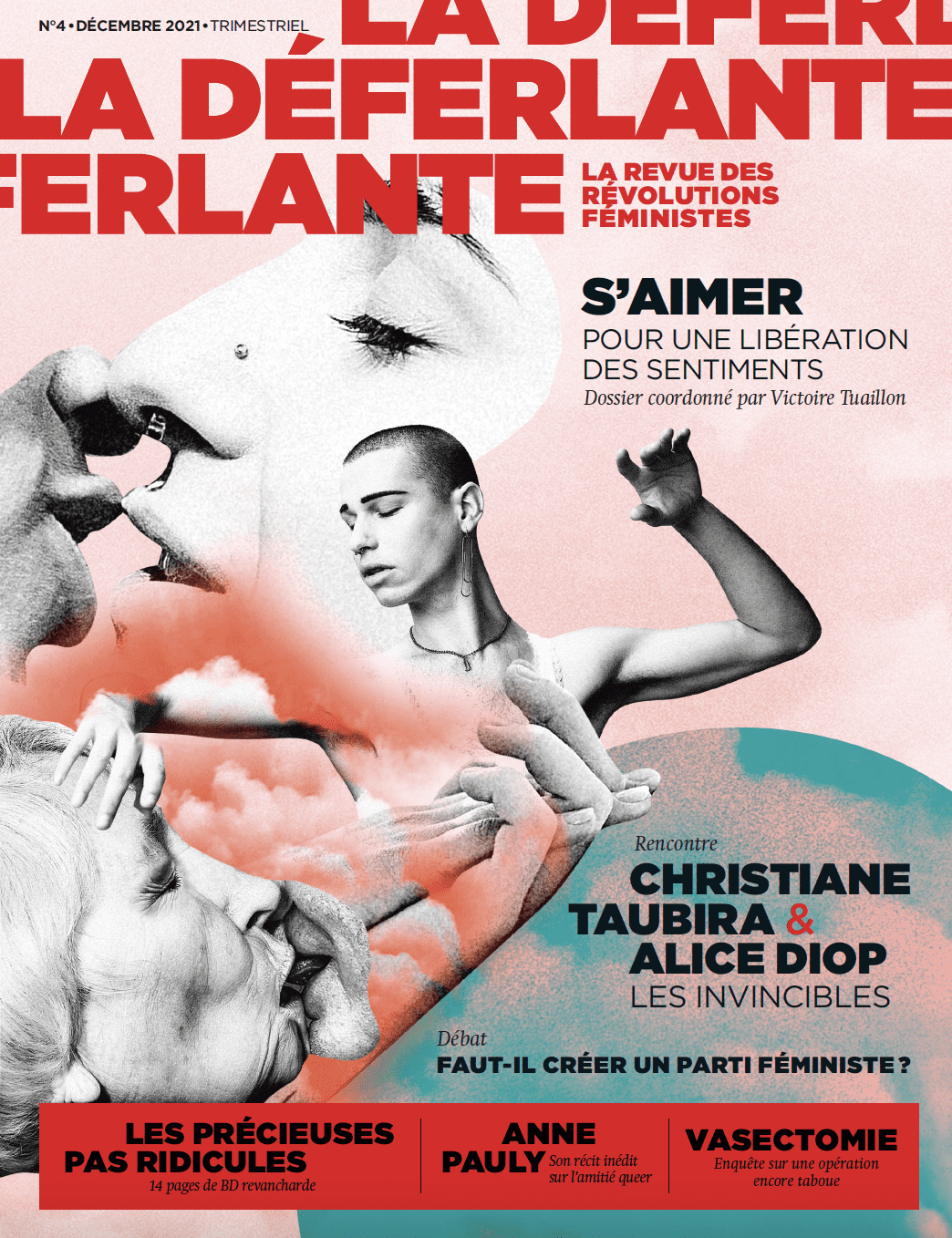L’Assemblée nationale a finalement adopté à la quasi-unanimité, dans la nuit du 21 au 22 juillet, l’indépendance financière des personnes handicapées vis-à-vis de leur conjoint. A cette occasion, nous republions cet entretien avec deux des membres du Le prix de l’amour, collectif aux avant-postes de la mobilisation pour la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapé·es (AAH). Ses actions ont sensibilisé le grand public et les élu·es afin de dépoussiérer cet arsenal législatif enfermant l’amour dans des logiques de dépendance. Rencontre avec : Anne-Cécile Mouget et Kévin Polisano.
Allocation de solidarité d’un montant maximal de 903,60 euros, l’AAH, censée assurer aux personnes handicapées un minimum de ressources, est calculée en prenant en compte les revenus du ou de la conjoint·e si la personne vit en couple. Autrement dit, le contrat amoureux sous le régime de l’AAH se solde par une potentielle perte d’autonomie financière pour la personne handicapée. Si son ou sa partenaire gagne plus de 1 065,55 euros de salaire net par mois, la personne handicapée verra son allocation diminuer – voire tomber à zéro si ce salaire dépasse 2 271,55 euros par mois.
Racontez-nous la naissance du collectif Le prix de l’amour.
Anne-Cécile Mouget : C’est récent, mais notre intérêt pour ce sujet est ancien ! Kévin et moi, tous·tes deux porteur·euses d’un handicap, nous sommes rencontré·es en mars 2021 sur le plateau de l’émission L’œil et la main sur France 5 afin de parler de l’AAH et de son mode de calcul injuste. En quittant le plateau, on s’est dit que c’était le moment de s’engager fermement. Le collectif est né dans la foulée. Nous sommes désormais cinq à en former le noyau dur et une dizaine de personnes sont impliquées. Nous avons tous·tes une expérience personnelle et une expertise à faire valoir. Je termine actuellement ma thèse sur la vie amoureuse et sexuelle des hommes handicapés. Ma recherche m’a ouvert les yeux sur l’impact délétère du mode de calcul de l’AAH. C’est un frein à la vie amoureuse : les hommes bénéficiaires de l’AAH sont déjà relativement pauvres, il leur est difficile d’inviter quelqu’un au restaurant, par exemple, et c’est presque impensable de se retrouver dépendants de leur conjoint·e. J’ai moi-même vécu de l’AAH quand mon handicap m’affaiblissait trop pour travailler, j’ai donc été directement concernée et j’ai fait l’expérience de renoncer à une vie de couple pour ne pas perdre mon allocation.
Kévin Polisano : Je suis chercheur en maths appliquées, j’approche cette problématique avec ma sensibilité et mon bagage scientifique. J’ai touché l’AAH quand j’étais étudiant, alternant entre stage et formation. Mon allocation fluctuait en fonction des salaires que je percevais sans que le mode de calcul ne soit clair ni accessible pour les non-initié·es. J’ai donc eu envie de comprendre comment fonctionnait la boîte noire des Caisses d’allocations familiales (CAF), c’est un vrai brouillard ! Je me suis rendu compte qu’il y avait quantité de problèmes : l’existence de seuils engendrant des pertes financières, les incohérences parmi les situations et exceptions proposées, les erreurs commises par les CAF… Et surtout les injustices inhérentes au mode de calcul de l’AAH en couple. À partir de 2013, j’ai écrit des billets de blog décryptant ce système. J’ai reçu une avalanche de mails. Des gens me racontant qu’ils renonçaient à leur projet de Pacs ou de mariage, qu’ils choisissaient de divorcer pour retrouver une forme d’autonomie financière… Tout ça m’a sidéré.
Le problème de l’AAH est ancien. Pourquoi la lutte est-elle si récente ?
Anne-Cécile Mouget : L’histoire commence en 1975, année de création de l’AAH. Fondée sur le principe de la « solidarité familiale », son montant est calculé en fonction des revenus du ou de la conjoint·e, à l’époque uniquement marié·e. Sauf que la solidarité devrait marcher dans les deux sens ! Les gens n’osaient pas en parler tant la honte du handicap et de la dépendance financière est profondément ancrée dans nos sociétés. Elle est peut-être encore plus prononcée chez les femmes, qui vont compenser en surinvestissant l’espace domestique… Notre collectif a recueilli des témoignages de femmes extrêmement fatigables qui se tuent à la tâche chez elles pour « payer » ce statut de conjointe dépendante. La situation de dépendance financière est le terreau fertile de l’emprise et des violences conjugales. Sans revenu propre, les femmes n’ont aucune possibilité de partir pour se protéger. Mais jusqu’à aujourd’hui, ce sujet a été peu investi par le tissu associatif français sur le handicap. Je pense que c’est lié à la forme des associations. Ce sont de grandes structures gestionnaires subventionnées par l’État, souvent animées par des parents de personnes handicapées qui cherchent d’abord à développer des solutions de prise en charge de leurs enfants. Certaines, ayant une base religieuse ou charitable, mettent des freins à la conjugalité et la sexualité de leurs enfants qu’elles aimeraient maintenir comme des mineur·es à vie. Le calcul de l’AAH les concerne peu.
Kévin Polisano : Il y a eu des périodes avec des collectifs plus militants, dans la filiation par exemple des Handicapés méchants des années 1970. On retrouve cette énergie aujourd’hui avec une nouvelle vague de collectifs plus mordants comme les Dévalideuses ou le Collectif lutte et handicaps pour l’égalité et l’émancipation (CLHEE). Plusieurs de ces collectifs – dont le nôtre – se sont associés pour faire plus de bruit autour du combat pour la déconjugalisation de l’AAH.
Anne-Cécile Mouget : Comme pour #MeToo, le moment de bascule date de l’avènement des réseaux sociaux. Ces espaces de parole ont permis aux personnes concernées de réaliser qu’elles étaient des milliers à vivre cette situation injuste et qu’elles étaient légitimes pour en parler ! En parallèle, depuis cinq ans, des parlementaires conscient·es du problème l’ont mis à l’agenda politique.
Kévin Polisano : Et certain·es n’ont pas lâché ! C’est le cas notamment de Marie-George Buffet (PCF), de Jeanine Dubié (PRG) ou encore de Philippe Mouiller (LR) pour n’en citer que quelques-un·es. La première fut à l’initiative d’un texte de proposition de loi en 2017 qui a marqué un tournant. Même s’il a été rejeté, différents groupes politiques ont ensuite retenté des propositions similaires, prônant la suppression de la prise en compte des revenus du ou de la conjoint·e.
Anne-Cécile Mouget : Cet élan a abouti en 2020 au vote de celle déposée par Jeanine Dubié à l’Assemblée. Elle est passée en première lecture contre l’avis du gouvernement et de la majorité, puis le Sénat l’a adoptée en mars dernier avant de la renvoyer à l’Assemblée pour une seconde lecture. On a été sollicité·es pour une audition et écouté·es. La proposition de loi n’a finalement pas été votée à cause du blocage par le gouvernement qui n’en voulait pas… Mais sept groupes parlementaires sur neuf étaient pour ! On avance.
Quels sont les arguments de celles et ceux qui s’opposent à la déconjugalisation de l’AAH ?
Kévin Polisano : Le gouvernement craint qu’elle n’ouvre une brèche pour tous les minima sociaux. Autrement dit, qu’on se mette aussi à demander une individualisation du Revenu de solidarité active (RSA), par exemple, également calculé en prenant en compte les revenus du foyer. Cela aurait selon eux un coût exorbitant. On a aussi eu droit à des avis assez saugrenus, voire pétris de conservatisme. Sophie Cluzel, secrétaire d’État aux personnes handicapées, a estimé, par exemple, que la réforme « menaçait le modèle du couple »… C’est absurde !
Anne-Cécile Mouget : Les débats ont été intenses. Ce n’était pas une question de majorité ou d’opposition, mais de politique avec un grand P. Qu’est-ce qu’on veut pour notre société ? Veut-on que les conjoint·es soient dépendant·es l’un·e de l’autre ou qu’ils et elles choisissent le meilleur contrat possible pour être ensemble sans moyen de pression de l’un·e sur l’autre ?
Qu’est-ce que cela provoque, chez vous, cette entrée en lutte ?
Anne-Cécile Mouget : Quand on vit avec un handicap, des moments de la vie peuvent être très durs. Bon. Je vais faire référence aux travaux de Viktor Frankl, psychiatre juif rescapé des camps de concentration. À ses interrogations sur comment survivre face à l’horreur, comment trouver le courage de continuer, il trouvait des réponses dans le sens qu’on donne à sa vie. Eh bien, j’ai choisi un sens à ma vie : la connaissance et l’amour. Toute ma vie est orientée dans cette direction. J’essaie d’aider d’autres personnes en générant de la connaissance. Je suis pleinement à ma place en faisant bouger une loi pour aider des milliers de personnes à vivre librement leur vie amoureuse.
Kévin Polisano : Que rajouter après cela ?… Je partage le choix d’Anne-Cécile, la connaissance et l’amour. Je crois que je me sentais redevable aussi. On est un peu des anomalies statistiques, car les personnes handicapées sont trop peu nombreuses à accéder aux études supérieures. Elles ne sont pas bien scolarisées, elles sont bridées. J’ai besoin d’aider celles et ceux qui n’ont pas eu cette chance-là. Qu’elles et ils puissent enfin vivre dignement. •
Entretien réalisé le 21 juillet 2021, par Iris Deroeux