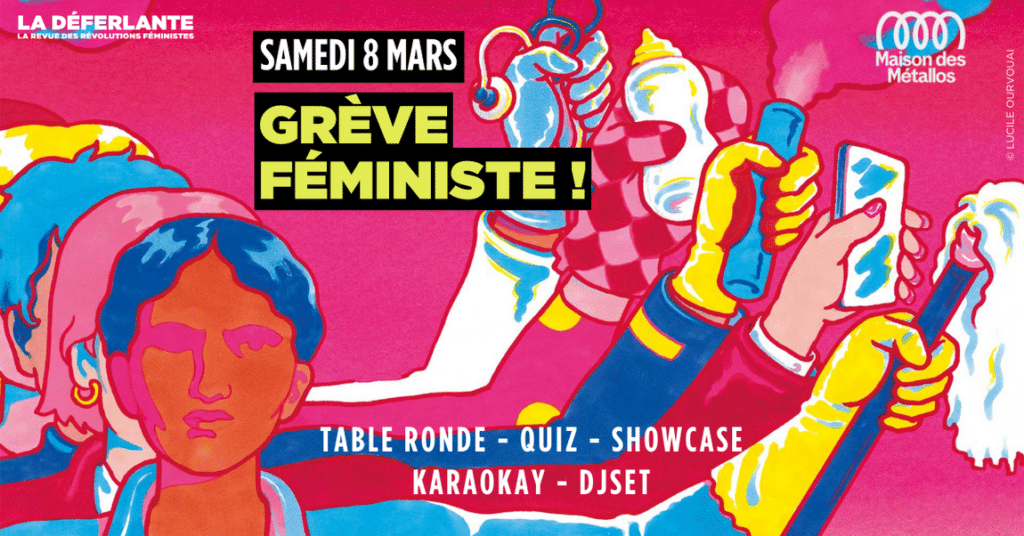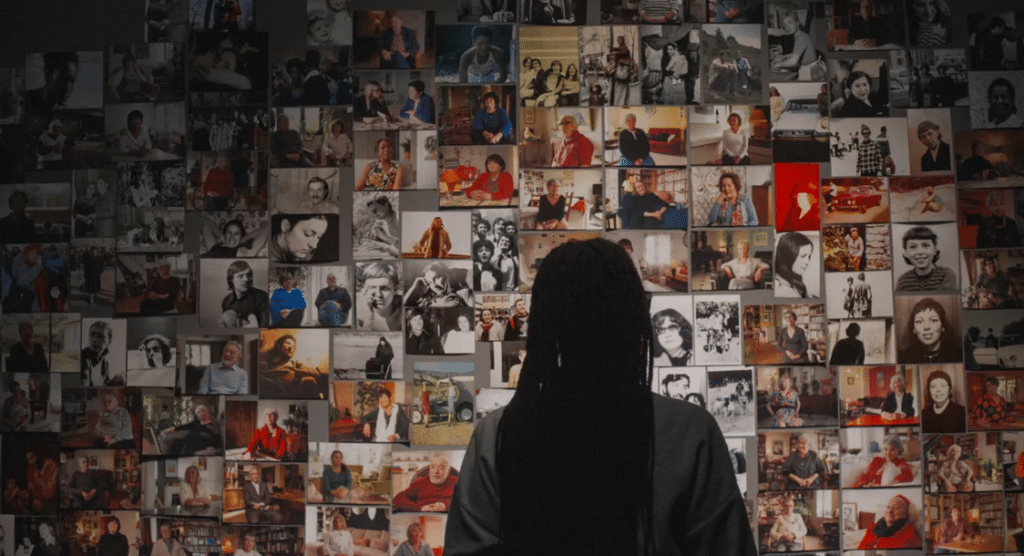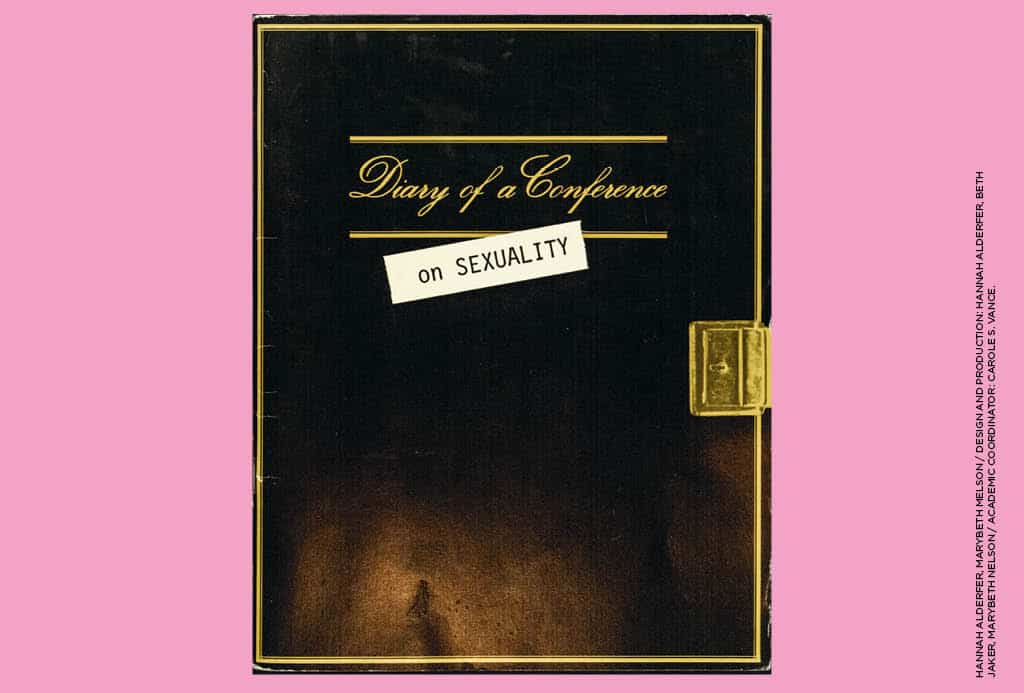À la tête du gouvernement hongrois depuis 2010, le populiste Viktor Orban dispose d’une majorité au Parlement grâce aux alliances des députés de sa majorité avec l’extrême droite.
C’est pour témoigner de ces attaques que Dorottya Rédai était présente à Rome, du 23 au 26 avril dernier, dans le cadre de la quatrième Conférence de l’Euro central asian lesbian*community, un événement annuel organisé par des activistes lesbiennes.
Comment l’annonce de l’interdiction de la Marche des fiertés de Budapest a‑t-elle été reçue par la communauté LGBTQIA+ hongroise ?
Ce n’est pas la première fois qu’Orban s’en prend à nous : nous sommes attaqué·es en permanence. Mais cette interdiction pure et simple, même les organisateur·ices ne s’y attendaient pas. Notre communauté est sous le choc.
La Budapest Pride est une grande manifestation en faveur des droits humains. Elle est devenue un événement très important en Hongrie au cours des dix dernières années. L’an dernier, nous étions 35 000 participant·es.
Cette décision inquiète aussi plus généralement les Hongrois·es opposé·es à Orban, qui ont peur de voir disparaître leurs droits fondamentaux – notamment le droit de manifester. Et cette inquiétude est légitime puisque Orban marche dans les pas de Poutine. Si nous ne l’arrêtons pas, la Hongrie pourrait devenir comme la Russie [un État autoritaire qui persécute les femmes et les minorités sexuelles et de genre].
Quelles sont les conséquences de la politique du gouvernement d’extrême droite hongrois dans la vie quotidienne des personnes LGBTQIA+ ?
Selon les statistiques de la Háttér Society, la plus grande organisation LGBTQIA+ de Hongrie, le nombre d’agressions physiques n’a pas augmenté, mais les agressions verbales ont gagné en violence. Elles reflètent le langage grossier que s’autorise aujourd’hui la classe politique du pays pour parler des homosexuel·les, des personnes trans et des personnes queers.
L’association Labrisz [son nom fait référence à une hache antique devenue un symbole lesbien], que je dirige, veut rester un espace ouvert et sûr pour les lesbiennes en Hongrie. Nous continuons à faire ce que nous avons toujours fait, comme si la situation était normale : nous mettons sur pied des événements communautaires et des festivals qui, à chaque attaque du gouvernement, attirent toujours plus de monde. Nous collectons et conservons des archives lesbiennes, produisons des films, publions des livres et coopérons avec d’autres organisations.
« Avec l’annulation de la Pride, les Hongrois·es ont peur de voir leurs droits fondamentaux disparaître. »
En 2020, vous avez justement édité un livre jeunesse, traduit en onze langues : Brune-Feuille. Le prince se marie et autres contes inclusifs (trad. J. Dufeuilly, C.A. Holdban, C. Philippe, Talents Hauts, 2022). Pouvez-vous revenir sur cet épisode ?
Au moment de sa publication, une femme politique d’extrême droite, qui ne l’avait pas lu, a organisé une performance médiatique d’une grande violence, lors de laquelle elle a passé le livre à la déchiqueteuse, arguant qu’il ne faisait pas partie de la culture hongroise.
Pourtant, il s’agit simplement d’un ouvrage qui représente des personnages queers ou appartenant à d’autres minorités [des personnes racisées ou issues des classes populaires] que le gouvernement invisibilise ou attaque. C’était très choquant, mais cela nous a fait beaucoup de publicité. On en a vendu 35 000 exemplaires, et le livre est même devenu un best-seller en Hongrie sur le marché des livres pour enfants !
Le 28 juin prochain, les associations LGBTQIA+ hongroises maintiennent l’appel à manifester. Comment allez-vous vous organiser ?
Toutes nos organisations sont d’accord : nous ne reculerons pas. On va essayer d’être aussi nombreux·ses que possible parce que plus la foule sera grande, plus il sera difficile pour la police de traquer les manifestant·es. La loi autorise désormais la police à utiliser un système de reconnaissance faciale pour identifier les manifestant·es, cela peut donc dissuader les gens de descendre dans la rue. Celles et ceux qui braveront l’interdiction s’exposeront à une amende pouvant aller jusqu’à 500 euros, soit plus de la moitié du salaire mensuel moyen. En prévision, des cagnottes ont déjà été lancées par des activistes.
La solidarité s’exprime aussi en dehors de la communauté. Des citoyen·nes hétérosexuel·les manifestent chaque semaine pour soutenir la Marche des fiertés : c’est du jamais vu ! Des personnes qui n’étaient jamais allées à la Pride veulent maintenant y participer. J’ai rencontré ces derniers jours à la conférence EL*C des activistes lesbiennes membres du Parlement européen qui m’ont assurée de leur présence. En fin de compte, une résistance se met en place et cette Pride pourrait bien être la plus grande qu’on n’ait jamais eue !