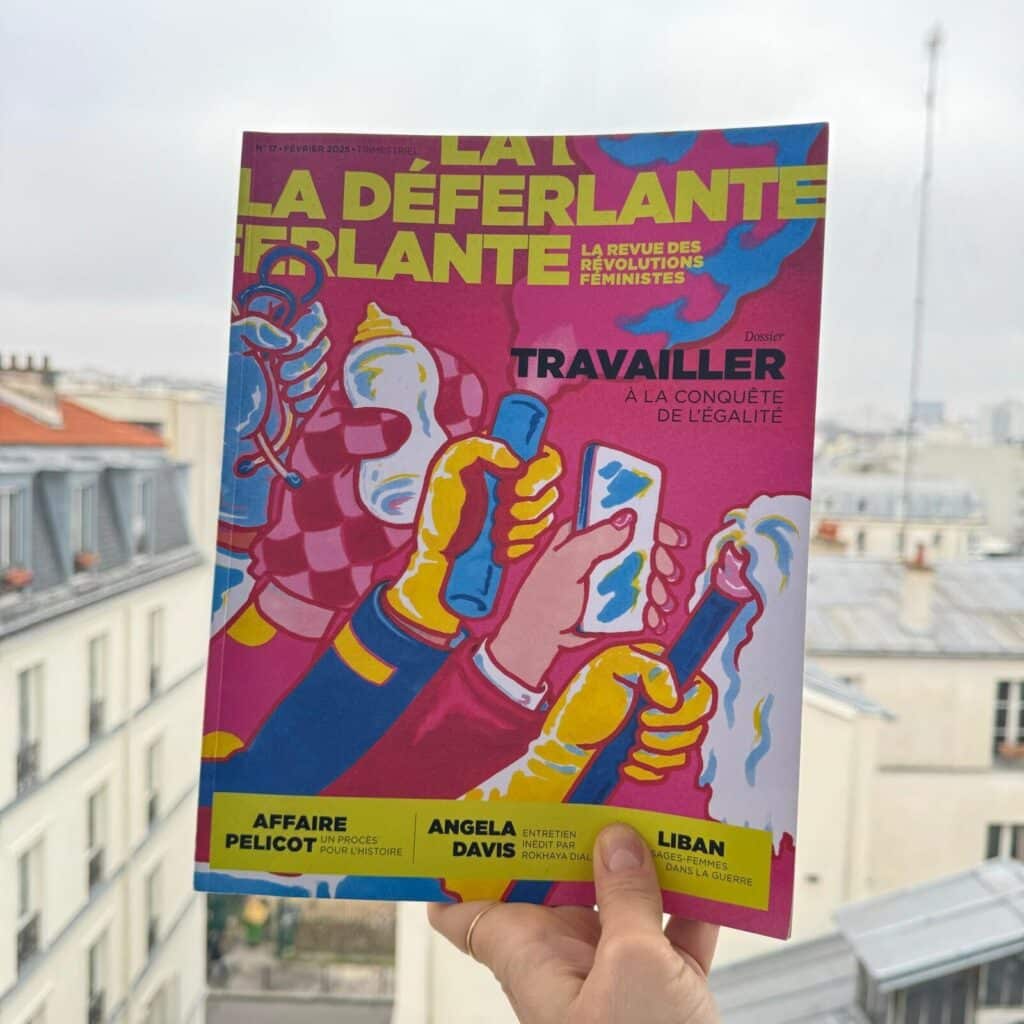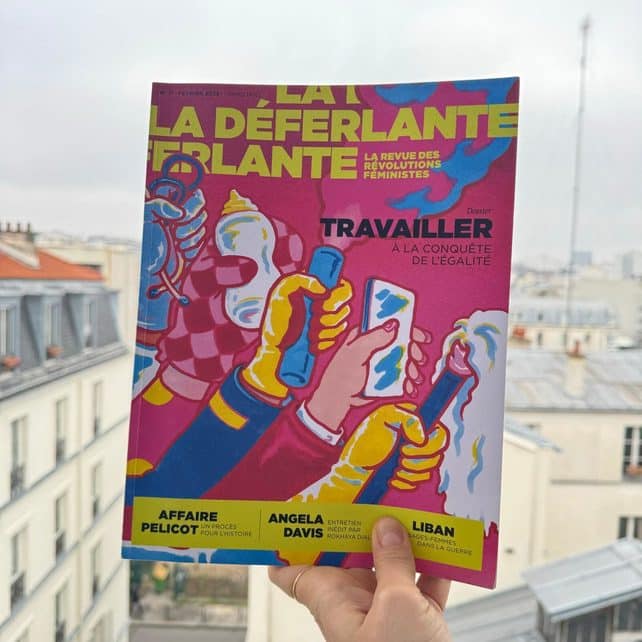« Et toi, tu as choisi quoi comme nom de guerre ? » Il y a des décisions prises sur un coin de table qui scellent un destin. Un pseudonyme griffonné à la va-vite en bas d’une autorisation de diffusion, la première d’une infinie série.
Ovidie n’est pas mon nom. Ou plutôt si, il l’est devenu par la force des choses. Sous ce nom, cela fait plus de vingt ans que je réalise des fictions et documentaires, que j’écris, que je milite. Jusque-là, pourquoi pas, je ne suis pas la première artiste à travailler sous pseudonyme. Mais le fait est qu’Ovidie était également mon nom de travailleuse du sexe lorsque j’exerçais cette activité, entre 1999 et 2002, et que je n’ai jamais souhaité en changer. Qu’il me sert aujourd’hui pour des activités socialement adoubées, des productions culturelles pour Arte ou France Culture par exemple, comme il m’a servi par le passé au sein d’une industrie que beaucoup regardent comme la lie de notre société.
Mais qui opte comme ça pour un autre nom ? Celles qui à la fois veulent renaître et se suicider socialement. Les putes ont ceci de commun avec les bonnes sœurs qu’elles sont contraintes de se rebaptiser. Deux catégories qu’on croirait diamétralement opposées, entre lesquelles je n’ai pourtant cessé de naviguer. Sainte Ovidie.
Les putes ont ceci de commun avec les bonnes sœurs qu’elles sont contraintes de se rebaptiser.
Tout en tentant désespérément de m’ancrer dans la réalité pour ne pas perdre pied, j’ai voulu faire de ma propre vie un roman, me mettre moi-même en scène en figure tragi-comique. Jusqu’à peut-être mettre un jour en scène ma propre mort, qui sait ? Je me demande parfois si je ne vais pas finir telle une héroïne romantique dont le rôle est mal interprété, agonisant faussement sous les projecteurs, sylphide alanguie avec les seins à l’air. Quelle blague !
Un pseudonyme pour parer la violence
Au début, cette nécessité de changement de nom, biffer « Éloïse » pour devenir « Ovidie », ça n’était pourtant qu’une bête stratégie de protection de ma vie privée. Lorsqu’on est une femme et qu’on fricote dangereusement avec toute imagerie liée à la sexualité, il est capital de préserver son nom de baptême pour sa propre sécurité, et surtout pour la sécurité de sa descendance née ou à naître. Une précaution dont ne s’embarrassent pas nécessairement les hommes du même milieu qui, eux, peuvent conserver leur prénom ou leur surnom. Ainsi, les Christophe deviennent Kristof, les Sébastien deviennent Sébastian… Et les Rocco Siffredi sont encensés dans leur rôle de père de famille, on leur consacre des hagiographies, on loue leur qualité d’homme aux multiples facettes.
Les putains sont, elles, contraintes de se réinventer – comme les bonnes sœurs, je l’ai dit, mais aussi comme les légionnaires. Sauf qu’une putain ne tue personne. À la limite, elle se tue de ses propres mains, pour reprendre la formule de Nelly Arcan, « en vertu d’une dépense trop rapide de [son] énergie vitale dans [ses] années de jeunesse 1Nelly Arcan, Folle, Éditions du Seuil, 2004 ». Elle n’assassine pas, pourtant, elle aurait tué père et mère qu’on la traiterait avec plus d’égards.
Mais si on change de nom, en réalité, c’est surtout pour envoyer une autre que soi au front. Cette fictionnalisation de soi-même permet d’amortir la violence du regard social : l’avatar que l’on crée va endosser la brutalité et la haine. C’est sans doute pour cette raison que je me sens si peu concernée par toutes les insultes et menaces que je reçois sur les réseaux sociaux : au fond ce n’est pas moi dont on parle, c’est une poupée à mon effigie que l’on transperce d’aiguilles. Alors je ne réponds pas. Je ne saurais même pas quoi dire, tellement ce que je lis sur moi me laisse perplexe. Il m’est déjà arrivé de taper mon nom dans Google, et la magie des référencements et des algorithmes me proposent une femme que je ne connais pas. Même ma fiche Wikipédia me semble étrangère à moi-même. C’est donc ainsi qu’on me perçoit ?
L’abandon de ma propre image et de mon corps n’était pas sans risque : il aurait pu me mener vers une lente destruction. C’est vers l’écriture et la formulation d’une pensée que je me suis tournée dans l’espoir de sauver ma peau. Car si la putain-objet se soumet aux désirs des hommes, l’autrice-sujet est, elle, porteuse de discours. Pour produire de la pensée, j’ai voulu garder ce nom, « Ovidie », qui était finalement bien à moi car surgi de ma propre imagination. J’ai cru retrouver la maîtrise de cette identité. Mais ai-je eu raison de mélanger les torchons et les serviettes en conservant, dans mes activités d’autrice et de réalisatrice, mon nom d’actrice ? Aujourd’hui encore, mon passé professionnel fait régulièrement obstacle à mon travail. Au mieux, je suis la putain qui pense. À chaque nouveau documentaire, chaque nouveau livre, chaque nouvelle série, à chaque nouvelle forme produite susceptible de me donner une légitimité sociale, des hordes de masculinistes ressortent des photos de moi en porte-jarretelles en espérant me silencier. Même si cela fait vingt ans que je ne me suis pas déshabillée, on m’invite à retourner écarter les jambes sans moufter, parce que c’est là que se trouverait ma place. Et n’allez pas croire qu’il n’y a que les hommes qui se comportent ainsi. Certes, ce sont les pires, mais bien des femmes aiment encore me réduire à ma corporéité. On n’est décidément pas encore toutes au point question sororité.
Les amours impossibles d’une poupée russe
« Mais si tu souffres de cette stigmatisation, pourquoi n’as-tu jamais voulu reprendre ta véritable identité ? » Ah très bien, on laisserait donc Ovidie à ses activités de putain et on inviterait Éloïse à récolter les lauriers de la légitimation. On abandonne l’une sous le flot de sperme de millions d’internautes venus se masturber sur Pornhub, on sauve l’autre en lui attribuant des titres honorifiques. Et pourquoi pas une troisième identité à la jonction du personnage public, de mon identité civile et, cerise sur le gâteau, de mon grade universitaire pour briller en société ? Docteure Ovidie Delsart, ça sonne bien non ? Non, en fait, ça ne sonne pas terrible. Du reste, j’ai déjà l’impression d’être une poupée russe qui camoufle toutes ces couches d’identités diverses, alors merci bien.
Toute relation amoureuse en devient impossible. Toute rencontre sentimentale ne peut que se résumer à un effroyable malentendu, à un décalage entre l’image que je donne à voir et la réalité de ce que je suis. On pourrait croire que je m’en moque : je méprise au plus haut point la culture de l’amour, que je considère être un piège pour les femmes. Les comédies romantiques me font horreur, toute idée du couple m’indiffère, même le sexe en fin de compte m’ennuie terriblement. « Il faut avoir pas mal baisé pour devenir anti-baise, et les SCUM sont passées par tout ça, maintenant elles veulent du nouveau 2Valerie Solanas, SCUM Manifesto, traduit de l’anglais par Emmanuèle de Lesseps, éditions La Nouvelle Société 1971. Dans ce brûlot misandre aujourd’hui culte, « SCUM » est l’acronyme de Society for Cutting Up Men (association qui veut castrer les hommes). « Les SCUM » désigne les femmes membres de ce club informel. » C’est vrai, la question sexuelle est pour moi réglée, lavraie transgression est de n’en avoir plus rien à foutre. Sainte Ovidie, vous dis-je. Mais au fond, je suis, comme tout le monde, animée par le besoin d’être aimée. Personne, fondamentalement, n’aime vivre sans attachement, sans valorisation à travers le regard de l’Autre, sans contact ni bienveillance.
Or, la multiplicité de mes identités fait obstacle à cet amour. Il ne me sert à rien de rencontrer qui que ce soit puisque la relation ne pourra se construire que sur des bases viciées. Tout reposera sur ce que l’on pourrait appeler une « erreur de casting » dans la grande parade de la séduction. Mon corps est un écran sur lequel chacun·e projette ses attentes et fantasmes. Il est un réceptacle malléable à souhait : le moi y est trop enfoui et flexible pour que l’on puisse le distinguer. Mon corps protège ce moi et en même temps il le rend à jamais inaccessible. Et même si j’acceptais de baisser la garde et, dans un moment de vulnérabilité, me laissais être vue telle que je suis, mon/ma partenaire détournerait le regard. Je le sais, je l’ai déjà vécu. J’ai déjà lu dans le regard de l’Autre cette déception, quand l’Autre réalise que je ne suis « que » ça. Que sans caméra ni micro je suis beaucoup moins drôle.
On ne me connaît pas et, au fond, on ne veut pas me connaître. Il me faut avoir la lucidité d’admettre que les dés sont systématiquement pipés. Mon amoureux·se repartira triomphant·e avec son trophée, il/elle pourra dire qu’il/elle m’a eue à sa pogne. Quête identitaire par mise en danger du corps et besoin insatiable d’amour sont chez moi une brûlure, un poison. Parfois j’imagine qu’une autre forme de validation, celle qui proviendrait de mon travail, pourrait cicatriser mes blessures intérieures, être le baume, l’antidote. Mais il n’y a pas de (ré)conciliation ni avec moi ni avec l’Autre : chercher sans cesse à être validée par le regard de cet·te Autre, c’est une poursuite idéaliste qui me conduit à ne plus savoir qui je suis.
Puisqu’on ne connaît réellement ni Éloïse ni Ovidie, puisqu’on me prive de ma propre histoire en racontant n’importe quoi, qu’on m’attribue même parfois des noms qui ne sont pas les miens (durant près de vingt ans, Internet m’a appelée « Éloïse Becht »), qu’on me fait tenir des propos que je ne tiens pas, qu’on sait mieux que moi ma ville d’origine et le métier de mes parents ; puisque je suis dépossédée non seulement de mon image mais également de mon parcours de vie, autant m’approprier la narration. Puisqu’on me raconte mal, autant me raconter moi-même.
À travers des livres, des romans graphiques, des documentaires, des podcasts, une série. Non pas pour qu’on me regarde « moi, moi, moi », mais pour qu’on me laisse reprendre possession de ce qu’on a distordu, déformé, piétiné, encensé. Et lorsqu’on s’adresse à moi dans la rue ou sur les réseaux sociaux pour me féliciter, je réponds un timide merci parce que tout cela me dépasse. Quand j’entends que mon travail s’invite dans l’existence d’autres femmes et dans ce qu’elles ont souvent de plus intime, cela me dépasse. Parfois des inconnues m’arrêtent pour me raconter leur viol, leur accouchement, leur épisiotomie mal suturée, la violence de leur conjoint. J’ai envie de les prendre dans mes bras et de les remercier pour leur confiance. Mais je me sens impuissante face à toute cette souffrance et j’aimerais leur dire qu’il y a erreur sur la personne, je n’arriverai pas à les sauver. Comment les aider alors que moi-même tous les matins je me demande qui je suis ?
La légitimation, un drôle de processus
Certes, en vingt ans, la putain en a parcouru, du trajet. C’est curieux, d’ailleurs, la légitimation est un drôle de processus. Un jour on vous empêche de poursuivre vos études parce que vous êtes Ovidie, la féministe prosexe de service qu’on voit à la télévision, vos professeur·es vous font des remarques déplacées, des étudiants vous menacent de viol correctif dans les couloirs de la faculté. Et vingt ans plus tard, on vous attribue la qualification au grade de maîtressede conférences.
Tiens, en parlant de validation par le travail, le plus drôle reste quand même mon sujet de thèse : « Se raconter sans se trahir, l’autonarration à l’écrit et à l’écran ». Vous me croyez si je vous dis que je ne l’ai pas choisi consciemment ? Que je me suis menti à moi-même au point de me faire croire que ce sujet en valait bien un autre et que j’aurais tout aussi bien pu prendre « la génétique balzacienne des manuscrits » ? Que j’ai réussi à me persuader que je travaillais sur un corpus qui n’avait rien à voir avec ma propre histoire ? Allô Freud, laisse tomber tes théories sexistes toutes moisies et viens te pencher deux secondes sur mon cas parce que c’est vraiment trop cocasse.
Jugée sur sa vie et non sur la qualité de ce qu’on produit
Encore une fois, il m’a fallu me cacher derrière quelqu’un d’autre, non plus Ovidie mais des auteur·ices à travers lesquel·les je n’ai finalement fait que m’exprimer. J’ai passé quatre années à enculer les mouches en travaillant sur l’autofiction, qui consiste à se raconter, littéralement se fictionnaliser, et par conséquent offrir une vision subjective et nécessairement modelée du réel. À dire « c’est moi, mais c’est pas moi ». J’ai passé quatre années à mettre le sujet à distance sans même réaliser que j’en étais moi-même le cœur, que j’étais embourbée depuis des années dans des œuvres autonarratives sans l’admettre. Comme si mes films et mes écrits détenaient leur propre vérité, cette vérité que je ne cesse d’estropier plus que je ne la décalque. Même lorsque mon travail filmique colle à ma vie, il s’agit d’un univers à part, régi par ses propres lois. Je ne cesse de hurler à la terre entière qu’il doit être jugé comme tel. Même quand je dis « je », je vous assure que, non, ce n’est pas moi. Lorsque je filme, lorsque j’écris, je crée un univers parallèle, un monde fictif proche du réel, une relation spéculaire avec moi-même ; j’élabore un imaginaire dans lequel je m’observe, je me distords, et sans doute aussi dans lequel je soulage mes souffrances.
À ce stade, je n’arrive pas à savoir si ça me rend folle ou si ça me sauve. Car l’autonarration est un piège, tout particulièrement lorsqu’on est une femme. On est alors jugée sur sa vie et non sur la qualité de ce qu’on produit. Une fois qu’on commence à se raconter, ce n’est plus la forme de l’objet, ses qualités filmiques ou son éventuelle richesse littéraire qui intéressent. La grande question devient : « Ah bon, ça vous est vraiment arrivé ? » Et si le pacte biographique est rompu, alors ça hurle à la tromperie sur la marchandise. Comme si nous étions redevables d’une vérité factuelle, comme s’il fallait impérativement livrer nos existences jusque dans les moindres détails. Nous ne sommes plus des autrices ni des réalisatrices, nous sommes des expériences que l’on commente. La philosophe Geneviève Fraisse me confiait un jour sa lassitude de voir sa vie plus commentée que sa pensée : « On s’intéresse plus aux femmes pour leur parcours que pour leurs écrits. » C’est vrai.
Et pourtant, voilà que je retombe encore une fois dans ce piège que je me tends à moi-même : à travers ce texte, ne suis-je pas, là encore, à me raconter ? Mais quelle andouille je suis, à geindre de devoir parler de moi alors que je ne fais que ça, tout le temps. Et dire qu’on ne me l’a même pas demandé ! Comble de l’hypocrisie ! Non pas une hypocrisie envers celles et ceux qui me lisent, mais une filouterie d’Ovidie à cette pauvre sotte d’Éloïse, qui réfléchit lentement, qui a toujours un métro de retard et qu’on dupe avec une facilité déconcertante. Car Ovidie est bien plus maline qu’Éloïse. Éloïse est une universitaire ratée, un doctorat tardif, quelques publications scientifiques insignifiantes. Rien de bien brillant. Éloïse regarde ses pompes lorsqu’elle s’exprime, peine à faire des phrases construites. Confiez un micro à Ovidie, mettez-la en pilote automatique et elle parlera durant des heures, s’improvisera experte de tout, de rien, elle emballera d’un beau papier cadeau le néant de sa pensée, et le pire c’est qu’elle le fera avec aisance. Ah ! c’est facile de briller sur un tas de fumier, mais c’est plus dur lorsqu’on commence à graviter dans une sphère où les autres ont du talent. Tiens, est-ce que je ne couverais pas un petit syndrome de l’impostrice par hasard ? Ho ho, ça y ressemble bien ! Est-ce que mes collègues hommes se posent autant de questions ? Hum ! j’en doute.
Éloïse regarde ses pompes lorsqu’elle s’exprime, peine à faire des phrases construites. Confiez un micro à Ovidie, mettez-la en pilote automatique et elle parlera durant des heures.
Ma fille réconcilie tout, la maman comme la militante
Mais alors, comment dans tout ce merdier parvenir à retrouver mon identité d’origine et accéder à mon moi véritable ? Il n’y a que la mort, dans son implacable retour à la réalité du corps, qui me permettra de redevenir Éloïse. J’ai beau fantasmer une agonie théâtrale d’héroïne romantique, il n’y a que dans la rigidité cadavérique que je m’affranchirai de toute représentation. Quitter la spectacularisation et revenir à la réalité du corps.
Sauf que… De nouveau le problème se posera, cela n’en finira jamais. Car sur ma tombe, qu’écrira-t-on ? Qui assistera à mon incinération ? Est-ce le cercueil d’Éloïse ou celui d’Ovidie qui disparaîtra dans les flammes ? C’est bien à deux personnes différentes qu’il faudra dire adieu. Et de nouveau le malentendu se produira, le temps d’une cérémonie où chacun·e adressera un dernier au revoir à un corps sans vie, surface de projection d’une personnalité fantoche, mannequin de cire sur lequel ont été projetées des images. La fille, la pute, l’intello de pacotille, et quoi d’autre ? Puisque ce ne peut-être l’épouse, toutes les catégories sont là, il n’y en a pas d’autres, une femme ce n’est rien d’autre que ça paraît-il. Et la mère dans tout ça ? S’il y a une putain, comme dit Jean Eustache 3En 1973, le cinéaste Jean Eustache réalise La Maman et la Putain, son plus célèbre film, qui met en scène un triangle amoureux, il y a bien une maman quelque part, non ?
« Et ta fille, comment elle l’a pris quand elle a su que t’étais Ovidie ? » Comment elle a pris quoi, bande de vautours ? Je sais, vous auriez aimé pouvoir vous repaître de ma chair meurtrie et du désespoir de ma progéniture. On m’avait prédit le pire, on m’avait même suggéré de me faire stériliser. C’est drôle tout de même : alors qu’on empêche en général les femmes de se faire ligaturer les trompes, moi on m’a signifié que ce serait bien que je le fasse. Je n’avais que 22 ans, je n’étais même plus actrice, mais il fallait qu’on me punisse. Il fallait m’empêcher de me reproduire. L’eugénisme des putains. Mais c’était pour mon bien et celui de mon enfant, comprenez-vous. Jamais aucune fille ne supporterait d’avoir une telle mère : « À l’école, on se moquera d’elle, dans la cour de récréation. »
Sauf que, justement, s’il y en a une qui n’en a rien à braire, de cette histoire de double identité, c’est bien ma fille. Parce qu’elle est celle qui réconcilie tout, celle qui aime autant la maman qui lui a lu 352 fois Tchoupi va sur le pot que la militante à qui elle raconte aujourd’hui ses manifs. Celle qui me fait un peu moins détester Éloïse et Ovidie. Celle qui ne fait pas de différence entre la personne qui lui dit « Range ta chambre ! » et la réalisatrice de documentaires qui passe des mois enfermée en salle de montage. Parce que, au fond, ma fille sait que tout cela n’est pas une mascarade, loin de là, et qu’elle voit ce qu’il en coûte d’accoucher de chaque nouveau film et de partir au combat. « Maman, pour moi t’es Santa Maria de la baston. »
« Santa Maria de la baston ». Voilà, c’est ça, merci, ce sera ça, mon nouveau nom de guerre à l’avenir. •
1980
Naissance à Lille d’Éloïse Delsart.
1999
Elle devient travailleuse du sexe sous le nom d’Ovidie.
2000
Réalisation de fictions porno-féministes pour Canal+.
2002
Elle publie Porno manifesto (Flammarion), dans lequel elle défend le féminisme prosexe.
2010
Réalisation du documentaire Rhabillage pour France 2.
2018
Prix Amnesty International au Festival du film de Thessalonique et finaliste du prix Albert-Londres pour le documentaire Là où les putains n’existent pas.
2020
Éloïse Delsart devient docteure ès lettres.