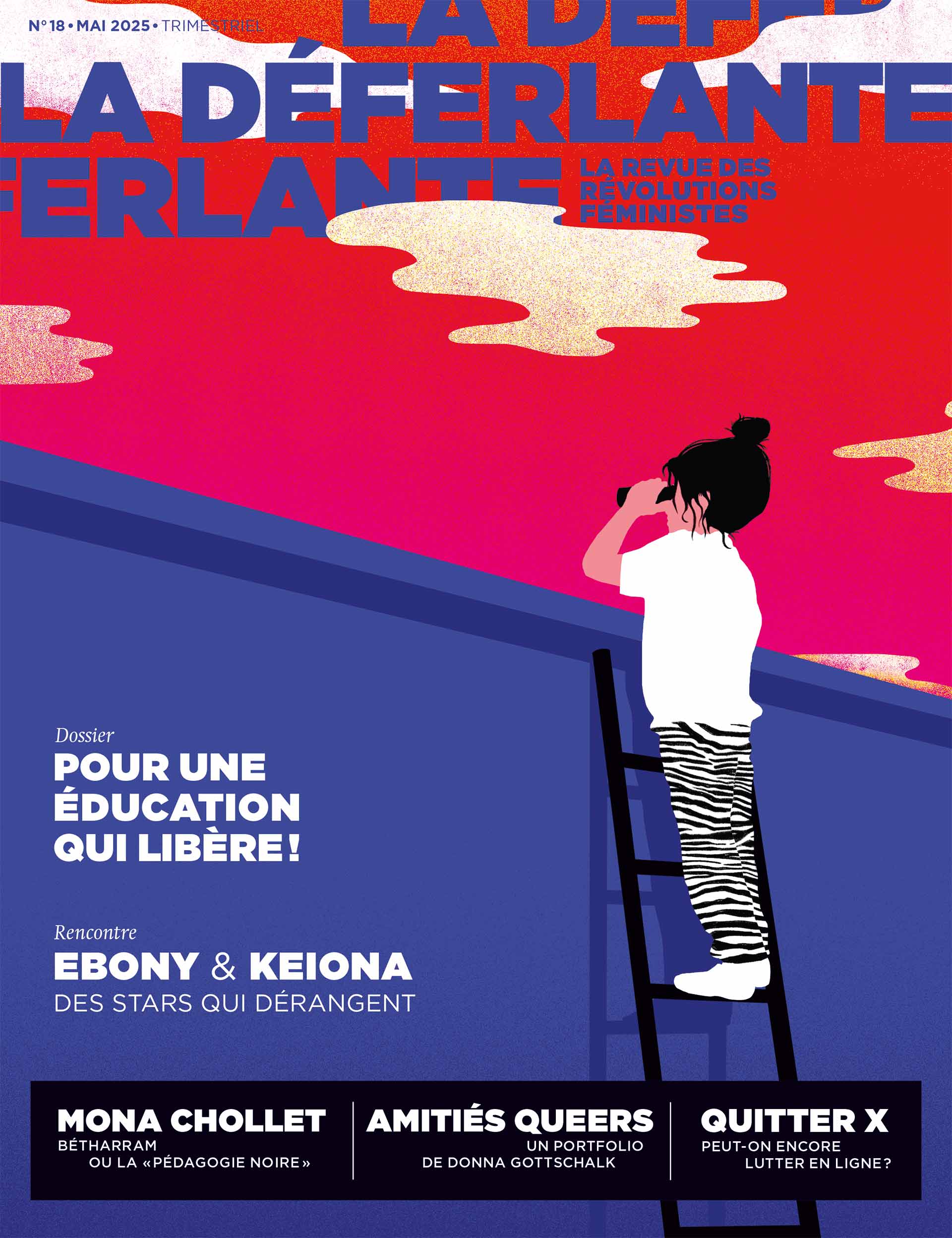Les mères des quartiers populaires sont souvent décrites comme « démissionnaires » mais vous observez une réalité bien différente…
Il n’y a pas de « démission » : nous sommes plutôt face à des mères qui sont mobilisées dans un important travail de care1Consultez notre glossaire auprès des enfants et des autres membres de la communauté, mais qui n’est pas valorisé aux yeux de l’institution scolaire. Ces mères sont considérées comme des parents invisibles car elles n’ont pas les codes scolaires qu’a identifiés le sociologue Pierre Périer : la bonne distance vis-à-vis de l’enseignant·e, le fait d’accompagner les devoirs, de prendre part à la vie de l’école de la « bonne » façon.
Comment s’impliquent-elles dans le cadre scolaire ?
Dans la relation asymétrique qui se noue avec l’institution scolaire, elles sont dans un mouvement de va-et-vient. Elles ne répondent pas forcément aux rendez-vous en face-à-face avec les enseignant·es, car cela peut être un moment douloureux : souvent convoquées pour que soient évoquées les difficultés que pose l’enfant, elles craignent de ne pouvoir se défendre. Beaucoup parmi les mères que j’ai interrogées m’ont dit « Comme je ne parle pas bien français, les gens pensent que je suis bête. » Mais elles participent aux sorties pédagogiques et aux cafés des parents, car le fait d’être bien perçues dans l’espace scolaire est valorisant. Cette oscillation leur permet de conserver une forme de dignité. Pour ces femmes discréditées dans l’espace public, dévalorisées au travail, les enjeux de reconnaissance par l’institution scolaire sont fondamentaux.
Quel est le positionnement des enseignant·es à leur égard ?
Certain·es enseignant·es ont des discours défaitistes sur les parents et une vraie incompréhension de leur vécu. La « barrière de la langue » est souvent invoquée, mais celle-ci est dépassable si on veut que la rencontre se fasse.
Les travaux du psychosociologue Jean Epstein ont montré que des relations positives entre les différents milieux de vie des enfants avaient des effets favorables sur leur scolarité, et on assiste ces dernières années à une vraie promotion de la coéducation2La « coéducation » renvoie à une relation partenariale entre enseignant·es et parents, dans la perspective d’une meilleure réussite des élèves.. Celle-ci implique d’accepter les parents tels qu’ils et elles sont, et de sortir d’un ethnocentrisme sur les codes qu’ils et elles devraient avoir. L’Éducation nationale ne se concentre que sur le disciplinaire et la didactique des matières fondamentales – lire, écrire, compter –, et propose peu de formations sur les relations aux parents.
Comment les normes de genre influencent-elles cette relation ?
C’est un cadre qui demeure stéréotypé. Souvent, les équipes éducatives s’adressent aux pères seulement quand il y a un problème sérieux avec l’enfant ou pour tout ce qui est jugé important, comme la question de l’orientation. Elles le font en considérant qu’il faut impliquer les pères, mais ça peut être mal vécu par ces mères qui portent la famille au quotidien. Cela pose un problème quand on fait intervenir des figures paternelles qui sont habituellement absentes, qui ne versent pas la pension, voire commettent des violences conjugales.
Comment expliquez-vous l’émergence de collectifs comme Front de mères, qui cherchent à redéfinir la relation entre les institutions et les mères des quartiers populaires ?
Actuellement, la conscience des injustices est palpable. Dans les discussions qui ressortent des cafés des parents auxquels j’ai assisté récemment en Île-de-France, il y a beaucoup de colère contre les institutions. Nous sommes face à des femmes qui, ayant effectué elles-mêmes toute leur scolarité en France, maîtrisent davantage ces codes qui pouvaient échapper à leurs parents immigré·es ou aux femmes immigrées qui subissent beaucoup de violences sociales et symboliques. Elles font le constat de promesses d’ascension sociale et d’intégration non tenues malgré les efforts fournis. •
Entretien réalisé en visioconférence le 13 janvier 2025 par Sarah Bos, journaliste indépendante.