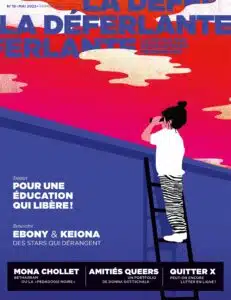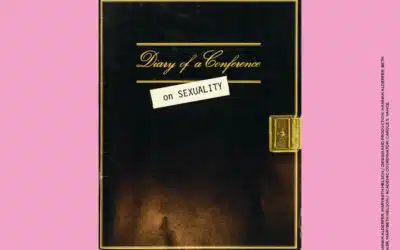Les travailleur·euses du sexe ou TDS sont des personnes qui exercent la prostitution pour gagner leur vie. Le terme anglais sex worker est apparu à la fin des années 1970. Il a été forgé par la militante féministe pro-sexe et écrivaine californienne Carole Leigh qui considérait que le mot « prostituée » était stigmatisant et connoté négativement. L’emploi de l’expression « travail du sexe » permettait également d’élaborer des stratégies d’alliance pour les personnes travaillant dans les industries du sexe. Aujourd’hui encore, l’usage du terme « travail du sexe » fait débat. Certaines féministes y voient une euphémisation de la prostitution, qui est à leurs yeux une violence genrée spécifique dont il faut réclamer l’abolition. D’autres estiment que le terme permet de décrire une situation de fait : l’exercice d’une activité rémunératrice. Pour les personnes concernées qui l’utilisent, il revêt également une forte dimension identitaire.
Celles et ceux qui exercent cette activité, fortement réprimée et précarisée, ne bénéficient pas des mêmes droits que le reste de la population active française : absence de protection sociale, de revenus décents, de droit au logement, de droit à la retraite, etc. Depuis décembre 2024, les travailleur·euses du sexe belges, au contraire, bénéficient des mêmes droits et avantages sociaux que les autres : contrats de travail leur ouvrant des droits à l’assurance maladie, à la retraite et aux congés payés, de maternité ou de maladie. Les travailleur·euses du sexe font par ailleurs face à des violences spécifiques à leur profession, contre lesquelles ils et elles ne sont pas protégé·es : vols, agressions, agressions sexuelles, viols, assassinats, etc.
Dans l’article « Des travailleuses du sexe privées de droit » de La Déferlante, la journaliste Sarah Bos donne la parole à des travailleur·euses du sexe à Toulouse et à Paris. Tous·tes relatent des conditions d’exercice difficiles dans un climat légal et social très répressif. Sandra assure « bien vivre de son travail », mais explique devoir mettre en place des mécanismes de protection face au danger potentiel que certains clients représentent. L’article revient aussi sur les incohérences juridiques auxquels sont confronté·es les travailleur·euses du sexe : « Les TDS payent des impôts, mais leur situation administrative tient du casse-tête : ils et elles ne peuvent que difficilement louer un logement, puisque leur propriétaire peut alors être poursuivi·e pour proxénétisme hôtelier. »
Pour aller plus loin
Océan, « La politique des putes », Nouvelles écoutes, mars 2020
Charlotte Bienaimé, « Le prix du sexe », Un podcast à soi, Arte Radio, février 2