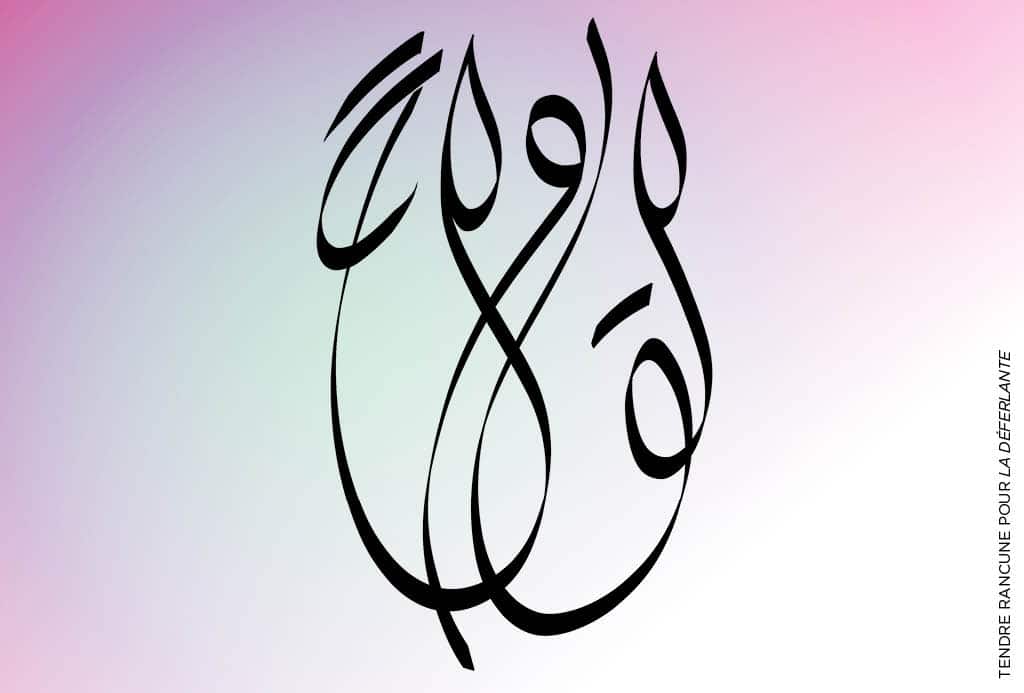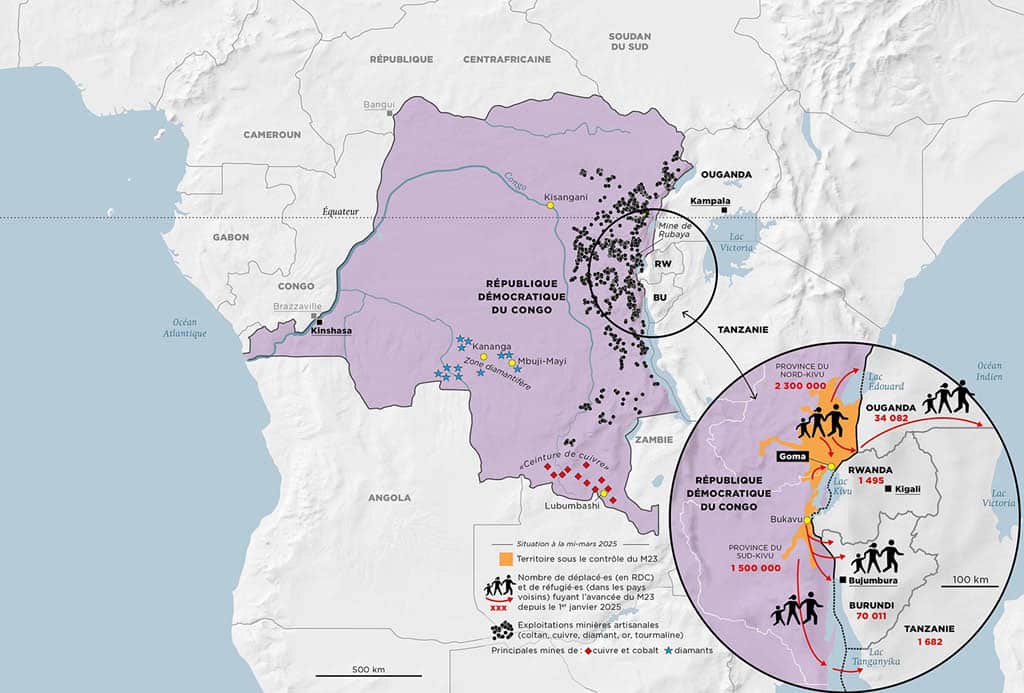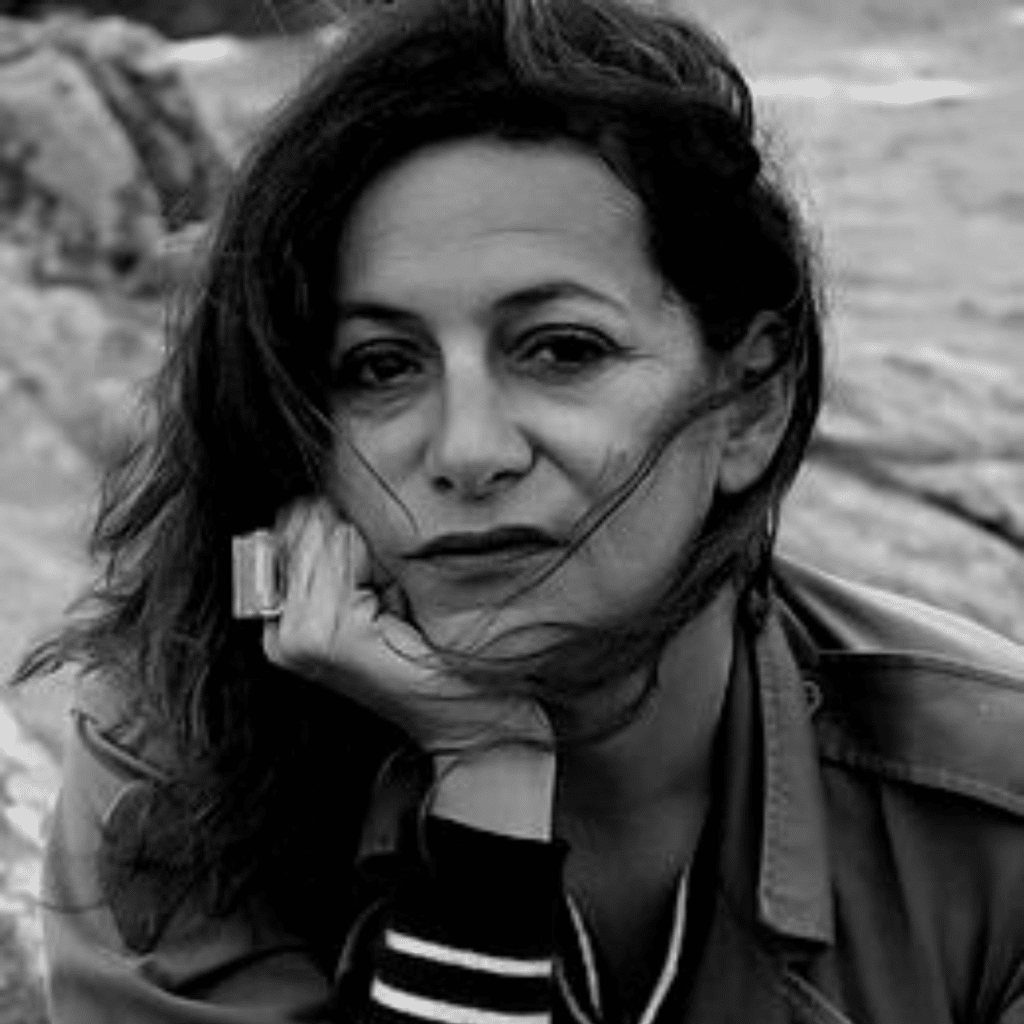Wafa’ Abdel Rahman court après le temps, mais au fond ça l’arrange. Ça lui évite de ressasser. Sa silhouette alerte, en robe et bottes noires, passe d’un bureau à l’autre dans les locaux de Filastiniyat (« palestiniennes » en français).
L’organisation qu’elle dirige est une sorte d’incubateur qui forme et publie des journalistes palestinien·nes, principalement des femmes, mais aussi des jeunes reporters et reportrices. Par la fenêtre, on aperçoit les collines de Ramallah, au centre de la Cisjordanie, dénaturées par presque trente ans d’urbanisation anarchique, depuis que la ville est devenue le siège de l’Autorité palestinienne au milieu des années 1990 (lire l’encadré ci-dessous). Dans les bureaux, les écrans diffusent en direct des images de destruction de Gaza, l’autre partie des territoires palestiniens occupés par Israël depuis 1967. Des corps sont extraits des décombres ; des Gazaoui·es courent dans le chaos après un bombardement ; des vidéos de propagande montrent d’un côté des soldat·es israélien·nes et de l’autre des combattants des brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas, s’affrontant dans des rues devenues d’immenses champs de ruines. Depuis le 7 octobre 2023, la mort dévaste l’enclave palestinienne. Wafa’ y est née, elle y a de la famille, des collègues. Israël mène à Gaza « une guerre génocidaire », assène-t-elle. Début novembre, sept expert·es de l’ONU alertaient déjà : « Le peuple palestinien court un grave risque de génocide. »
Wafa’ demande à un collègue de prendre des captures d’écran du compte X de l’ONG, pointant des messages de menaces émanant de « groupes sionistes ». « On les bloque, mais ce serait bien de garder des traces. Je n’y accorde pas trop d’attention, mais clairement, ça fait peur. » Tout au long de la conversation, la Palestinienne de 51 ans oscille. Parfois, son franc-parler et ses traits d’humour typiquement gazaouis prennent le dessus. Puis la colère transpire, sa voix de fumeuse, énergique, s’étiole un peu, trahissant l’angoisse abyssale qui ne la quitte plus depuis le 7 octobre. Après les massacres commis par le Hamas et des combattants palestiniens en Israël, puis le carnage des bombes israéliennes en représailles sur Gaza, il y a d’abord eu le choc. Les premiers jours à pleurer, à appeler la famille. « J’étais brisée. On n’arrivait à rien faire. C’était trop dur », se souvient Wafa’. Au bout d’une semaine, elle a contacté les journalistes sur place : les 400 femmes du club que Filastiniyat tient à Gaza, et elles ont lancé un fonds d’urgence. « Au moins, j’ai eu le sentiment que je n’étais plus juste spectatrice. »

La charge de l’information repose sur les palestinien·nes
Wafa’ a créé Filastiniyat en 2005, en Cisjordanie d’abord, avant de l’implanter aussi à Gaza en 2009. À l’époque, la jeune femme, qui a fait des études de politique et développement aux Pays-Bas, militait dans les organisations féministes et de jeunesse. « En Palestine, la question du féminisme et des rapports de genre est très contrainte par la situation coloniale », analyse Flora Gonseth Yousef, doctorante en sociologie à Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, dont la thèse porte sur l’activisme des femmes dans les mobilisations anticarcérales palestiniennes. Wafa’ abonde. Les discriminations de genre ne sont pas propres à la société palestinienne, dit-elle : « C’est un système qui ronge tout le monde arabe. Le monde entier, en fait ». Sauf qu’en plus, précise-t-elle encore, « moi [en tant que Palestinienne], je fais face à une occupation qui menace ma présence ».
Les journalistes palestinien·nes documentent la violence de cette situation coloniale. En près de vingt ans, l’ONG de Wafa’ en a formé des centaines, à qui elle fournit aussi du matériel. Filastiniyat travaille avec un réseau de pigistes dont elle diffuse le travail à travers des partenariats et via son agence de presse interne, Nawa. « Avant cette guerre génocidaire, les femmes journalistes réclamaient du soutien psychologique et des formations », souligne Wafa’. Dans l’enclave sous blocus depuis 2007, il était quasi impossible d’avoir accès à des mentors venus d’ailleurs, de se renouveler au contact d’autres cultures. En plus de cela, la guerre rôdait, et dévastait l’enclave à intervalles réguliers. En Cisjordanie, les journalistes couvrent régulièrement enterrements et affrontements. Les crimes commis par l’armée israélienne font rarement l’objet d’enquêtes et sont encore moins véritablement sanctionnés. Tout cela laisse des marques.
Aujourd’hui, Filastiniyat fournit une aide matérielle nécessairement insuffisante à Gaza : des cartes SIM virtuelles d’opérateurs étrangers pour contourner le blocage des communications, une tente pour que les femmes journalistes aient un peu d’intimité… Depuis le 7 octobre, la bande de Gaza est fermée aux journalistes étranger·es. Rapidement après le début de la guerre, les organisations de défense des droits humains ont aussi cessé d’envoyer leurs chercheur·euses sur le terrain, estimant que c’était trop dangereux. « Les seul·es qui documentent aujourd’hui ce qui se passe sont les journalistes palestinien·nes, sous les bombardements constants », martèle Wafa’.
Une guerre contre les journalistes
Derrière ses écrans à Ramallah, Bara’ Alqadi, le responsable des réseaux sociaux âgé de 31 ans, réceptionne leurs productions. Casquette noire vissée sur le crâne, il choisit ses mots avec soin. On sent une rage sourde en lui. Le travail des journalistes, malgré les conditions, est d’une qualité « exceptionnelle », souligne-t-il à plusieurs reprises. Certaines ne sont pas rentrées dans leur famille depuis des semaines. « Elles risquent d’être visées jusque dans leur maison. Parfois, elles mettent leurs enfants quelque part et ne viennent plus les voir, de crainte que l’endroit soit bombardé parce qu’elles s’y trouvent. Ce ne sont pas des peurs sans fondements, c’est déjà arrivé », insiste le jeune homme, ses grands yeux noirs se détachant un instant des écrans. Il cite l’exemple de Roshdi Sarraj (1), journaliste très connu à Gaza, qui collaborait avec plusieurs médias français, ou Sari Mansour et Salim Hassouneh (2) qui travaillaient pour l’agence de presse locale palestinienne Quds News Network. Chaque fois, « seul l’appartement où ils se trouvaient a été visé, pas le reste de l’immeuble, précise Bara’. Dans les manifestations en Cisjordanie, les reporters et reportrices qui se mettent sur le côté sont malgré tout pris·es pour cible. Ce n’est pas nouveau que les Israélien·nes visent les journalistes pour les tuer ». Le jeune homme retourne à ses écrans ; une des journalistes vient de lui envoyer un message personnel. Les bombardements sont intenses, elle n’arrive pas à travailler, s’excuse-t-elle. Bara’ est aussi parfois le dépositaire de ce que les journalistes ne peuvent confier à leurs proches, pris·es elles et eux aussi dans l’horreur de la guerre.
« J’ai été réveillée par la voix de mon enfant qui réclamait un bout de pain. Je n’avais rien à lui donner mais il ne me croyait pas. Il a crié plus fort et les autres se sont réveillés, ils se sont mis à chercher un quignon qui aurait été oublié dans un coin de la cuisine. Comment Omar, 4 ans, peut-il comprendre qu’Israël nous affame ? » Dans un arabe très imagé, la journaliste gazaouie de Filastiniyat Marah Elwadiya décrit en détail, dans une série de messages envoyés sur WhatsApp à La Déferlante, son quotidien enfermé dans la peur, la faim et le traumatisme. Sur sa page Instagram, avant les photos prises pendant la guerre, apparaît une tout autre Gaza. Des portraits de Marah, souriante, son voile élégamment assorti à ses tenues, avec son mari ou son fils, à la plage, à la piscine. Un café plein à craquer où femmes et hommes bondissent de leurs sièges pour applaudir la victoire du Maroc à un match de la Coupe du monde 2022. Au milieu de ces images heureuses surgit déjà aussi une vidéo de son fils effrayé par un bombardement lors d’une offensive israélienne sur Gaza en mai 2023.
Marah a commencé à étudier le journalisme en 2008. Le 27 décembre cette année-là, Israël lance sa première opération militaire d’ampleur contre Gaza après l’arrivée du Hamas au pouvoir en 2007. « Depuis, c’est comme si j’étais née dans la guerre », nous dit-elle. Début décembre, elle en était à son sixième déplacement forcé (3) en deux mois. « Travailler ici relève du jamais-vu. Il n’y a pas d’électricité, ni Internet, aucun transport, pas de moyens de communication ou d’équipements de sécurité adéquats. C’est lourd et douloureux aussi d’un point de vue émotionnel. Nous vivons les histoires que les gens partagent avec nous comme si elles étaient les nôtres, nous entendons les détails de chaque perte. Le deuil d’enfants, de pères, de mères, de frères et de sœurs. Des foyers emportés. Nous mémorisons les histoires des disparu·es et nous encaissons. »

Les journalistes Hala Asfour (à gauche) et Bouthaïna Harara (à droite) devant l’hôpital Nasser. La première est indépendante, la seconde travaille pour un média jordanien. Blessée par un tir d’obus et plusieurs fois évacuée, Bouthaïna Harara couvre le conflit dans les hôpitaux.
Travailler dans la peur
Comme tous·tes les Gazaoui·es, les journalistes vivent ce deuil permanent dans leur chair ; certaines journalistes de Filastiniyat ont perdu des membres de leurs familles. « Je suis une survivante accidentelle de la spirale de la mort orchestrée par Israël qui nous enserre », constate Marah. Sa consœur Bouthaïna Harara (en photo page 9), une journaliste indépendante qui fait également partie du réseau Filastiniyat, a été blessée avec son mari et ses trois enfants dans un tir d’obus qui a touché la maison où elle était réfugiée à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Elle a dû fuir une nouvelle fois avant d’atterrir à Rafah, à la frontière égyptienne – sa neuvième évacuation en deux mois.
« J’ai la trentaine, et mes cheveux blanchissent déjà du fait de la peur et de tout ce que j’ai vu en photographiant les horreurs des crimes de l’occupation israélienne », écrit-elle dans un long message à La Déferlante. Bouthaïna couvre le conflit dans les hôpitaux, rapportant l’effondrement du système de santé : visé par les attaques israéliennes et incapable de faire face à l’afflux constant de blessé·es graves. Quand elle est sur le terrain, elle est rongée par l’angoisse que les sien·nes meurent dans un bombardement loin d’elle.
« Il existe un savoir qui a été construit par les féministes palestiniennes, capables d’aller chercher la transformation là où elle est possible. »
Flora Gonseth Yousef, doctorante en sociologie à Paris 8
« À cause de la peur, mes règles sont devenues douloureuses, mon cycle menstruel me fatigue beaucoup », confie-t-elle. Mi-novembre, une autre journaliste gazaouie, Hind Khoudary, twittait déjà : « Trois de mes amies et moi-même avons eu nos règles deux fois en 42 jours. Nous sommes stressées, frustrées et angoissées. » Trois semaines plus tard, elle rapportait qu’elle ne trouvait plus de serviettes hygiéniques. Bouthaïna fait la queue pour accéder à la salle de bains dans les appartements ou les abris qui débordent de déplacé·es. L’eau se fait rare. Elle passe des jours sans pouvoir prendre une douche, elle ne peut pas laver ses vêtements. Il n’y a plus d’analgésiques, elle n’a rien sous la main pour soulager les crampes menstruelles.
Ces récits font écho aux témoignages recueillis à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, par la chercheuse palestinienne Nadera Shalhoub-Kevorkian lors de la seconde intifada (2000–2005). Pendant l’invasion de l’armée israélienne, ouvrir les fenêtres signifiait possiblement s’exposer aux tirs ; bouger d’une pièce à l’autre était dangereux. Une Palestinienne racontait s’être retrouvée coincée avec sa belle-fille qui saignait abondamment après son accouchement et avec d’autres femmes qui avaient leurs règles. La pièce avait été envahie par l’odeur du sang. « Je savais personnellement qu’être une femme était une malédiction, mais je n’imaginais pas que c’était à ce point », avait-elle conclu.

La reportrice indépendante Hala Asfour documente les conditions de vie des femmes déplacées par la guerre. Ici dans les camps près de l’hôpital Nasser. Entre le 7 octobre et la fin novembre 2023, près de 800 000 femmes et enfants avaient été déplacé·es dans la bande de Gaza.
Une « violence coloniale de genre »
Israël exerce une « violence coloniale de genre » contre les Palestiniennes, souligne Flora Gonseth Yousef, qui rapporte par exemple que les prisonnières n’ont pas accès à des consultations gynécologiques. À Gaza, les femmes sont quasiment absentes des rangs des combattants du Hamas qu’Israël a désignés comme sa cible. Pourtant, depuis le 7 octobre, elles sont « surreprésentées parmi les mort·es », remarque la chercheuse. Elle dénonce une situation « aux dimensions apocalyptiques. Les accouchements par césarienne sans anesthésie, la condition de réfugiée qui, on le sait, aggrave les violences de genre. Alors que sur l’offensive [du Hamas] du 7 octobre, il y a déjà plein de discours qui disent : “Il faut prendre en compte les crimes qui ont été spécifiquement commis contre les femmes”, ça m’interpelle que, dans le contexte de Gaza, ces dimensions-là, qui rendent un conflit plus horrible, soient invisibilisées, notamment par des organisations qui sont censées avoir comme priorité le droit des femmes. »
Plus globalement, la sociologue critique l’approche des États et institutions étrangères qui financent en partie la société civile palestinienne, notamment les mouvements pour les droits des femmes. Ils ont eu tendance à « dépolitiser tout le secteur associatif, parce qu’ils ont bien compris combien ce secteur a été à la pointe de la lutte et des mobilisations collectives pendant la première intifada », explique-t-elle. La plupart des bailleurs vont ainsi individualiser la question féministe en Palestine, notamment pour éviter de l’aborder dans le contexte plus large de la violence coloniale israélienne et de son impact sur les femmes : « On ne va parler que de la violence intra-palestinienne et cela va donner une image peu reluisante de la société palestinienne. » Cette dernière est, à de nombreux égards, conservatrice. Mais « on ne peut pas comparer le conservatisme palestinien avec le conservatisme aux États-Unis, note encore Flora Gonseth Yousef. Ce ne sont pas les mêmes dynamiques politiques et sociales. On est dans une société de la survie, en proie à une violence extrême. » Qui doit, d’une certaine manière, se conserver pour ne pas disparaître sous la domination coloniale. « Il faut voir ce qui bouge de l’intérieur. Il existe un savoir qui a été construit par les féministes palestiniennes, capables d’aller chercher la transformation là où elle est possible », conclut la chercheuse.
À Ramallah, Wafa’ connaît bien les ambivalences de ces bailleurs occidentaux. Alors qu’elle remballe ses affaires, elle emporte avec elle une énième demande de financement d’urgence qu’elle remplira probablement dans la nuit au lieu de dormir. « Partout dans le monde, les femmes doivent se battre au sein de leur société. Mais les Palestiniennes doivent se battre contre d’autres stéréotypes. Dans le monde arabe, on nous identifie comme les mères et les sœurs des martyrs et des prisonniers… Ils nous voient comme des héroïnes parce qu’on appartient à des hommes héroïques. En Occident, on veut nous appliquer les programmes [de déradicalisation] qu’on met en œuvre en Égypte ou en Syrie, voire en Afghanistan. Mais le combat palestinien est spécifique du fait de l’occupation ! », explique-t-elle. Elle hausse la voix en reprenant les clichés orientalistes qu’elle sent peser sur ses épaules depuis des décennies – celui de la femme arabe, forcée de porter le voile, prisonnière de son foyer. Puis elle ajoute fièrement : « Je suis là, moi, musulmane, palestinienne, arabe. Et pourtant, je suis arrivée à un point où, peut-être, des milliers de femmes en Occident ne sont jamais parvenues. » •
Reportage réalisé par Clothilde Mraffko à Ramallah en décembre 2023. Journaliste installée à Jérusalem, elle observe les transformations de la société palestinienne en Cisjordanie, à Gaza, en Israël et dans la diaspora. Elle collabore au Monde et à Orient XXI. Ce reportage a été édité par Diane Milelli. La Déferlante remercie Bara’ Alqadi, Éléonore Fallot et Anne Roy pour leur aide.
Reportage photo réalisé par Hala Asfour, journaliste palestinienne indépendante. Depuis le début de la guerre qui ravage Gaza, elle documente le sort des déplacé·es, basée à l’hôpital Nasser, à Khan Younès, dans le sud de l’enclave. Elle fut assistée de Mohammad Salama pour La Déferlante le 24 décembre 2023 à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.
75 ans d’occupation
En 1948, plus de 700 000 Palestinien·nes sont expulsé·es lors de la création de l’État d’Israël. À partir de 1967, après la guerre des Six Jours, Israël occupe Gaza et la Cisjordanie dont Jérusalem-Est, et y installe ses habitant·es en créant des colonies, en violation du droit international. Sur un même territoire, les Israélien·nes jouissent de la loi civile et les Palestinien·nes sont soumis·es à la loi militaire israélienne.
En 1987 éclate la première intifada, un soulèvement populaire palestinien violemment réprimé par l’armée israélienne. En 1993 sont signés les accords de paix d’Oslo, et l’Autorité palestinienne (AP) est créée, censée être un premier pas vers un État palestinien indépendant. Mais en 2000, l’échec du processus de paix débouche sur la seconde intifada, encore plus sanglante que la première.
En 2005, le Premier ministre israélien, Ariel Sharon, décide le retrait des troupes armées et des colonies israélien·nes de Gaza. Un an plus tard, le mouvement islamiste du Hamas remporte les élections législatives palestiniennes. En 2007, les factions palestiniennes se déchirent, et le Hamas prend le contrôle de Gaza.
L’AP, seul représentant des Palestinien·nes reconnu par la communauté internationale, gouverne sans pouvoir en Cisjordanie, où l’État d’Israël intensifie
la colonisation et la répression. À Gaza, l’État hébreu pense contenir le Hamas en alternant frappes militaires et allègements à la marge du blocus. Jusqu’au 7 octobre 2023, jour où les combattants du mouvement islamiste lancent une attaque sur le territoire israélien, y commettant des massacres et tuant 1 140 personnes.
(1) Roshdi Sarraj a été tué lors d’un bombardement de la ville de Gaza, le 22 octobre. Sa femme et sa fille de quelques mois ont été blessées.
(2) Sari Mansour, 32 ans, et Salim Hassouneh, 28 ans, ont été tués le 18 novembre dans un bombardement israélien sur le camp de réfugié·es d’Al Bureij, dans le centre de la bande de Gaza. Selon Reporters sans frontières, Salim Hassouneh avait reçu la veille une menace de mort liée à son travail.
(3) À plusieurs reprises l’armée israélienne a largué des tracts pour sommer la population gazaouie de se déplacer à l’intérieur de l’enclave, entraînant des évacuations répétées vers le sud dans des conditions de sécurité et de survie effroyables.