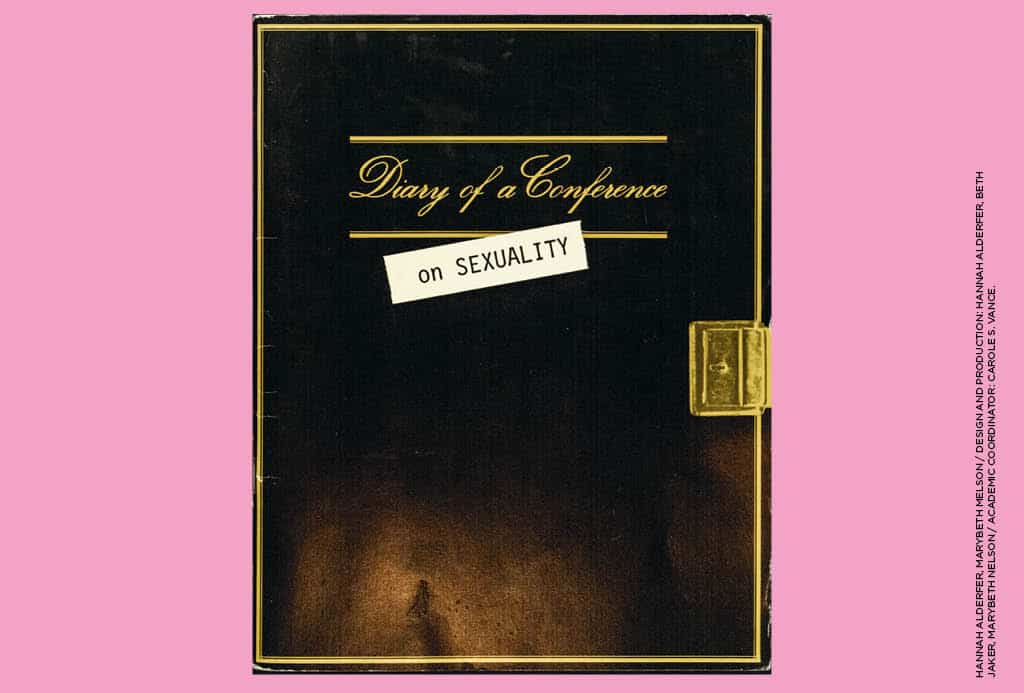Les slogans féministes sont tantôt des revendications, tantôt des pirouettes. Ce peuvent être des prénoms, des âges, des dates. Ou bien des chiffres, des apostrophes, des avertissements.
Les plus déstabilisants sont ceux qui prennent la forme d’un constat ou plutôt, comme ici, d’un rappel : « L’agresseur ne sonne pas, il a la clé ». Celui-là, nous ne l’avons pas découvert en manifestation, brandi sur une pancarte, mais en photo sur Internet, peint au pochoir sur le mur d’une ville anonyme. « Un slogan, c’est un acte efficace, décrypte Béatrice Fraenkel, anthropologue de l’écriture et coautrice de l’ouvrage collectif 40 ans de slogans féministes 1970/2020 (Éditions iXe, 2011). Mais à partir du moment où cela devient un énoncé écrit, à la formule s’ajoute la force qui se dégage de l’inscription. » Si les luttes féministes ont depuis longtemps investi les murs des villes pour faire passer leurs messages (graffitis, collages, pochoirs, affiches), ceux-ci sont désormais fixés pour l’éternité grâce aux nouvelles technologies, même après nettoyage : « Ce qui est nouveau par rapport aux années 1970, riches en slogans et en graffitis, c’est qu’aujourd’hui, dès qu’il y a une lutte, il y a tout de suite une campagne de photos et d’enregistrements. »
« L’agresseur ne sonne pas, il a la clé ». Le pochoir nous colle aux basques. On y repense souvent depuis qu’on l’a vu. On en parle autour de nous. Qu’a‑t-il de si particulier ? Comme bien d’autres slogans, impossible d’en déterminer l’origine. Béatrice Fraenkel voit dans la formule une « petite énigme à résoudre » qui fait son intérêt et son originalité : « On ne comprend pas tout de suite qu’il dénonce les violences conjugales, cela demande quelques secondes de réflexion. C’est rare, les slogans à deux temps ; d’habitude, ça percute immédiatement, c’est efficace. Celui-là est étrange, mais accrocheur ! »
Les dangers du foyer
L’expression est d’autant plus glaçante qu’elle énonce une vérité qui dérange. Les chiffres sont têtus : selon l’Office des Nations unies contre les drogues et le crime, sur les 87 000 femmes tuées en 2017 dans le monde, 30 000 l’ont été par leur actuel ou précédent partenaire. En France, selon le ministère de l’Intérieur, 213 000 femmes chaque année sont victimes de la violence de leur conjoint ou ex ; en 2021, 82 % des morts violentes au sein du couple concernaient des femmes, dont 35 % étaient déjà victimes de violences de la part de leur compagnon. Selon l’enquête « Virage » de l’Institut national d’études démographiques, en 2016, 47 % des violences sexuelles ont été commises par un compagnon ou ex-compagnon. C’est indiscutable : l’endroit le plus dangereux pour une femme est celui où elle habite.
« L’agresseur ne sonne pas, il a la clé » : le constat est insoutenable, car il heurte un stéréotype puissant, ancré dans l’imaginaire collectif, entretenu par les médias et la pop culture, celui de l’agresseur surgissant de nulle part.
Plus qu’un rappel des faits, ce « slogan » est révélateur d’un système séculaire qui impose et naturalise l’ordre patriarcal : impunité et toute-puissance pour les hommes, infériorité et assujettissement pour les femmes. De la Genèse (« Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi ») au droit coutumier du Moyen Âge, la loi consacre ce « droit de correction ». Au xiie siècle, les lois anglo-normandes enjoignaient à l’époux de « châtier » sa femme. Un ouvrage de droit français du xiiie siècle, les Coutumes de Beauvaisis, édicte que « les hommes peuvent être excusés de mauvais traitements envers leurs femmes, sans que la justice ait le droit de s’en mêler ». En 1804, Napoléon entérine, avec l’article 213 du Code civil, l’incapacité juridique des femmes, considérées comme mineures et placées, à l’instar des enfants, sous l’autorité du conjoint : « Le mari doit protection à sa femme, la femme, obéissance au mari. » Six ans plus tard, le Code pénal juge le meurtre d’une femme par son conjoint « excusable », s’il est commis lors d’un flagrant délit d’adultère au domicile conjugal.
Le caractère prétendument privé des violences domestiques explique aussi pourquoi la justice, qui condamnait pourtant ces affaires au civil, rechignait à les traiter au pénal : « À partir du xixe siècle, au moment où on codifie le droit et la société, on distingue ce qui relève du civil de ce qui relève du pénal. Or, on estime que ce qui relève de la famille, y compris les violences et sévices, doit relever du civil. On renvoyait donc au civil les femmes se plaignant d’un mari violent, pour qu’elles demandent le divorce », explique Victoria Vanneau, historienne du droit et autrice de La Paix des ménages. Histoire des violences conjugales, xixe-xxie siècles (Anamosa, 2016). Un tournant a lieu en 1825, quand la Cour de cassation rend l’arrêt Boisbœuf, qui juge que les articles du Code pénal sont applicables entre époux et épouses, et, plus précisément, que l’épouse a le droit de s’en revendiquer : « Cet arrêt marque l’invention juridique des violences conjugales. Ça devient, au niveau du pénal, une juste cause qu’il est nécessaire de considérer : protéger les conjointes victimes des coups. Mais on ne parle pas encore de “violences conjugales”, plutôt de maltraitements. Ça n’avait pas de valeur juridique ou sociale : c’était du fait-divers. »
Lire aussi : Histoire d’un slogan « Nos désirs font désordre »
Tout un système à reconfigurer
À la fin du xixe siècle, les féministes de la première vague, qui se battent pour l’égalité des droits et la réforme du Code civil, « évoquent déjà la tyrannie conjugale et la brutalité des hommes, mais ces violences ne sont pas constituées en objet politique à part entière », rappelle Pauline Delage, autrice de Violences conjugales. Du combat féministe à la cause publique (Presses de Sciences Po, 2017). Un siècle plus tard, leurs héritières des années 1970 brisent le tabou et dénoncent la tolérance vis-à-vis des violences faites aux femmes, dont l’ampleur émerge grâce à des espaces militants particuliers, « des groupes de conscience non mixtes, où les femmes se confient sur leurs relations intimes », explique la sociologue. Grâce aussi à des textes, comme le retentissant Crie moins fort, les voisins vont t’entendre, de l’écrivaine britannique Erin Pizzey, paru en 1974 et traduit en 1975 par les éditions des femmes. C’est l’analyse systémique et la déconstruction des rapports sociaux femmes-hommes qui incite les mouvements féministes, notamment le Mouvement de libération des femmes (MLF), à dénoncer les modalités de la domination masculine dans la sphère domestique. « Le privé est politique », scandent-elles. « Ce slogan, qui incarne ces mobilisations, permettait de repenser la façon dont les inégalités au sein du foyer ne relevaient pas simplement du privé, mais pouvaient s’inscrire dans des logiques politiques et reflétaient des rapports de domination », explique Pauline Delage.
Dès ces années-là, des victimes témoignent à la télé, des figures médiatiques, dont Simone de Beauvoir, soutiennent les mobilisations dans la presse, des manifestations et des débats sont organisés, des associations spécialisées se constituent, les premiers centres d’accueil ou d’hébergement ouvrent leurs portes… Mais l’État tarde à institutionnaliser la question, estime Pauline Delage : « Il faut attendre la fin des années 1980 pour voir apparaître la première campagne nationale contre les violences, avec l’expérimentation d’une ligne d’écoute nationale – qui donnera naissance au 3919. Puis, dans les années 2000, les politiques publiques se développent, avec la promulgation de lois spécifiques et de plans triennaux qui visent la protection des victimes, la prévention des violences et la sanction des auteur·ices. »
C’est tout un système qu’il faut reconfigurer : politique, policier, juridique, économique. Car si l’agresseur a la clé, il a aussi son nom sur le bail et accès au compte en banque. Le rapport 2023 de la Fondation Abbé-Pierre, envisagé « au prisme du genre », confirme que les femmes sont plus exposées au mal-logement que les hommes, du fait des inégalités de patrimoine ou d’accès à la propriété, ainsi que des violences conjugales, qui « constituent un facteur particulièrement aigu », car « elles entraînent bien souvent la perte du logement pour la victime ». Alors que le relogement peut signer l’arrêt des violences conjugales et intrafamiliales, « près de 40 % des femmes victimes de violences en demande d’hébergement seraient sans solution ».
« L’agresseur ne sonne pas, il a la clé » : le constat est insoutenable, car il heurte un stéréotype puissant, ancré dans l’imaginaire collectif, entretenu par les médias et la pop culture, celui de l’agresseur surgissant de nulle part. C’est l’inconnu qui viole les femmes dans les séries, qui les tue dans les téléfilms, celui qu’elles craignent en rentrant chez elles tard le soir, qui n’a ni prénom ni visage et qui ne les attend pas sur le canapé du salon. Cette maxime rappelle que, pour les femmes, l’insécurité ne s’arrête pas une fois le paillasson franchi. Que le foyer n’est pas protecteur : c’est le lieu privilégié de la terreur. C’est dans l’espace domestique, à l’abri des regards, que s’exerce en premier lieu la violence des hommes.
Une aide universelle d’urgence pour fuir les violences conjugales
Le 28 février 2023 a été promulguée en France la loi instaurant une « aide universelle d’urgence » pour permettre aux victimes de violences conjugales de quitter rapidement le foyer et de se mettre à l’abri. Le dispositif s’inspire d’une expérimentation menée à la fin de 2022 à Valenciennes (Nord), permettant de débloquer un « RSA d’urgence » ainsi qu’un accompagnement personnalisé (aide juridique ou psychologique, accès au logement) pour soutenir les victimes.
Applicable d’ici à la fin de 2023 « maximum », cette aide se présentera sous la forme d’un don ou d’un prêt sans intérêts, octroyé lorsque les violences (par conjoint, concubin ou partenaire pacsé) seront « attestées par le bénéfice d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales […], par un dépôt de plainte ou par un signalement adressé au procureur de la République ». La demande, effectuée lors du dépôt de plainte ou du signalement, sera transmise à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de Mutualité sociale agricole. Elle sera versée dans les trois à cinq jours ouvrés, et son montant, conditionné à la « situation financière et sociale » de la victime, ainsi qu’à la « présence d’enfants à charge ». Dans le cas d’un prêt, son remboursement par la victime pourra faire l’objet de « remises ou de réductions » ou bien être à la charge de l’auteur des violences, « sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros ».