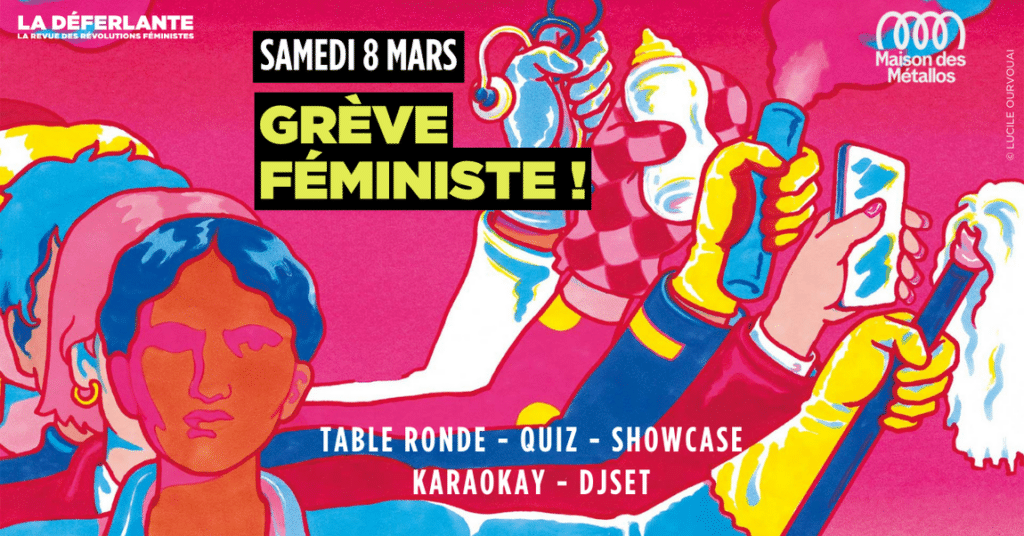Anne Lambert est sociologue, autrice de « Tous propriétaires ! L’envers du décor pavillonnaire » (2015, Seuil) et chercheuse à l’Institut national d’études démographiques. De 2008 à 2012, elle a enquêté auprès d’une quarantaine de familles d’un nouveau lotissement, qu’elle renomme « les Blessays », à 35 kilomètres de Lyon, dans le nord de l’Isère. Toutes les familles sont composées de couples hétérosexuels (à l’exception d’une famille monoparentale) appartenant à la classe ouvrière ou à la petite classe moyenne, qui se sont endettés pour acquérir un pavillon.
La moitié habitait auparavant en cité HLM, d’autres étaient locataires du parc privé, quelques ménages seulement étaient déjà propriétaires, mais presque tous vivaient en immeuble collectif.
Le travail de cette sociologue questionne le mythe de la maison individuelle périurbaine. Car si le pavillon vend du rêve sur le papier – fantasme de modernité, de confort, d’une vie centrée sur la famille nucléaire –, les désillusions sont nombreuses : endettement, éloignement des services publics, isolement, perte d’autonomie et d’emploi des femmes. Des difficultés auxquelles se greffent des barrières sociales et raciales, des « micro-ségrégations » qui freinent la mise en place de formes de solidarité.
Comment, selon ce que vous avez pu observer dans votre enquête, les femmes vivent-elles le déménagement depuis un immeuble vers le pavillon périurbain ?
Jamais, dans les discours des femmes que j’ai rencontrées, je n’ai retrouvé ce rêve d’une maison à soi, en rase campagne. Quand j’ai commencé à enquêter aux Blessays en 2008, les pavillons n’étaient même pas sortis de terre, c’était encore des dalles de béton et des champs en travaux. J’ai tout de suite été très frappée par une forme d’apathie, de tristesse, voire de souffrance, qui saisissait une partie des employées et des ouvrières que j’ai rencontrées. On attend d’elles qu’elles prennent en charge la décoration intérieure avec enthousiasme, qu’elles donnent vie à ces maisons. Mais ces tâches matérielles les dépriment, d’autant qu’elles doivent composer avec des ressources financières limitées. Revendre un canapé sur Leboncoin pour en acheter un autre ne procure pas le même plaisir que faire les magasins entre copines.
Ces femmes traversent aussi une phase de déprime liée à leur nouveau mode de vie : déposer les enfants à l’école en voiture, rentrer vite au lotissement, qui est vide toute la journée… Le déménagement en pavillon représente un coût matériel et affectif énorme pour celles qui s’éloignent à marche forcée de leur ancien quartier, de leurs réseaux de sociabilité. Celles qui vivaient en HLM bénéficiaient par exemple d’une pluralité d’aides informelles à proximité. Elles n’étaient pas seules à gérer le quotidien. Il y avait toujours des voisines, des cousines, des sœurs qui pouvaient aller chercher les enfants à la sortie de l’école à leur place ou les garder quand ils étaient malades. Elles bénéficiaient aussi d’un soutien affectif, lors de soirées à Lyon entre amies, parfois sans enfants, sans mec. On pourrait parler de sororité. Une distance de 20 kilomètres, ce n’est pas énorme sur le papier, mais la hausse du coût de l’essence et de la vie en général rend difficile son franchissement. Assignées à domicile, elles ne s’autorisent à se plaindre que dans un cercle très restreint. Au moment de l’emménagement, certaines pleuraient tous les jours au téléphone avec leur mère.
La maison individuelle est-elle davantage un rêve d’homme ?
Dans un couple, les deux partenaires veulent en général améliorer leurs conditions de logement, pour avoir une pièce de plus, pour que les enfants puissent être scolarisés dans une meilleure école. Néanmoins, au moment de la concrétisation du projet, la maison individuelle n’est pas spécialement valorisée par les femmes. Parfois, elles n’y pensent même pas au départ. Leur idée, c’est plutôt de regarder à proximité pour trouver un meilleur appartement dans le parc locatif privé, ou même de demander un relogement aux bailleurs sociaux pour passer de « la tour A qui est très sale » à une autre, « plus propre ». Il n’y a pas de rejet massif du parc social, mais une lassitude face à la dégradation du bâti, au mauvais entretien des ascenseurs, aux nuisances du quotidien. Ce type d’habitat n’est pas vécu comme un repoussoir dès lors qu’il est entretenu, les femmes ont même une très forte conscience que cela les protège des aléas de la vie et du marché immobilier.
Pour les hommes, c’est différent. D’abord, la maison les assoit dans le rôle du « bon père de famille », capable de gagner des revenus stables, de gérer un budget et d’offrir à sa femme et à ses enfants des conditions de logement optimales. Ensuite, la maison est source de fierté personnelle, symbole de réalisation de soi. Elle permet aux conjoints de faire valoir leurs compétences techniques et leur ingéniosité quand ils fabriquent un bassin pour les tortues, une balançoire pour les enfants, un four à pizza. Une partie des pavillons sont par ailleurs livrés en auto-finition : pour économiser sur le montant total de la maison et avoir des crédits moins élevés, les accédants modestes s’occupent eux-mêmes de la peinture ou de la pose du carrelage.
« Le déménagement en pavillon représente un coût matériel et affectif énorme pour celles qui s’éloignent à marche forcée de leur ancien quartier, de leurs réseaux de sociabilité. »
ANNE LAMBERT
C’est aussi l’occasion pour les hommes de développer des réseaux de sociabilité…
Au moment de la construction, un entre-soi masculin se développe, notamment pour des raisons de forte pression matérielle et financière : quand ils ne peuvent pas s’en occuper eux-mêmes, ils sollicitent d’autres hommes de leur entourage pour faire au black un peu de terrassement, par exemple. Par ailleurs, le samedi et le dimanche, les hommes s’affairent dehors, en tenue de bricolage et cela leur offre l’occasion d’échanger des biens et des services : ils empruntent une machine à un voisin, demandent de l’aide à un cousin… Ainsi, dès le début des travaux, la sociabilité masculine est tournée vers l’extérieur tandis que celle des femmes est d’emblée plus limitée et centrée vers l’intérieur du foyer. On ne les voit quasiment pas sur les chantiers !
Que pensez-vous des politiques publiques qui vantent l’accession à la propriété ?
C’est un discours incohérent. D’un côté, on encourage les couples et les familles à devenir propriétaires en développant des aides qui nourrissent l’extension pavillonnaire périurbaine et qui favorisent toute une économie autour des constructeurs bas de gamme – lesquels sont sponsorisés par les banques, qui suggèrent à leurs clients d’acheter des terrains à construire ou des maisons neuves. Et de l’autre côté, on assiste à une politique dite de « rationalisation » des dépenses publiques depuis le milieu des années 2000, qui consiste à regrouper les tribunaux d’instance, les maternités, les hôpitaux, à supprimer les petites gares, etc.
Ces deux mouvements sont contradictoires. On ne peut pas à la fois pousser les gens hors des villes et restreindre l’offre de service public de proximité, l’accès à l’emploi ou l’accompagnement social. Une chose est sûre, cela vient renforcer la charge domestique qui pèse sur les femmes. Certaines avaient l’habitude de vivre dans d’anciennes municipalités communistes très familialistes de l’Est lyonnais. Elles découvrent des communes périurbaines sous-dotées en équipements collectifs, dont les politiques sociales redistributives ne font pas partie des traditions. Quand les services de garde des enfants sont inexistants, quand l’absence de transports collectifs oblige à prendre la voiture pour toutes les activités sportives, quand les cantines scolaires ou les centres aérés sont très chers, même par rapport aux grandes villes, c’est autant de tâches que doivent assurer les mères, qui se mettent par exemple à s’occuper du déjeuner en semaine. Surtout qu’elles sont parfois amenées à abandonner leur emploi : quand il faut arbitrer lequel des deux, dans le couple, continuera de se rendre à son travail en dépit des distances à parcourir, les écarts de salaire ne plaident pas en leur faveur. Généralement elles n’ont pas les moyens de démissionner, mais elles arrêtent de travailler à l’extérieur à l’occasion d’un congé maternité, puis parental.
Pourquoi est-ce si compliqué, dans le pavillonnaire, de reconstruire un système d’entraide entre femmes ?
Il y a une compétition sociale entre voisins qui est favorisée par le dispositif urbanistique : à la différence des immeubles verticaux qui préservent l’intimité de leurs occupants, ces lotissements sont plats et construits souvent en boucles, si bien que l’on voit tout ce qui se passe dans les maisons. On sait qui est invité, quel est le contenu du caddie, et cela permet aux familles de se comparer les unes aux autres, en particulier au moment de l’installation. Il y a celles qui partent travailler en jeans et baskets à l’usine et celles, plus apprêtées, qui se rendent au bureau. La mise à distance des plus modestes va très vite. Si vous ne plantez pas de gazon, si vous n’installez pas de portail au bout de quelques mois, c’est que vous n’avez pas d’argent. Les courses que vous faites en disent également long sur votre niveau de vie.
Sur ces hiérarchies sociales se greffent des enjeux de racisation. Les ménages blancs modestes, qui ne s’attendent pas du tout à se retrouver avec des familles d’origine africaine, luttent contre un sentiment de déclassement d’autant plus prégnant qu’ils se sont souvent endettés sur de longues années pour pouvoir acheter la maison. Une partie de la population du lotissement des Blessays s’était ainsi liguée contre une dame ivoirienne de peur qu’elle ternisse l’image du lotissement. Elle était stigmatisée en tant que personne noire, mais aussi parce que, étant infirmière, elle était obligée de laisser ses enfants souvent seuls le soir à la maison. Rapidement, l’idée a circulé dans le voisinage qu’ils étaient livrés à eux-mêmes, et la moralité de cette femme a été mise en doute. Elle en souffrait beaucoup.
La difficulté à nouer des liens est aussi associée à une peur de donner prise aux commérages, qui incitent à la pudeur et au repli sur l’intérieur de la maison. D’autant que les lotissements manquent d’espaces semi-publics ou publics pour se retrouver entre femmes. Pas de petits cafés, peu d’associations pour se faire des amies, ni même un banc pour discuter autour de l’école, construite loin du centre ancien du village. Il en résulte une assignation au rôle de maîtresse de maison très mal vécu alors que tout le discours politique et le marketing immobilier les enjoignent à être heureuses ainsi. •

Entretien réalisé par Marion Rousset, journaliste indépendante, collaboratrice régulière de Télérama, Causette, Témoignage chrétien et Le Monde. Elle est membre du collectif Les Incorrigibles.