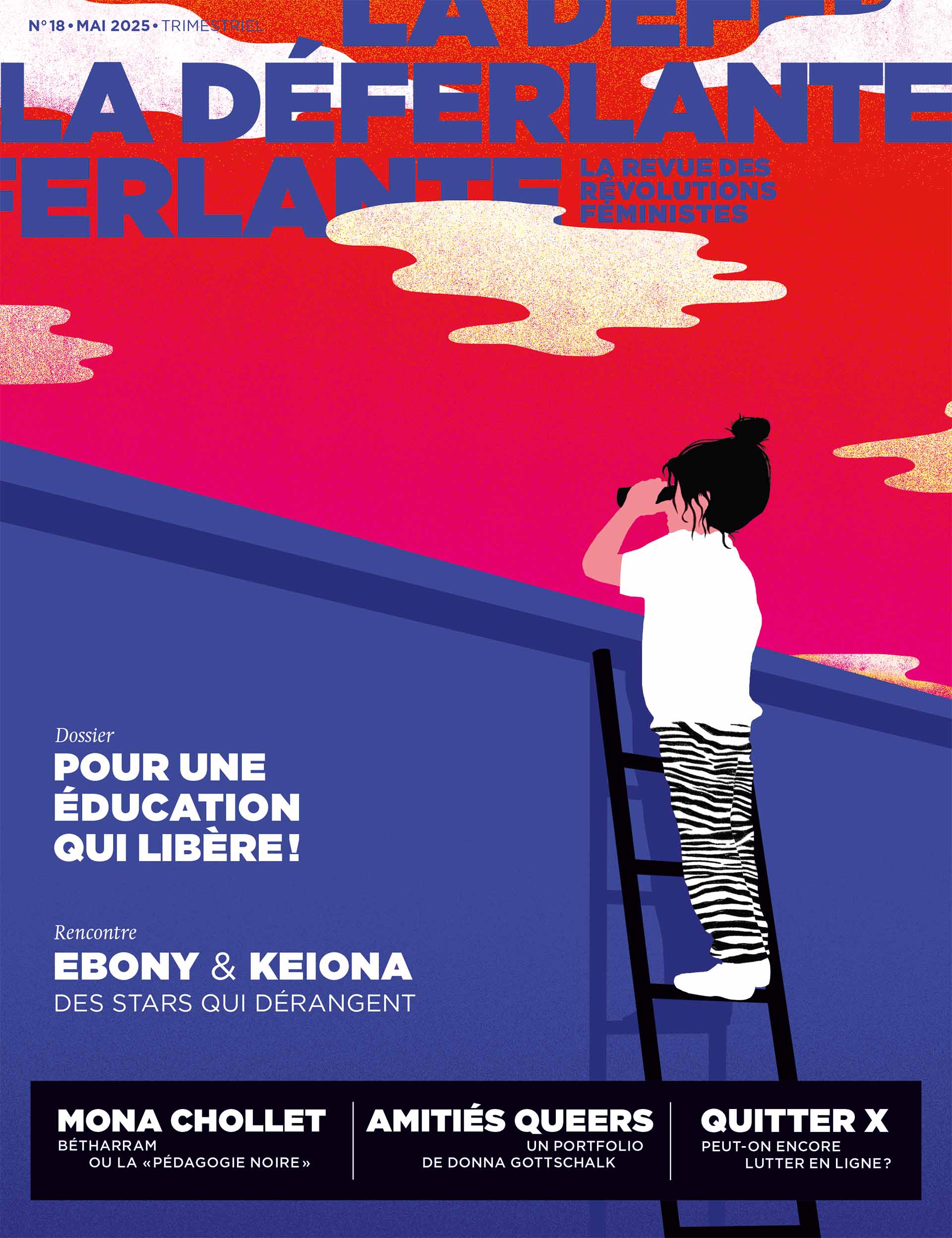C’est une lutte dans laquelle les penseuses féministes se sont engagées très tôt, à l’image de l’écrivaine Mary Wollstonecraft (1759–1797).
Évidemment, c’est un peu plus compliqué que cela. Avant d’offrir un horizon libérateur, la relation éducative est surtout chargée de tensions : dans ce face-à-face, l’adulte et l’enfant, la ou le pédagogue et son élève, l’institution qui éduque et le groupe qui doit être éduqué ne sont pas dans un rapport d’égalité. La domination des adultes sur les enfants est un rapport de pouvoir qu’il convient de mettre en lumière : les féministes s’y attellent en donnant notamment écho au concept d’infantisme. La banalité des violences éducatives dans les établissements scolaires catholiques, mise au jour ces derniers mois, est une illustration exacerbée de ce rapport de pouvoir. Au pensionnat de Notre-Dame-de-Bétharram, depuis six décennies, le personnel encadrant violentait les élèves, avec le soutien tacite de nombreux parents. Alors qu’il était ministre de l’Éducation nationale, François Bayrou a été informé des sévices perpétrés dans l’établissement, et a longtemps cherché à en minimiser la portée. Ces révélations ont très peu fragilisé l’actuel chef du gouvernement. Penser l’éducation comme une forme plus ou moins sophistiquée de dressage ne met pas en péril une carrière politique. Au contraire.
À l’heure actuelle, cette vision autoritaire, voire autoritariste, a le vent en poupe. En France, le chef de l’État défend le retour du port de l’uniforme dans les établissements scolaires, ou décide d’investir massivement dans la mise en place du service national universel pour les jeunes, un dispositif qui tient du séjour soft en camp militaire. Ces choix politiques et leur traduction budgétaire poussent à s’interroger, quand on sait que la souffrance des personnels des écoles – en grande majorité des femmes – ne cesse de s’accroître du fait de l’insuffisance de moyens et du manque de reconnaissance.
Aux États-Unis, les attaques contre l’enseignement public se multiplient : le 20 mars dernier, le président, Donald Trump, a signé un décret visant à démanteler progressivement le ministère de l’Éducation – une loi devra toutefois être adoptée au Sénat. Rien de plus efficace, pour asseoir la violence et la domination, que de désamorcer toute pensée critique en fabriquant de l’ignorance. Ce constat n’est pas valable seulement pour les savoirs dits fondamentaux : il concerne aussi l’éducation à la sexualité, sans cesse prise pour cible par les représentant·es des forces réactionnaires.
« Rien de plus efficace, pour asseoir la violence que de fabriquer de l’ignorance. »
À partir de la rentrée prochaine, un nouveau programme d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (Évars) sera enseigné aux élèves de la maternelle au lycée : il est censé rendre effectives les trois séances annuelles prévues par la loi de 2001. Il devrait amener les élèves à mieux identifier les violences sexuelles et les discriminations dont elles et ils peuvent être l’objet. L’ambition d’une telle démarche rend d’autant plus condamnable l’absence du mot transphobie dans le programme final, à l’heure où les attaques contre les personnes trans sont devenues l’un des marqueurs des partis de droite et d’extrême droite.
Plus de deux siècles après la disparition de Mary Wollstonecraft, la lutte continue : l’éducation est un enjeu éminemment politique, au cœur des guerres culturelles. Pour en faire l’horizon libérateur espéré, elle doit être l’affaire de toutes celles et ceux qui souhaitent, comme le disait la militante féministe, permettre « à l’individu d’acquérir les habitudes vertueuses qui assureront son indépendance ».