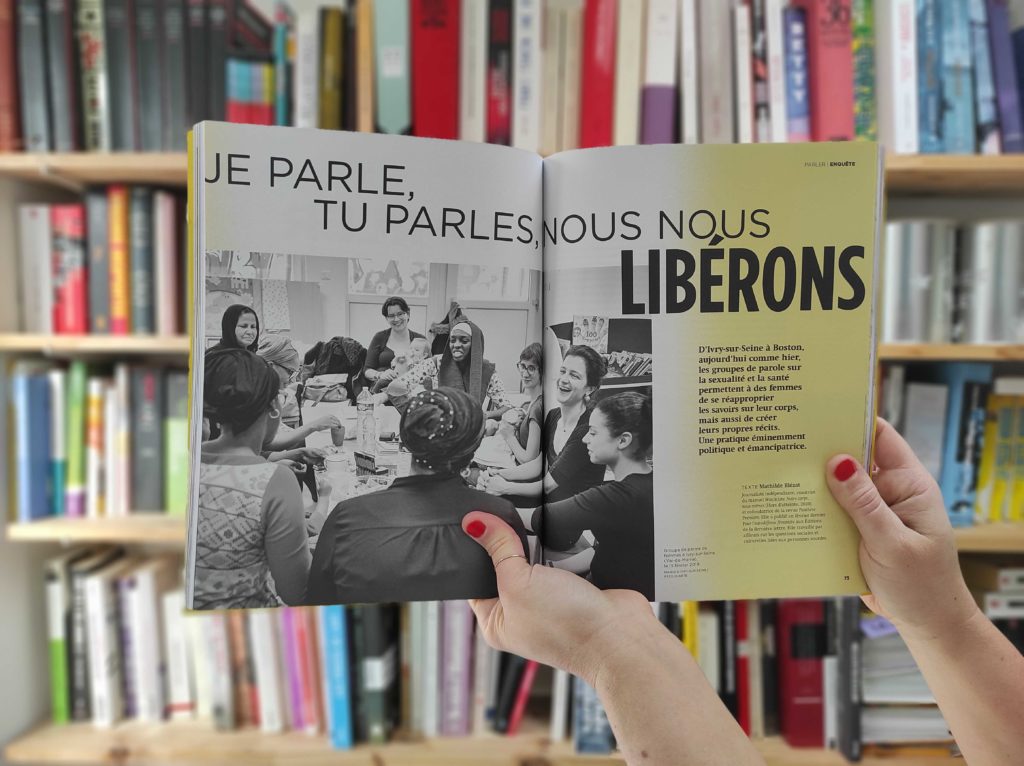Il est 8 h 20 et nous sommes trois à attendre devant la porte d’un immeuble HLM du quartier populaire de Moulins, à Lille. Une photographe, une journaliste et une personne dont le visage est en partie caché sous une écharpe.
Étirer les cordes vocales
De 8 h 30 à 17 h 30, ce jour-là, l’orthophoniste enchaîne, sans pause, les séances d’éducation vocale. Les personnes trans qu’elle accueille ont parfois attendu plusieurs mois avant un premier rendez-vous : les orthophonistes spécialisé·es dans l’accompagnement des transitions de genre se comptent, en France, sur les doigts des deux mains.
10 heures. D’une voix appliquée, Mia, 24 ans, étudiante en école d’ingénieur informatique, reproduit des notes et des intonations. Sur la table en bois du cabinet, une appli du téléphone de Juliette capte les sons et les traduit en courbes élancées qui permettent à la jeune femme de visualiser sa voix : « Bon-jouuuuur », « En-coooore », « Bon-soiiiir ». L’orthophoniste encourage : « Il faut, te redresser, bien prendre de l’air et que ça s’ouvre au niveau de tes côtes. La posture est hyper importante dans la voix. Si tu ne doutes pas de toi, les gens ne douteront pas de toi ! » La plupart des séances commencent par un échauffement de l’appareil phonatoire. « Est-ce que tu peux me faire un “ha” ? Il résonne où, ton “ha” ? » Mia montre sa gorge. « Alors on va le faire monter un peu au-dessus. On va changer d’étage. » Ce qui fait le genre de la voix, c’est notamment l’endroit du corps où les sons viennent résonner. Dans la poitrine pour la plupart des hommes ; dans la tête pour une majorité de femmes.
Avec ces exercices, Juliette Defever entraîne aussi à étirer les cordes vocales pour permettre aux femmes trans de parler avec une voix plus aiguë. « La voix est aussi une donnée culturelle. Selon les pays et les normes sociales, les voix de femmes sont plus ou moins hautes. Avoir une voix aiguë pour un homme, c’est toléré dans certains pays, mais pas chez nous². » La morphologie joue aussi sur la manière de parler : « Les femmes ont généralement de plus petits organes respiratoires, ce qui les contraint à reprendre de l’air plus fréquemment, du coup, elles marquent davantage de pauses dans leur diction. »
« La voix est une donnée culturelle. Selon les pays et les normes sociales, les voix de femmes sont plus ou moins hautes. »
Juliette Defever, orthophoniste
Le travail, ici, consiste à reconstituer un parler cohérent avec l’identité de genre ressentie. « Il faut imaginer la voix comme une radio avec cinq boutons variateurs qui vont agir sur les paramètres pour permettre son identification : la hauteur de la voix, l’articulation, le timbre, l’intonation et le rythme. » Juliette Defever soulève les mains de son bureau et recourbe ses doigts comme si elle tournait une molette. « Ces cinq boutons, on va les régler ensemble, en fonction de la manière dont la personne a envie de se faire entendre. »
Ici, les hommes trans sont rares, car les injections de testostérone effectuées dans le cadre de la transition hormonale agissent sur l’épaisseur des cordes vocales et rendent mécaniquement la voix plus grave. Pour les femmes, tout repose en revanche sur un travail d’éducation vocale de longue haleine qui peut durer de quelques mois à quelques années. Cette prise en charge s’inscrit dans une logique de soin mise en place par la Maison dispersée de santé³ du quartier de Moulins à Lille, dans laquelle la personne accompagnée – on ne parle pas de « malades » ni de « patient·es » ici – est codécisionnaire.
« J’hésite encore sur la voix que je vais utiliser »
Midi. Anna pénètre dans la pièce d’un pas leste et dans un même mouvement se débarrasse de son grand manteau noir et blanc. « Tu aurais pu me dire qu’il y avait des journalistes, Juliette ! J’aurais fait un effort pour me maquiller et mettre autre chose qu’un vieux jean et un T‑shirt de métalleux ! » L’orthophoniste rigole : « Tu es la seule que je n’ai pas pu joindre. Alors c’était bien les vacances à Malte ? »
La trentenaire fréquente le cabinet d’orthophonie depuis avril 2021 mais a entamé sa transition dix-huit mois auparavant. « Je suis psychiatre et sexologue, et quand j’ai commencé les hormones, je travaillais dans un service public et j’étais encore au placard donc je ne me suis pas attaquée à ce qui aurait pu être trop remarquable : les poils et la voix. » Depuis, elle a démissionné et se consacre à une thèse en santé publique. « J’ai finalement été voir un généraliste de la Maison de santé qui m’a proposé des séances d’orthophonie et, au bout de trois mois, prescrit des hormones⁴. » Dans quelques semaines, la jeune femme doit intervenir au Congrès français de psychiatrie : « J’hésite encore sur la voix que je vais utiliser. Sans doute une voix androgyne, plus proche de ma voix de confort. J’aime beaucoup jouer avec mon apparence. »
Même après la fin de leurs séances d’orthophonie, certaines femmes trans continuent à faire cohabiter plusieurs voix dans leur quotidien : une voix « d’invisibilité », comme Juliette Defever l’appelle, qui correspond en tous points au genre dans lequel elles se reconnaissent, et qu’elles emploient le plus souvent dans leurs interactions avec des administrations, des commerçant·es ou au téléphone. Et une voix « de confort », qui se situe quelques tons en dessous, demande moins de concentration et peut s’employer dans un environnement « safe », avec des ami·es par exemple. « Je reçois de plus en plus de jeunes gens qui s’affirment en dehors des normes binaires, poursuit l’orthophoniste. Ils et elles brouillent les codes, s’en amusent. Ça m’a permis d’évoluer dans ma posture de thérapeute. Je ne cherche plus à tout prix dans mon travail à faire acquérir une voix qui rentre dans le moule des stéréotypes de genre. »
Déconstruire les normes de genre
Il y a une dizaine d’années, Juliette Defever était encore une orthophoniste « classique » qui prenait en charge principalement des défauts de langage et des pathologies de la voix. Au début des années 2010, la maison de santé où elle travaille décide d’ouvrir plus largement ses portes aux personnes en transition de genre. L’orthophoniste, qui vient alors tout juste de fêter ses 30 ans, est sollicitée pour intégrer cette équipe spécialisée. « J’étais terrorisée parce que je ne savais pas du tout ce que j’allais faire. À l’école d’orthophonie, on nous avait parlé trois minutes des personnes trans. J’ai été très honnête au début avec ces personnes : je leur ai expliqué que je n’avais jamais fait ce type de prise en charge et qu’on allait avancer ensemble. » Forte de cette expérience de pionnière, la thérapeute enseigne aujourd’hui sa pratique au sein de l’école d’orthophonie de Lille : « Trois heures de cours sur une formation de cinq ans. C’est peu, mais c’est déjà ça. Il y a beaucoup d’écoles où il n’y a rien du tout. »
Se considère-t-elle comme une soignante militante ? « Si faire du militantisme c’est éduquer les gens autour de soi au respect de l’autre, alors oui je le suis. Si c’est être aux côtés des personnes trans, afin de les accompagner dans leur cheminement, alors oui je le suis. Je préviens souvent mes étudiant·es : travailler avec des personnes trans vous force à vous interroger sur votre genre. Moi, je me suis longtemps conformée à ce qu’on attendait de moi en tant que femme : rencontrer un homme, me marier jeune, avoir des enfants. Au contact des personnes trans, j’ai compris que ça ne me correspondait pas complètement, j’ai fini par divorcer. Je reste une femme blanche, hétéro, cisgenre, c’est pas très rock’n’roll, mais au moins j’ai déconstruit quelque chose ! »
15 h 30. Mathilde passe la porte, nous salue timidement et s’installe devant la table qui sert aux consultations. La prise en charge orthophonique de cette jeune femme, étudiante en master d’histoire antique, a débuté il y a 18 mois. L’orthophoniste propose que notre conversation fasse office d’exercice grandeur nature. Alors, d’une voix parfaitement maîtrisée, Mathilde se lance : « Ce travail vocal m’a apporté autant sinon plus que de changer ma garde-robe. Avant, l’image que je renvoyais ne correspondait pas à l’image de femme que j’avais de moi-même. Dès que j’ouvrais la bouche, les gens m’appelaient monsieur ». Juliette l’interroge : « Tu crois que tu te serais lancée dans ce travail si on vivait dans une société plus ouverte d’esprit sur la question du genre ? » L’étudiante marque une courte pause avant de répondre : « Je pense que oui. Je le fais d’abord pour moi parce que je veux être une femme et me sentir conforme à ce genre que je ressens. Moi aussi, j’ai sans doute des représentations binaires. » •
Reportage réalisé le 9 novembre 2021 par Marion Pillas, corédactrice en chef de La Déferlante.
1. Certains prénoms ont été modifiés
2. Selon des expériences effectuées à l’université de Stockholm, les femmes allemandes ont des voix plus aiguës que les femmes américaines, qui, elles-mêmes, parlent plus haut que les Françaises. Les différences de fréquences entre voix dites masculines et féminines sont également plus ou moins marquées selon les régions du monde. Lire Aron Arnold, « Voix et transidentités : changer de voix pour changer de genre ? », Langage et société, 2015.
3. Inauguré en 1986, en pleine épidémie de sida, ce lieu de soin s’est spécialisé dans l’accueil des personnes marginalisées. Son équipe travaille selon un principe d’expertise partagée, intégrant notamment les associations communautaires ou les groupes d’usagères et usagers.
4. En France, les personnes trans sont le plus souvent suivies par des médecins hospitaliers dont la pratique est d’attendre plusieurs mois, voire plusieurs années, pour prescrire des hormones.