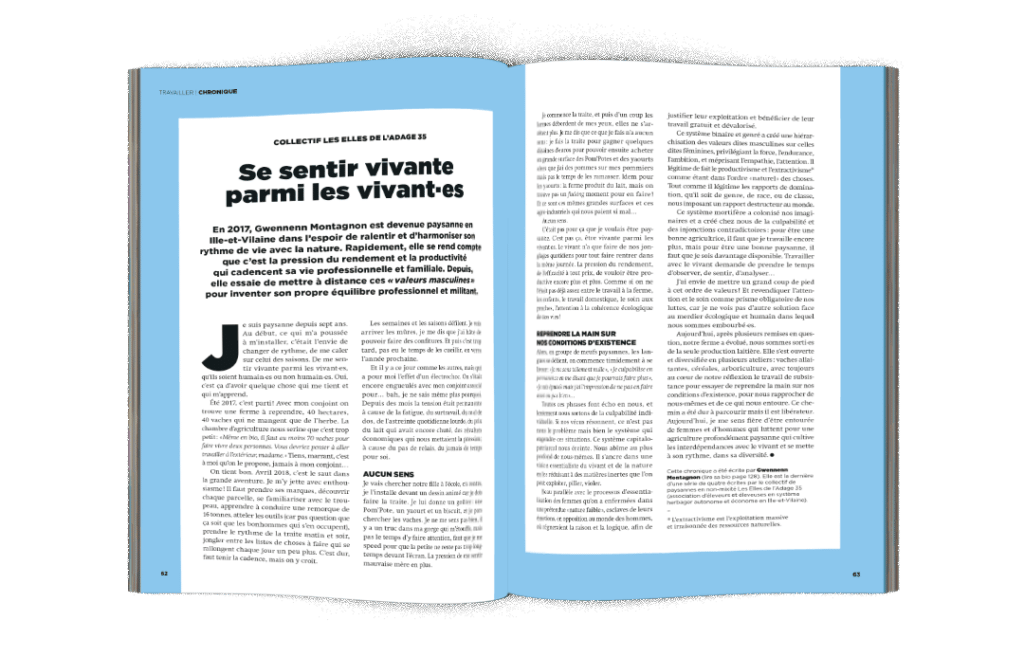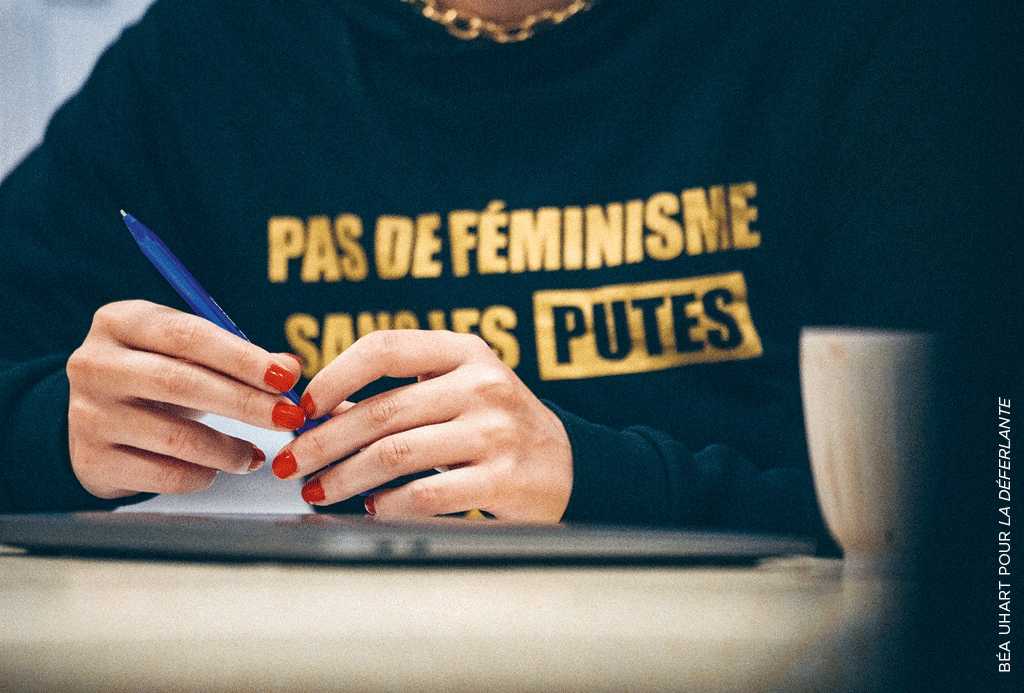Nous sommes comme des lapins pris dans les phares d’une voiture lancée à toute vitesse. Sidéré·es depuis la dissolution de l’Assemblée nationale le 9 juin 2024. Plongé·es dans la confusion la plus totale par un président de la République qui multiplie les déclarations contradictoires et balaie d’un revers de main la volonté des Françaises et des Français.
L’instabilité politique entretenue par Emmanuel Macron depuis l’été 2024 vient accentuer l’effet des réformes néolibérales imposées depuis plus de dix ans par les différents gouvernements. Tandis qu’à l’autre extrémité, tout en bas de l’échelle, ce sont des personnes racisées, des femmes, souvent issues de l’immigration qui sont les premières victimes de la casse sociale. La réforme des retraites de 2023 qui pénalise les carrières irrégulières, tout comme la récente réforme du RSA qui conditionne le versement du revenu de solidarité à un quota d’heures travaillées, ont en effet été pensées « au masculin-neutre », comme l’affirme la sociologue Sophie Pochic (lire l’entretien avec Sophie Pochic). Les travailleuses issues des classes populaires, dont les carrières sont ralenties par les maternités et le non-partage du travail domestique au sein du couple, restent cantonnées à des emplois précaires et peu rémunérateurs.
Parce que le travail reste un foyer de lutte contre les politiques capitalistes menées depuis le sommet de l’État, nous avons souhaité dans ce numéro nous emparer de cette question : comment sortir de ce « système d’écrasement des femmes (1) », en particulier des plus précaires ? Une des réponses possibles s’appelle la grève féministe (lire notre article consacré à la grève féministe ). Le 24 octobre 1975, 90 % des Islandaises s’étaient mises massivement en grève. Refusant de s’occuper de leurs enfants, de faire à manger à leur famille, d’ouvrir les guichets des administrations, elles avaient mis leur pays à l’arrêt vingt-quatre heures durant. Dans la foulée de ce mouvement, les habitantes de l’île ont obtenu le droit à l’avortement et des gages d’égalité salariale. Depuis une dizaine d’années, partout dans le monde, de l’Amérique du Sud à la Suisse en passant par l’Espagne, des centaines de milliers de femmes se mettent en grève chaque année pour demander la fin de l’oppression de genre.
Qu’est-ce qui nous empêche, en ce début 2025 de suivre leur exemple ? Selon Erica Chenoweth, professeure de science politique à Harvard et spécialiste des luttes non violentes, il suffirait que 3,5 % de la population s’engage pour qu’un mouvement de résistance civile obtienne des résultats. Quelle que soit la valeur prédictive de cette théorie, projetons-nous un instant : à l’échelle de notre pays, cela impliquerait que 2,4 millions de personnes s’engagent. C’est beaucoup, rapporté aux 100 000 manifestant·es mobilisé·es en France contre les violences de genre en novembre 2024. Mais si les Islandaises l’ont fait il y a cinquante ans, qui plus est sans TikTok ni Instagram, n’est-ce pas à notre portée ?
Nouvelle pagination
Le numéro n°17 de La Déferlante sur le thème Travailler (février 2025) comporte 128 pages, au lieu de 144. Nous avons décidé de cette baisse de pagination afin d’alléger la charge de travail de notre équipe : moins de pages, ce sont moins d’articles à relire, à corriger, à mettre en maquette. Et, en fin de compte, des cadences plus respectueuses des temps de vie de chacun·e. Ce changement est également une réponse aux remarques formulées par nos lecteurs et lectrices dans le cadre d’une enquête de lectorat réalisée en mai 2024, faisant état d’une revue dense et parfois trop longue à lire en l’espace de trois mois.
(1) Le terme est notamment utilisé par l’historienne des féminicides Christelle Taraud pour parler du système de domination patriarcale.