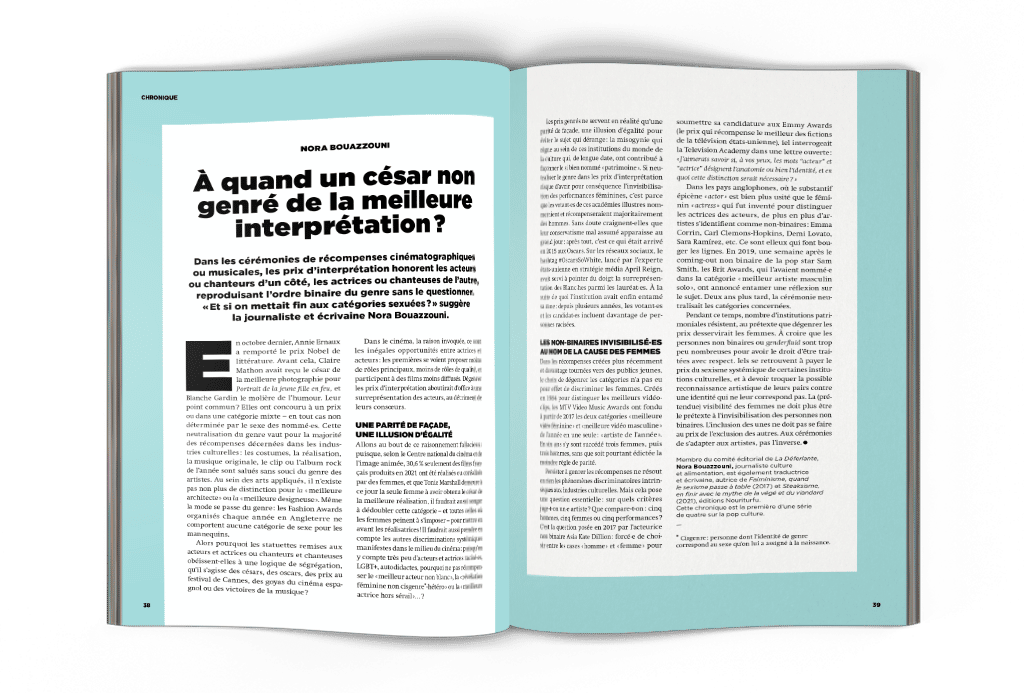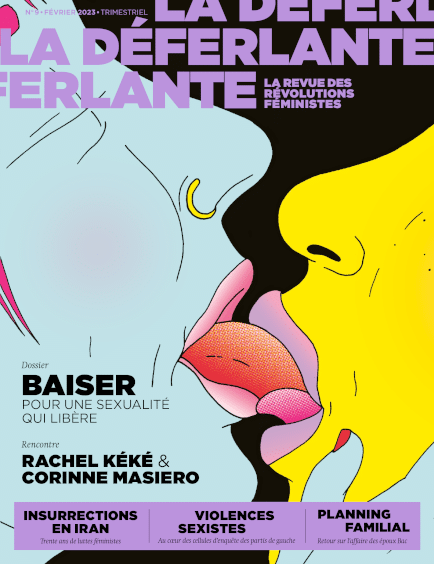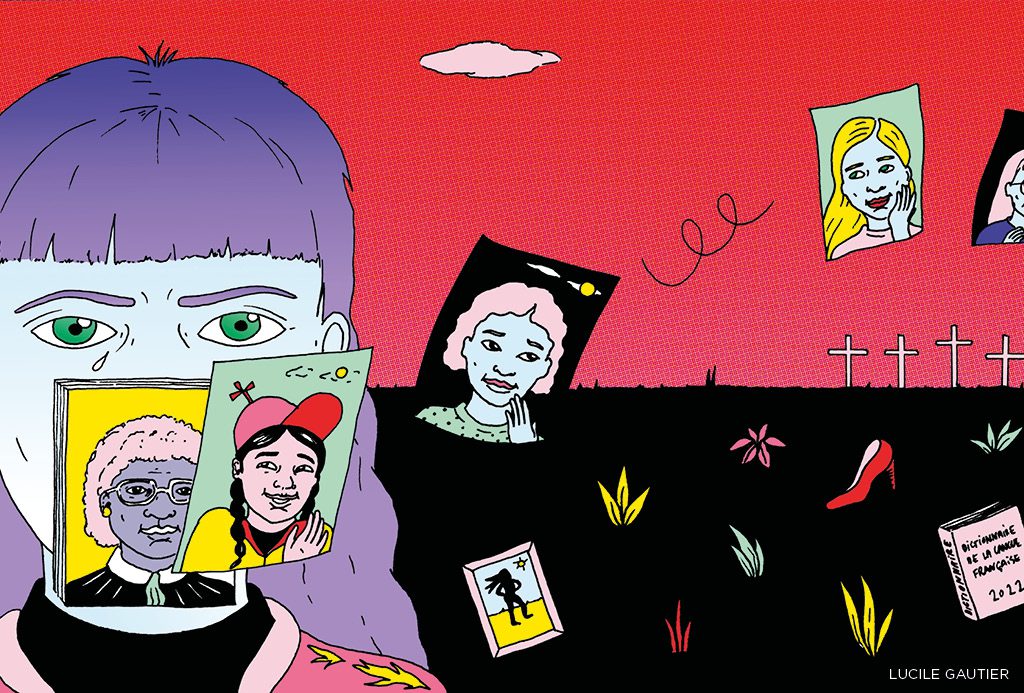En octobre dernier, Annie Ernaux a remporté le prix Nobel de littérature. Avant cela, Claire Mathon avait reçu le césar de la meilleure photographie pour Portrait de la jeune fille en feu, et Blanche Gardin le molière de l’humour.
Alors pourquoi les statuettes remises aux acteurs et actrices ou chanteurs et chanteuses obéissent-elles à une logique de ségrégation, qu’il s’agisse des césars, des oscars, des prix au festival de Cannes, des goyas du cinéma espagnol ou des victoires de la musique ?
Dans le cinéma, la raison invoquée, ce sont les inégales opportunités entre actrices et acteurs : les premières se voient proposer moins de rôles principaux, moins de rôles de qualité, et participent à des films moins diffusés. Dégenrer les prix d’interprétation aboutirait d’office à une surreprésentation des acteurs, au détriment de leurs consœurs.
Une parité de façade, une illusion d’égalité
Allons au bout de ce raisonnement fallacieux : puisque, selon le Centre national du cinéma et de l’image animée, 30,6 % seulement des films français produits en 2021 ont été réalisés ou coréalisés par des femmes, et que Tonie Marshall demeure à ce jour la seule femme à avoir obtenu le césar de la meilleure réalisation, il faudrait aussi songer à dédoubler cette catégorie – et toutes celles où les femmes peinent à s’imposer – pour mettre en avant les réalisatrices ! Il faudrait aussi prendre en compte les autres discriminations systémiques manifestes dans le milieu du cinéma : puisqu’on y compte très peu d’acteurs et actrices racisé·es, LGBT+, autodidactes, pourquoi ne pas récompenser le « meilleur acteur non blanc », la « révélation féminine non cisgenre*-hétéro » ou la « meilleure actrice hors sérail »… ?
Les prix genrés ne servent en réalité qu’une parité de façade, une illusion d’égalité pour éviter le sujet qui dérange : la misogynie qui règne au sein de ces institutions du monde de la culture qui, de longue date, ont contribué à façonner le si bien nommé « patrimoine ». Si neutraliser le genre dans les prix d’interprétation risque d’avoir pour conséquence l’invisibilisation des performances féminines, c’est parce que les votant·es de ces académies illustres nommeraient et récompenseraient majoritairement des hommes. Sans doute craignent-elles que leur conservatisme mal assumé apparaisse au grand jour : après tout, c’est ce qui était arrivé en 2015 aux Oscars. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #OscarsSoWhite, lancé par l’experte états-unienne en stratégie média April Reign, avait servi à pointer du doigt la surreprésentation des Blanc·hes parmi les lauréat·es. À la suite de quoi l’institution avait enfin entamé sa mue : depuis plusieurs années, les votant·es et les candidat·es incluent davantage de personnes racisées.
Les non-binaires invisibilisé·es au nom de la cause des femmes
Dans les récompenses créées plus récemment et davantage tournées vers des publics jeunes, le choix de dégenrer les catégories n’a pas eu pour effet de discriminer les femmes. Créés en 1984 pour distinguer les meilleurs vidéo-clips, les MTV Video Music Awards ont fondu à partir de 2017 les deux catégories « meilleure vidéo féminine » et « meilleure vidéo masculine » de l’année en une seule : « artiste de l’année ». En six ans s’y sont succédé trois femmes, puis trois hommes, sans que soit pourtant édictée la moindre règle de parité.
Persister à genrer les récompenses ne résout en rien les phénomènes discriminatoires intrinsèques aux industries culturelles. Mais cela pose une question essentielle : sur quels critères juge-t-on un·e artiste ? Que compare-t-on : cinq hommes, cinq femmes ou cinq performances ? C’est la question posée en 2017 par l’acteurice non binaire Asia Kate Dillion : forcé·e de choisir entre les cases « homme » et « femme » pour soumettre sa candidature aux Emmy Awards (le prix qui récompense le meilleur des fictions de la télévision états-unienne), iel interrogeait la Television Academy dans une lettre ouverte : « J’aimerais savoir si, à vos yeux, les mots “acteur” et “actrice” désignent l’anatomie ou bien l’identité, et en quoi cette distinction serait nécessaire ? »
Dans les pays anglophones, où le substantif épicène « actor » est bien plus usité que le féminin « actress » qui fut inventé pour distinguer les actrices des acteurs, de plus en plus d’artistes s’identifient comme non-binaires : Emma Corrin, Carl Clemons-Hopkins, Demi Lovato, Sara Ramírez, etc. Ce sont elleux qui font bouger les lignes. En 2019, une semaine après le coming-out non binaire de la pop star Sam Smith, les Brit Awards, qui l’avaient nommé·e dans la catégorie « meilleur artiste masculin solo », ont annoncé entamer une réflexion sur le sujet. Deux ans plus tard, la cérémonie neutralisait les catégories concernées.
Pendant ce temps, nombre d’institutions patrimoniales résistent, au prétexte que dégenrer les prix desservirait les femmes. À croire que les personnes non binaires ou genderfluid sont trop peu nombreuses pour avoir le droit d’être traitées avec respect. Iels se retrouvent à payer le prix du sexisme systémique de certaines institutions culturelles, et à devoir troquer la possible reconnaissance artistique de leurs pairs contre une identité qui ne leur correspond pas. La (prétendue) visibilité des femmes ne doit plus être le prétexte à l’invisibilisation des personnes non binaires. L’inclusion des unes ne doit pas se faire au prix de l’exclusion des autres. Aux cérémonies de s’adapter aux artistes, pas l’inverse. •
Membre du comité éditorial de La Déferlante, Nora Bouazzouni, journaliste culture et alimentation, est également traductrice et écrivaine, autrice de Faiminisme, quand le sexisme passe à table (2017) et Steaksisme, en finir avec le mythe de la végé et du viandard (2021), éditions Nouriturfu.
Cette chronique est la première d’une série de quatre sur la pop culture.
—
* Cisgenre : personne dont l’identité de genre correspond au sexe qu’on lui a assigné à la naissance.