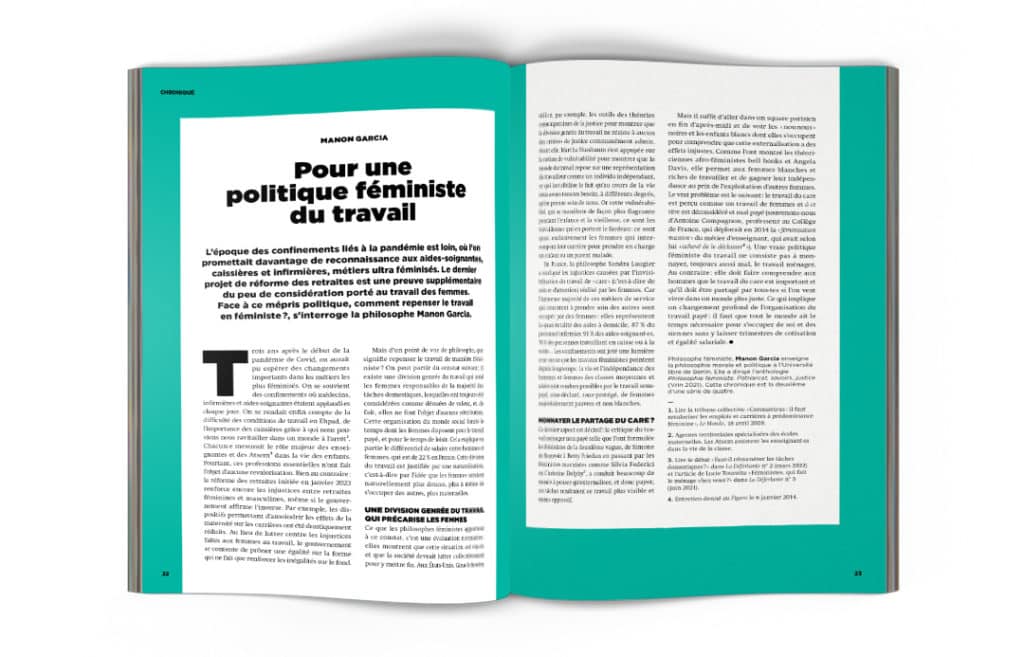« C’est la « cocotte-minute qui explose » dira Jacqueline Sauvage, pour expliquer comment elle en est arrivée à tirer trois cartouches dans le dos de son mari, Norbert Marot, le 10 septembre 2012.
Ce matin-là, Norbert Marot se met en rage parce que leur fils vient d’en démissionner et ne répond plus au téléphone. Tout comme leur cadette, qui a aussi quitté le navire. Selon son habitude – d’après les témoignages entendus ensuite au procès –, il passe ses nerfs sur sa femme et profère des menaces de mort alors qu’il est en état d’ébriété. Cela dure depuis quarante-sept ans. Quand elle n’en peut plus, Jacqueline se réfugie à l’extérieur, pour enlacer un arbre. Ou alors, comme en ce début d’après-midi, elle avale un somnifère. Norbert Marot l’extirpe de son sommeil. Il tambourine à la porte et la pousse dans le couloir : « Va faire la soupe ! » Face aux plaques de cuisson, il lui arrache son collier et lui donne un coup au visage. Sa lèvre inférieure saigne. Dans son esprit, dira-t-elle, « ça fait comme une étincelle ». Jacqueline Sauvage se relève et remonte dans la chambre s’emparer d’un fusil Beretta. Elle perd toute notion du temps. Était-il 16 heures ? Ou alors déjà 19 heures ? Elle finit par redescendre. Son mari sirote un whisky sur leur terrasse. Elle le vise trois fois de dos, « en fermant les yeux », insistera-t-elle. Chasseuse aguerrie, la sexagénaire ne rate pas sa cible. À 19 h 27, elle appelle les pompiers : « Venez, j’ai tué mon mari. » Placée en garde à vue, elle apprend que son fils Pascal ne répondait plus au téléphone parce qu’il s’était pendu deux jours plus tôt. Dans la famille Marot, il ne reste plus que des femmes.
Mise en examen pour le meurtre de son conjoint – une circonstance aggravante, que l’on soit homme ou femme –, Jacqueline Sauvage est jugée en octobre 2014 devant les assises du Loiret. Elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
Ses trois filles défilent à la barre pour avouer combien elles sont soulagées par la mort de ce père qui les a violées lorsqu’elles étaient enfants. « Il m’a détruite intérieurement », dit l’une d’elles. Aucune des quatre femmes n’a jamais porté plainte, ni pour violences conjugales ni pour inceste. Jacqueline Sauvage savait pour les viols commis sur ses filles, mais elle « n’arrivait pas à croire qu’il ait fait ça », confesse-t-elle dans son livre autobiographique 1Jacqueline Sauvage, Je voulais juste que ça s’arrête, Fayard, 2017.. Norbert, c’est son premier amour, celui rencontré à 15 ans, en 1963, alors qu’il sort de maison de correction. « Malgré sa réputation sulfureuse, écrit-elle, toutes les filles lui couraient après. C’était le mauvais garçon du coin. » C’est elle qu’il choisit, même s’il reste volage. « Je l’avais dans la peau. Je pensais à lui en m’endormant, en m’éveillant, et m’étonnais qu’il ne m’ait pas plaquée une fois obtenu ce qu’il désirait. » Elle tombe enceinte à 17 ans. L’adolescente dissimule d’abord sa grossesse avant de l’épouser contre l’avis des siens. Jeune mariée, elle multiplie les petits boulots : travaux de couture, ménages à domicile. Norbert est bientôt appelé au service militaire. Il rentre les fins de semaine et garde ce rythme lorsqu’il devient chauffeur routier : au volant la semaine, de retour le vendredi soir. La famille occupe une petite maison, sans eau courante ni électricité. Mais le couple économise assez pour faire construire à La Selle-sur-le-Bied. Ils y installent leur propre société de transport, assurant des livraisons de céréales et de betteraves, jusqu’à bénéficier d’une certaine aisance. Revers de la médaille, Norbert reste à demeure.
« Sa vie lui a appris à garder les yeux secs »
« Jacqueline Sauvage était fière de sa réussite sociale. Elle s’est efforcée toute sa vie de montrer qu’elle avait eu raison d’épouser cet homme », décrit le journaliste Philippe Renaud, qui a couvert le premier procès en 2014 pour le quotidien régional La République du Centre. « L’affaire n’intéressait personne », souligne ce chroniqueur judiciaire aujourd’hui retraité. L’accusée, elle, semble de nature « très réservée, avec des difficultés à s’exprimer ». L’avocate générale – comme le rapporte France Bleu – s’en étonne : « Il n’y a pas eu de larmes. » Charles Dubosc, l’avocat de la défense, du barreau de Montargis, réplique : « Sa vie lui a appris à garder les yeux secs. » Sa cliente est condamnée à dix années de réclusion. Philippe Renaud publie le verdict sur l’AFP, l’agence de presse pour les professionnel·les de l’information, dont il est aussi le correspondant. La dépêche est reprise dans le flux de plusieurs sites, notamment du Parisien qui titre : « Loiret : 10 ans de prison pour avoir tué son mari violent qui abusait de ses filles. »
Une présidente dubitative sur les violences intrafamiliales
À Paris, Corinne Audouin, l’une des voix du service police-justice de France Inter, lit cet article du Parisien et flaire « le truc bizarre ». Elle fait le déplacement à Blois pour couvrir l’appel, en décembre 2015. Elle y retrouve deux consœurs de la presse nationale 2Louise Colcombet du Parisien était également présente, ainsi qu’Anaïs Condomines, envoyée par le site d’information Metronews. : « Nous faisions des bonds sur notre banc. La façon dont ça se passait n’allait vraiment pas », se remémore la journaliste, qui en parle encore avec ferveur. « Je trouve qu’elle a été très mal jugée. La présidente ne disait pas qu’il n’y avait pas eu de violences dans cette famille. Mais on sentait qu’elle était dubitative. »
L’une des filles Marot, Fabienne, raconte avoir osé, une seule fois, après une fugue quand elle avait 17 ans, dénoncer un viol au commissariat. Son père s’y était précipité pour lui hurler de l’extérieur d’en ressortir. Le gendarme est sorti. La fille en a profité pour déchirer sa déposition. Quand l’officier a cherché le document : « J’ai avoué l’avoir détruite et j’ai pris une baffe monumentale », livre Fabienne. La présidente coupe : « C’est difficile à croire […]. [Un policier] vous met une claque… Je ne peux pas vous laisser dire de telles choses ! » C’est l’une de ces saillies qui font bondir Corinne Audouin : « La présidente semblait persuadée que les filles inventaient les viols pour aider leur mère. Moi, je sentais que c’était vrai. Ça sortait comme ça venait. Il y avait une terreur qui régnait dans cette famille. Il traitait toutes les femmes de “pute”. Fabienne, comme elle a fait pipi au lit tard, il l’appelait “la pisse”. »
La présidente de la cour, Catherine Paffenhoff, a répondu à ces critiques une seule fois, dans un livre enquête des journalistes Hélène Mathieu et Daniel Grandclément. « J’ai pu paraître dure parce que je cherchais à pousser Mme Sauvage dans ses retranchements, à lui faire appréhender la gravité de son acte, leur a‑t-elle confié. Personne dans l’entourage proche de l’accusée ne prenait en compte la dimension criminelle des accusations portées contre Jacqueline Sauvage, ni la gravité des faits. »
Au fil de leur vie maritale, Jacqueline Sauvage a su faire preuve de détermination pour rester avec Norbert. Quand elle découvre qu’il a noué une relation extraconjugale, elle n’hésite pas à menacer et gifler la maîtresse, et à la poursuivre en voiture. Norbert « était une brute, mais c’était sa brute à elle », nuance Corinne Audouin. « On sentait qu’elle l’avait beaucoup aimé. Elle avait du mal à dire que c’était une ordure. Elle lui trouvait des excuses. »
La chroniqueuse, pionnière du « live-tweet » judiciaire, partage ces observations sur Twitter. « Je n’imaginais pas que ça puisse être instrumentalisé, en positif comme en négatif. » Elle signale que l’interrogatoire de l’accusée – un moment crucial pour la défense – débute passé 20 heures, après dix heures d’audience : « C’est juste indigne », poste-t-elle. Quand elle révèle qu’aucun·e expert·e psy n’est entendu·e à l’audience, faute de défraiement jusqu’à Blois, elle lâche un « surréaliste ». Cette absence d’expert·e est d’autant plus problématique que la défense de l’accusée repose, lors de ce procès en appel, sur des notions psychologiques complexes.
« Tuer pour survivre » ou la légitime défense différée
Deux anciennes avocates d’affaires parisiennes, Janine Bonaggiunta et Nathalie Tomasini, se sont emparées du dossier en janvier 2015. Les deux associées se sont spécialisées à partir de 2011 dans la défense des femmes – victimes ou accusées – au moment où la notion de violences psychologiques émerge dans les tribunaux, à la faveur de la loi du 9 juillet 2010, qui les a inscrites dans la liste des infractions commises entre conjoint·es. Elles avaient obtenu une victoire historique dès 2012, aux assises de Douai (Nord), lorsque leur cliente, Alexandra Lange, était devenue la première femme acquittée après avoir tué un conjoint violent, au titre de la légitime défense. Selon l’article 122–5 du Code pénal, la riposte doit être immédiate, nécessaire et proportionnée à l’attaque. Ce verdict avait été grandement orienté par le réquisitoire de l’avocat général, Luc Frémiot : « Alexandra Lange, elle a toujours été seule. Moi, aujourd’hui, je ne veux pas la laisser seule et je suis à ses côtés. Vous n’avez rien à faire dans cette salle d’assises. Et c’est la société qui vous parle. Acquittez-la ! »
À l’issue du verdict en première instance condamnant Jacqueline Sauvage à dix ans de prison, une équipe de télévision avait contacté les deux avocates pour recueillir leurs réactions. « Sans même connaître le dossier, cette condamnation nous paraissait injuste », affirme à La Déferlante Nathalie Tomasini. Elles adressent alors une lettre à la détenue pour lui signifier qu’elles « comprennent son passage à l’acte » et seraient « éventuellement à sa disposition ».
Leur stratégie est audacieuse : plaider la légitime défense différée, qui n’existe pas dans le droit français. Cette notion a émergé dans les tribunaux canadiens dès 1990 lors du jugement d’Angélique Lyn Lavallée, acquittée après avoir tué de deux balles dans le dos son conjoint violent. La preuve d’un « syndrome de la femme battue » avait été apportée par l’expert psychiatre, le docteur Fred Shane : « Je pense qu’elle a senti […] que sa vie était en jeu et qu’à moins qu’elle ne se défende, qu’elle ne se montre violente, elle allait mourir. » Une référence aux travaux de la psychologue américaine Leonore Walker, qui a apporté dans les années 1970 un cadre théorique de référence pour appréhender ces violences intimes 3Leonore E. Walker, The Battered women, Harper & Row, 1979 (non traduit en français).. Cette pionnière a développé l’idée de « cycle de l’abus » : ces alternances de phases où la tension monte, explose, et celle où le conjoint agresseur se repent, avant de recommencer, toujours un peu plus fort. Les victimes contractent ce que Walker nomme « l’impuissance apprise », cette incapacité à se libérer d’une longue relation violente. Et c’est dans cet écueil que peut venir se loger le « syndrome de la femme battue ». « Cette femme n’avait d’autre choix raisonnable que de tuer pour vivre », explicite Nathalie Tomasini, qui a découvert ces travaux en préparant la défense d’Alexandra Lange. Lorsque le dossier Sauvage arrive sur son bureau, elle fait tout de suite le lien avec l’arrêt Lavallée au Canada, et estime qu’il est temps d’importer en France le débat sur les contours de la légitime défense. « Notre définition actuelle a été conçue par des hommes pour des hommes qui se retrouveraient dans des rixes. »
À Blois, les avocates plaident : « Vous avez les pouvoirs de repousser les limites de la définition de cette légitime défense appliquée aux situations de violences conjugales […] Peut-être qu’à travers ce procès, la société va définitivement comprendre pourquoi les victimes de violences conjugales peuvent tuer pour survivre. En prononçant l’acquittement de Jacqueline Sauvage, vous ferez justice. »
Le discours est bien ficelé mais il provoque peu d’écho chez les juré·es. « En une heure, j’avais déjà compris que la légitime défense différée n’allait pas passer dans le Loiret », se souvient la chroniqueuse judiciaire Corinne Audouin. Pourtant les avocates s’accrochent à leur stratégie tout au long des trois jours de procès. « Elles ont voulu refaire un procès de Bobigny 4En 1972, l’avocate Gisèle Halimi défend une jeune fille poursuivie pour avoir avorté, à la suite d’un viol, à l’âge de 16 ans. Quatre autres femmes, dont la mère, étaient jugées pour complicité ou pratique de l’avortement. L’issue de ce procès dit « de Bobigny » avait contribué au changement législatif, avec la loi Veil pour la légalisation de l’IVG en 1975., mais elles ont fait preuve de beaucoup d’amateurisme », tacle la journaliste, pour qui « ces avocates ont défendu une cause plus qu’une cliente ».
Nathalie Tomasini assume : « Je fais d’un cas particulier une affaire emblématique pour défendre les autres victimes. C’est ce qui s’appelle plaider en rupture, comme Gisèle Halimi. » Après cinq heures de délibéré, la peine de dix ans de réclusion criminelle est confirmée en appel. Sur Twitter, Corinne Audouin poste une photo de la condamnée embrassant, avec émotion, les mains de ses avocates à travers la vitre du box. Fin de l’acte.
Le « coup de poker » réussi de la pétition
Karine Plassard entre en scène. Cette ex-militante d’Osez le féminisme ! a suivi le live-tweet. Quand la sentence est tombée, « j’ai été hyper en colère », glisse la responsable de mission Égalité à la mairie de Clermont-Ferrand. « Cette femme, en prison, c’était l’aboutissement des dysfonctionnements de la société. » Elle rédige une pétition « Libération immédiate de Jacqueline Sauvage », qu’elle met en ligne sur change.org quelques heures après le délibéré. Au moment de valider, la plateforme lui demande de choisir un objectif. Le pourvoi en cassation ? Le Conseil de l’Europe ? La grâce présidentielle ? Karine Plassard coche par défaut la dernière option parce que les autres procédures nécessiteraient des années de bataille. « Un coup de poker, sourit-elle. Je n’ai pas imaginé une seconde que ça allait réussir. » Change.org la fusionne avec une initiative similaire, celle de Carole Arribat, une autrice 5Carole Arribat a notamment publié le récit Si seule… Ment. Violence conjugale, ma secte, éditions Kawa, 2016.jusque-là inconnue de la galaxie militante. Au bout d’une semaine, la pétition cumule déjà 60 000 signatures.
Carole Arribat et Karine Plassard se rencontrent à Paris le 12 décembre 2015, au premier rassemblement de soutien, impulsé spontanément par Véronique Guegano, commerciale, qui s’est sentie elle aussi concernée. « Quand j’ai vu les paraboles télé sur la place, j’ai pensé qu’il y avait une autre manifestation ! », s’en amuse encore Karine Plassard. Deux cents personnes répondent présentes, dont les deux avocates de Jacqueline Sauvage, des militantes Femen et le collectif Les effronté·es. Des pancartes « Justice Sauvage » surplombent les têtes. Un comité de soutien est bientôt mis sur pied, présidé par la comédienne Éva Darlan. L’actrice Anny Duperey y adhère, avec des femmes politiques de gauche comme Anne Hidalgo, mais aussi Valérie Boyer, alors députée LR des Bouches-du-Rhône. Cette élue visite la détenue dans sa cellule, en janvier 2016, accompagnée de Nathalie Kosciusko-Morizet, à l’époque députée LR de l’Essonne. Quelques jours plus tard, une poignée d’activistes Femen se regroupe à l’entrée du centre pénitentiaire de Saran (Loiret). Armées de pioches, elles mettent en scène une tentative d’évasion souterraine de la détenue Jacqueline Sauvage, devenue le symbole des victimes de violences conjugales.
Le « mythe de la non-violence féminine » interrogé
« L’affaire Sauvage médiatique s’est éloignée de la vraie affaire judiciaire », analyse la journaliste Corinne Audouin. À mesure que le compteur des signatures s’emballe, jusqu’à engranger 430 000 noms, et que les articles se multiplient dans la presse, toute la complexité de l’affaire semble s’évaporer pour se réduire à un slogan : « battue pendant 47 ans ». Corinne Audouin : « On en a fait une chose fragile alors qu’elle ne l’était pas. Je trouve qu’on lui dénie ce qu’elle est. Son acte était le sien. Elle a été à la fois auteure et victime. »
C’est tout le paradoxe de cette affaire, qui vulgarise des notions jusqu’alors confidentielles comme l’emprise, mais qui alimente aussi le « mythe de la non-violence féminine ». Un « éternel évitement », selon les chercheuses Coline Cardi et Geneviève Pruvost de « penser la violence des femmes6 Penser la violence des femmes, titre de l’ouvrage collectif publié sous la direction des sociologues Coline Cardi et Geneviève Pruvost, La Découverte, 2012. Lire aussi notre entretien avec Coline Cardi dans La Déferlante n° 3, septembre 2021. », y compris dans les rangs féministes.
« On en a fait une chose fragile alors qu’elle ne l’était pas. Son acte était le sien. Elle a été à la fois auteure et victime. »
Corinne Audouin, journaliste à France Inter
« Les portraits tirés par les féministes des femmes coupables d’homicides sont le plus souvent ceux de sujets qui n’ont pas d’autonomie », souligne la criminologue Colette Parent, qui a participé à l’ouvrage collectif en s’appuyant sur le travail de l’universitaire australienne Belinda Morissey. « Ils reconduisent les représentations traditionnelles des femmes […] Or si ces portraits peuvent contribuer à exonérer en partie les femmes des accusations portées contre elles, ils ont pour effet, comme le souligne Morissey, de faire l’impasse sur les choix faits par ces femmes. Choix que l’on peut comprendre et approuver moralement ou non. »
Point d’orgue de ce mécanisme de lissage : la diffusion du téléfilm inspiré de cette affaire le 1er octobre 2018 sur TF1. Muriel Robin incarne le rôle-titre. Le filet de sang qui coulait sur sa lèvre inférieure le jour du meurtre se transforme en blessure sanguinolente sur son visage. Tout est exagéré, distordu, pour bien faire comprendre : elle est la victime, lui le bourreau, et elle n’avait d’autre choix que de le tuer.
Cette fiction amènera l’avocat général du procès en appel, Frédéric Chevallier, à se fendre d’une tribune dans Le Monde 7« Lettre à Madame Jacqueline Sauvage », tribune de Frédéric Chevallier, Le Monde, 1er octobre 2018. : « Vous présenter comme soumise et sous l’emprise de ce “tyran” de Norbert, c’était nier totalement votre personnalité, dont la réalité ne correspondait plus en rien à ce que vous avez été pendant quarante-sept ans. […] Réduire votre funeste décision à un geste de survie, c’est nier le sens même de votre vie déterminée. »
Le 31 janvier 2016, François Hollande accorde une grâce partielle. La période de sûreté est levée. Mais le juge d’application des peines refuse deux fois la libération conditionnelle. « On avait face à nous une justice revancharde qui réglait ses comptes avec le président de la République, assène Karine Plassard. Ça m’a questionnée sur ce qu’on fait au nom de la cause. La justice n’a pas aimé cette médiatisation. Jacqueline Sauvage a payé pour tout ça. » Pour autant, pas question d’abandonner. « J’avais lancé une bombe médiatique mais Jacqueline Sauvage ne m’avait rien demandé. Je lui devais d’aller au bout. Autrement, je n’aurais plus jamais pu me regarder en face. »
Pas de jurisprudence, un changement de regard
La course de fond dure encore une année. Le 28 décembre 2016, à 16 h 12, le chef de l’État publie sur Twitter : « J’ai décidé d’accorder à Jacqueline Sauvage une remise gracieuse du reliquat de sa peine. Cette grâce met fin immédiatement à sa détention. » Deux heures plus tard, Jacqueline Sauvage franchit les portes du centre pénitentiaire de Saran pour rentrer chez elle, à La Selle-sur-le-Bied, entourée de ses filles, de ses petits-enfants et de son chien. Le 23 juillet 2020, elle décède dans son sommeil, d’« épuisement » d’après son avocate. Elle avait 72 ans.
L’affaire Sauvage n’aura pas fait jurisprudence. Mais elle a marqué un tournant pour la société. « C’est précurseur du mouvement #MeToo », estime Nathalie Tomasini, qui dirige désormais seule un cabinet. Corinne Audouin de France Inter abonde : « Cette affaire a ouvert le couvercle des violences conjugales. » Ces dernières années, dans les prétoires, elle a vu « de l’espoir » : « des jeunes magistrats, formés à ces questions, travaillent avec les associations et la police pour la prise en charge des victimes et des auteurs. Il était temps. » •
10 septembre 2012
Jacqueline Sauvage tue Norbert Marot de trois balles dans le dos. Ils étaient mariés depuis quarante-sept ans.
28 octobre 2014
Jacqueline Sauvage est condamnée à dix ans de prison lors de son premier procès devant les assises
du Loiret. Elle fait appel.
3 décembre 2015
La peine de dix ans est confirmée en appel par la cour d’assises de Loir-et-Cher.
31 janvier 2016
Le président François Hollande accorde une grâce partielle à Jacqueline Sauvage (commuée en grâce totale le 28 décembre).
23 juillet 2020
Jacqueline Sauvage meurt chez elle, dans son sommeil, à 72 ans.