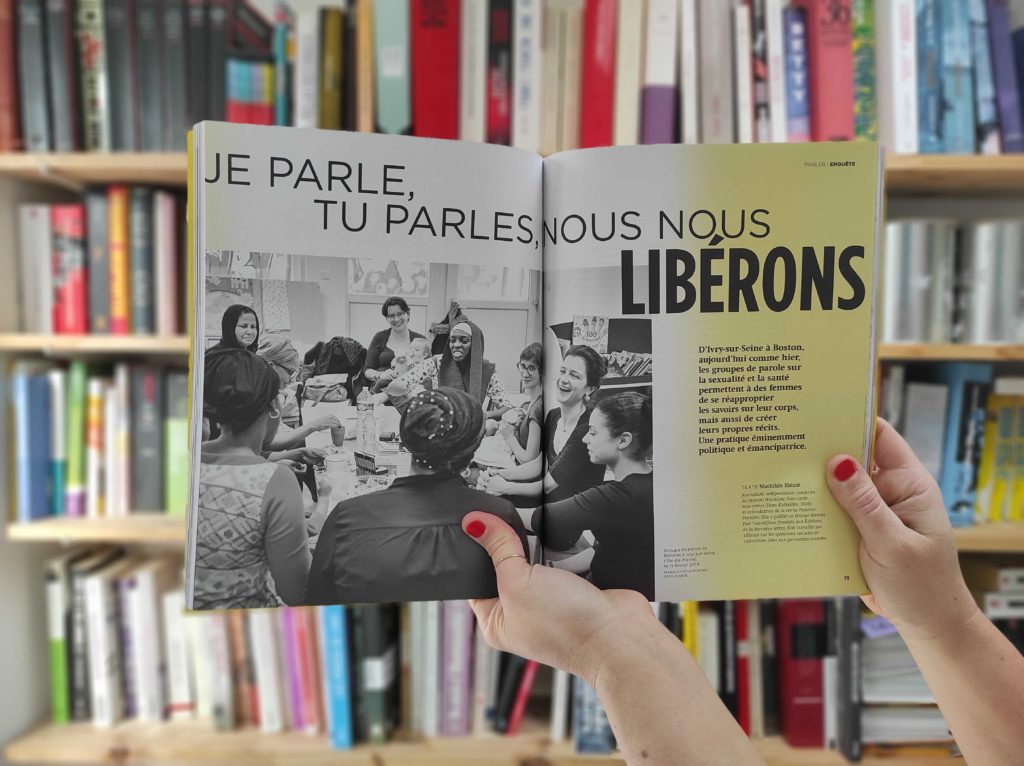C’est l’histoire d’une sortie éclair. Quelques jours entre fin juin et début juillet 2000 qui font basculer une œuvre féministe attendue en brûlot pornographique interdit en salle :
« Fait avec l’équivalent de 200 000 euros aujourd’hui, ce film est devenu un phénomène qui nous a échappé. On voulait faire des T‑shirts Baise-moi parce que ça nous faisait rigoler, comme plein d’autres gens. À l’époque, il n’y avait pas de réseaux sociaux, mais on ne s’attendait pas à l’ampleur que ça allait prendre », se rappelle aujourd’hui Virginie Despentes, coréalisatrice du film.
Sorti le 28 juin 2000 alors qu’elle n’a que 31 ans, Baise-moi raconte l’épopée sexuelle, sanglante et vengeresse de Manu (Raffaëla Anderson) et Nadine (Karen Bach), dont le point de départ est le viol de la première. Adapté du roman éponyme de Despentes sorti en 1993 aux éditions Florent Massot (réédité en 1998 par Grasset), vendu à des centaines de milliers d’exemplaires – après un démarrage confidentiel –, il relève d’un féminisme qui se revendique « avant-gardiste », voire guerrier, avec « un goût certain pour la provocation », d’après son autrice dans un entretien au Figaro le 9 juin 2000.
Dans King Kong Théorie, elle reviendra sur l’affaire Baise-moi pour souligner le sexisme dont cette œuvre collective a été la cible. « On n’entend jamais parler dans les faits divers de filles, seules ou en bandes, qui arrachent des bites avec les dents pendant les agressions, qui retrouvent les agresseurs pour leur faire la peau, ou leur mettre une trempe. Ça n’existe, pour l’instant, que dans les films réalisés par des hommes. La Dernière Maison sur la gauche, de Wes Craven, L’Ange de la vengeance, de Ferrara, I Spit on your Grave de Meir Zarchi, par exemple. Les trois films commencent par des viols plus ou moins ignobles (plutôt plus que moins, d’ailleurs). Et détaillent dans une deuxième partie les vengeances ultrasanglantes que les femmes infligent à leurs agresseurs. Quand des hommes mettent en scène des personnages de femmes, c’est rarement dans le but d’essayer de comprendre ce qu’elles vivent et ressentent en tant que femmes. C’est plutôt une façon de mettre en scène leur sensibilité d’hommes, dans un corps de femme. […] Dans ces trois films, on voit donc comment les hommes réagiraient, à la place des femmes, face au viol. Bain de sang, d’une impitoyable violence. Le message qu’ils nous font passer est clair : comment ça se fait que vous ne vous défendez pas plus brutalement ? Ce qui est étonnant, effectivement, c’est qu’on ne réagisse pas comme ça. Une entreprise politique ancestrale, implacable, apprend aux femmes à ne pas se défendre. Comme d’habitude, double contrainte : nous faire savoir qu’il n’y a rien de plus grave et, en même temps, qu’on ne doit ni se défendre, ni se venger. »
« Un crime de lèse-phallus », selon la formule du critique et historien du cinéma Noël Burch qui lui vaudra les foudres non seulement de l’extrême droite catholique, mais aussi d’une certaine gauche en perte de vitesse. Avec un petit effet Streisand à la clé : en l’interdisant, les censeurs ont attiré sur le film l’attention du public – y compris hors des frontières de la France –, et réuni des personnes qui, sans ce scandale, ne se seraient peut-être jamais rencontrées.
Première censure depuis des décennies
Avant sa sortie, le film obtient son visa d’exploitation – indispensable à sa diffusion en salle – à l’issue d’une délibération de la commission de classification du Centre national du cinéma (CNC). Interdit aux moins de 16 ans, Baise-moi est assorti d’un avertissement alertant sur les scènes de violence et de sexe. L’interdiction aux moins de 18 ans, instituée par Michel Debré en 1961 pour sauvegarder la « morale de la jeunesse en péril », avait été supprimée en 1990 par Jack Lang, ministre de la culture sous Mitterrand. Mais coup de théâtre, deux jours après la sortie du film dans une soixantaine de salles en France : le vendredi 30 juin, le Conseil d’État, saisi par l’association d’extrême droite Promouvoir, retire le visa d’exploitation du film.
En prenant cette décision, le Conseil d’État prononce une sentence lourde de conséquences. La seule façon pour le film d’être diffusé serait en effet d’être classé X. Or les productions de cette catégorie ne peuvent recevoir aucune des subventions qui irriguent l’économie du cinéma français. Elles sont soumises à une taxe fiscale de 20 % sur les bénéfices commerciaux qu’elles génèrent et ne peuvent être projetées que dans des circuits spécialisés. Comme il n’y a plus vraiment de cinémas pornos en France, les films X sont condamnés à vivre dans l’ombre, sans publicité.
Pour les réalisatrices et la production, il est hors de question de se laisser « ixer ». Non que le porno leur fasse honte. Mais pour Despentes, « ce n’était pas un film érotique, ni masturbatoire ». « Et même si Baise-moi peut exciter des gens, reconnaissait-elle lors du Festival des journées cinématographiques dionysiennes en 2015, ce n’est visiblement pas sa vocation première ».
Cette censure contre un film est une première depuis des décennies. C’est en 1966 avec la sortie de Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot de Jacques Rivette, l’un des réalisateurs phares de la Nouvelle Vague, que le couperet est tombé pour la dernière fois.
Pour Baise-moi, une association d’extrême droite, Promouvoir, a décidé d’attaquer l’État. Présidée à l’époque par André Bonnet, avocat fiscaliste de profession et ancien responsable du MNR (Mouvement national républicain), elle a été créée en 1996, avec l’objectif affiché de « défendre la dignité de la personne humaine et protéger les mineurs à travers la “promotion des valeurs judéo-chrétiennes” ».
L’interdiction de Baise-moi est son premier coup d’éclat. L’État est même condamné à verser 10 000 francs – environ 1 500 euros – à l’association, et le jugement du Conseil d’État va jusqu’à reprocher au film de ne pas être assez féministe. « Baise-moi est composé pour l’essentiel d’une succession de scènes de grande violence et de scènes de sexe non simulées, sans que les autres séquences traduisent l’intention, affichée par les réalisatrices, de dénoncer la violence faite aux femmes par la société », indique son communiqué.
Au-delà du jugement moral, religieux et politique, Virginie Despentes pense que le film a aussi choqué en raison du choix de sa coréalisatrice et des actrices principales, qui ont d’abord fait carrière dans le porno et qui ne viennent pas du sérail. A posteriori, elle pointe également le racisme des réactions de l’époque : « Le fait qu’une actrice d’origine algérienne et qu’une autre d’origine marocaine, deux filles issues de la colonisation, soient violées et se mettent à tuer tout le monde les a inquiétés. »
Les réactions envers le film sont si violentes que la coréalisatrice, Coralie Trinh Thi, une pornostar célébrée dans le milieu du X, expliquera plus tard dans son livre autobiographique La Voie humide (Au diable vauvert, 2007), être sortie traumatisée de cette expérience dans le cinéma dit « traditionnel ».
Critiques assassines et soutiens
Fin juin 2000, Baise-moi donne lieu à une salve de critiques négatives. La rédaction en chef du Parisien a demandé à une équipe de journalistes femmes de visionner le film. Leur critique est sans appel. « Baise-moi est un mauvais film. Pire encore, un film totalement dénué d’intérêt. Sexe, drogue, sexe, meurtre, sexe, alcool, vomi, sexe, meurtre, la dérive de Manu [Raffaëla Anderson] et Nadine [Karen Bach] se résume à cela », assènent les journalistes, pour qui le film « se vautre […] sans raison dans la laideur, le sordide, la violence la plus gratuite ».
Pascal Mérigeau dans Le Nouvel Obs estime pour sa part qu’« humiliation, sadisme, bêtise sont les moteurs et les raisons d’être de Baise-moi, qui n’exprime jamais que la haine du monde et le mépris de soi […]. Plus que l’intrusion du hard dans le cinéma “standard” […], c’est cette dérive qui inquiète, ce refus de la pensée, cette incapacité à réfléchir sur la mise en œuvre des pulsions et sur les moyens de cette mise en œuvre. Le film au service de la barbarie, en quelque sorte ».
Cette unanimité contre un film que la censure est en train de tuer dans l’œuf conduit plusieurs personnalités à prendre sa défense, à commencer par la réalisatrice Catherine Breillat. Elle aussi est autrice d’œuvres qui défient la loi morale par leur liberté de ton et le discours porté sur la sexualité. Un an plus tôt, en 1999, elle a sorti Romance, un film sur l’exploration du plaisir féminin, avec, entre autres, la star du X Rocco Siffredi au casting. Elle ressent viscéralement le risque que la censure de Baise-moi fait courir au cinéma qu’elle défend.
« Tous les journaux de gauche auraient dû s’unir pour débattre de ce que c’est qu’un film pour adultes », regrette-t-elle aujourd’hui en critiquant vertement Laurent Joffrin, à l’époque à la tête du Nouvel Obs, qui avait publié une tribune intitulée « Sexe, violence, le droit d’interdire » : « La gauche ringarde telle qu’[il] incarne a abondé dans le sens d’André Bonnet [président de Promouvoir]. Je l’accuse d’avoir institué la liberté d’interdire. » Catherine Breillat avoue n’avoir jamais manifesté avant Baise-moi mais, très émue par l’interdiction du film de Virginie Despentes et Coralie Trinh Thi, elle lance la mobilisation pour le soutenir.
Sa tribune paraît dans Libération le 5 juillet 2000. Elle réclame, aux côtés d’acteur·rices du monde du cinéma comme Romain Goupil, Tonie Marshall, Jeanne Labrune, Claire Denis, Miou-Miou, « l’instauration immédiate par décret de visas d’exploitation de films réservant leur vision – comme le droit de vote – à l’accession à la majorité de 18 ans », autrement dit la possibilité d’autoriser un film aux plus de 18 ans dans les salles traditionnelles de cinéma, sans le condamner à vivoter dans des salles pornos inexistantes. « Tout le monde l’a signée, se souvient la réalisatrice. Même des gens qui ne m’appréciaient pas spécialement, comme Jean-Luc Godard et Claude Lanzmann. » Et le soir même, soit une semaine après la sortie du film – qui a déjà été vu par 50 000 personnes –, un rassemblement de soutien a lieu devant le cinéma MK2 Odéon, qui a choisi de maintenir le film à l’affiche.
Retournement de la violence
Parmi les personnes présentes ce soir-là, il y a l’écrivaine et activiste Florence Montreynaud, connue pour ses positions abolitionnistes et anti-pornographie, mais qui ne se trompe pas une seconde sur le message féministe du film. « Baise-moi était à mon sens d’un intérêt exceptionnel, l’équivalent à peu près de Thelma et Louise [Ridley Scott, 1991], qui est un film d’homme, mais en un peu plus gore », raconte la cofondatrice des Chiennes de garde, l’association créée l’année précédente pour défendre les femmes contre les injures sexistes.
« J’ai vu le film de Virginie Despentes et Coralie Trinh Thi dès qu’il est sorti en salle, j’en suis ressortie galvanisée. Il retournait enfin la violence intrinsèque du viol, du harcèlement. Quand j’ai appris qu’il allait être censuré, j’ai mis en branle tout mon réseau, d’autant que c’était le premier film réalisé par des femmes à être concerné par cette interdiction. » Une vingtaine de militantes du collectif se retrouve donc devant le MK2 Odéon ce soir-là.
Marin Karmitz est présent aussi. Fondateur et gérant de cette chaîne de cinéma, il fait de la résistance au nom de la liberté d’expression. « On ne pratique pas la censure dans notre réseau de salles, même quand ce sont des films que je n’aime pas, qui ne m’intéressent pas ou que je n’ai pas vus, explique-t-il aujourd’hui. Ces projections permettent de discuter de l’œuvre programmée et de sa raison d’être dans nos salles. On s’interdit, par contre, tout ce qui relèverait d’une expression d’extrême droite ou de violence fasciste. Je ne connaissais pas l’œuvre de Despentes et n’avais pas vu le film. À partir du moment où mon programmateur, en qui j’ai toute confiance, a décidé de le diffuser, j’ai suivi. Ça ne me gênait pas du tout que le film soit interdit aux moins de 18 ans, je ne pense pas que tout doive être vu par les jeunes. Quand on n’a pas la majorité, des choses peuvent nous être interdites et c’est normal. Ce qui n’est pas normal, c’est qu’il soit interdit aux plus de 18 ans. »
L’affaire entraîne le rétablissement d’une ancienne classification, permettant l’interdiction aux moins de 18 ans pour des films non classés X. Baise-moi ressort en 2001, mais il a déjà été massivement diffusé en vidéo. Précédé de son aura de film censuré, il a fait « une carrière extraordinaire » à l’étranger pour un film français, souligne Virginie Despentes. « Je ne sais pas si ça aurait été le cas sans le coup de projecteur de Promouvoir », se demande la coréalisatrice, qui a fait une longue tournée des festivals hors de l’Hexagone.
Marin Karmitz est plus amer quant à la suite des événements, qui l’a vu se coltiner des années de procédure contre l’association Promouvoir. Un combat qu’il dit avoir dû mener seul. De même, Catherine Breillat a, elle aussi, dû faire face à des procédures dans une certaine solitude. Virginie Despentes, elle, se souvient que Karmitz n’avait pas voulu lui serrer la main. « Il aurait préféré que ce soit Godard plutôt que nous », cingle-t-elle aujourd’hui.
Vingt ans après, toujours puritanisme et morale
Avec le recul, l’affaire Baise-moi semble par ailleurs avoir joué un rôle de catalyseur dans l’histoire des idées, en polarisant le débat de façon inédite. La revanche idéologique de l’extrême droite, dans un pays alors gouverné par la gauche, a éclaté deux ans plus tard avec l’accession de Jean-Marie Le Pen au second tour de l’élection présidentielle. Et le féminisme va, lui aussi, prendre un nouveau tournant (pro-sexe, queer et antiraciste), tout comme le débat sur la liberté d’expression.
Pour la journaliste, autrice et critique Iris Brey, Baise-moi est un geste disruptif dans l’industrie du cinéma qui force à réfléchir aux catégories cinématographiques. Dans Le Regard féminin, une révolution à l’écran, elle explique que ce film s’inscrit dans le genre « rape and revenge » (viol et revanche), dans lequel l’héroïne se venge contre son ou ses violeurs et pointe combien il y est rare « d’épouser le point de vue des héroïnes », comme c’est le cas dans le film de Virginie Despentes.
Serait-il possible de réaliser Baise-moi en 2021 ? Le contexte en matière de censure a en tout cas beaucoup changé, notamment à gauche : aujourd’hui, « tout le monde est hyper stressé, personne ne s’inquiète de toutes ces grandes œuvres qui ont été annulées à cause du puritanisme et de la morale », pointe Iris Brey, au diapason des débats actuels sur la « cancel culture » – cette pratique de dénonciation d’œuvres, de propos jugés problématiques qui mènerait à l’éviction des personnes qui les ont tenus du débat public ou des réseaux sociaux.
Pour Florence Montreynaud, Baise-moi reste « une catharsis essentielle comme on en a peu revu depuis, avec cette incandescence, représentant la domination masculine, qui garde tout son potentiel libérateur et montre l’envers de la pornographie ».
À l’origine de King Kong Théorie
Pour sa part, Virginie Despentes avoue avoir eu du mal à digérer l’hostilité et le manque de soutien, mais se souvient aussi de ce que cette aventure lui a apporté. « C’est comme ça que j’ai rencontré [Paul B.] Preciado [avec qui elle a vécu pendant dix ans], qui à l’époque tractait devant le MK2 pour défendre le film, Gaspar [Noé] que j’aimerai toute ma vie. Je suis vraiment reconnaissante envers Catherine Breillat, Nicole Brenez, Philippe Manœuvre… Tous ces gens qui nous ont soutenues ont été hyper importants dans ma vie. Il y a aussi une part de culpabilité hyper forte, parce que j’étais la plus âgée du groupe des quatre [avec Coralie Trinh Thi, Raffaëla Anderson et Karen Bach], la plus “privilégiée” : j’avais publié déjà trois romans et j’avais embarqué Karen, Coralie et Raf dans cette galère sans savoir que ça se passerait comme ça. On était quatre personnes différentes, sur le féminisme notamment, mais hyper fières de ce film. Une fois la censure installée, c’était super dur d’aller dans les salles, face à des journalistes et une foule pas commode. Les premières minutes étaient toujours électriques et Raffaëla faisait front, elle était précieuse, un vrai soldat. Ces moments d’hostilité nous ont encore plus soudées. »
Le film n’a pas été qu’un moment décisif dans l’histoire du cinéma français et de sa censure. « C’est de Baise-moi et de tous les entretiens autour du film qu’est né King Kong Théorie, poursuit Virginie Despentes. Tous les thèmes de ce livre : le viol, la violence, le travail sexuel… viennent de Baise-moi. J’ai vraiment eu l’impression d’avoir été remise à ma place de femme, qui fait des films de femmes, avec des femmes. Si on avait été quatre mecs, faisant des films sur notre sexualité de mecs, on aurait eu des problèmes avec Promouvoir mais on aurait été soutenues. »
Au moment où a lieu notre échange, le battage médiatique autour d’Alice Coffin sur son livre Le Génie lesbien (Grasset, 2020) est à son apogée. « À nous aussi, on nous a beaucoup demandé si on détestait les hommes, conclut Virginie Despentes. Si ça avait été le cas, on aurait fait un film plus dur. »