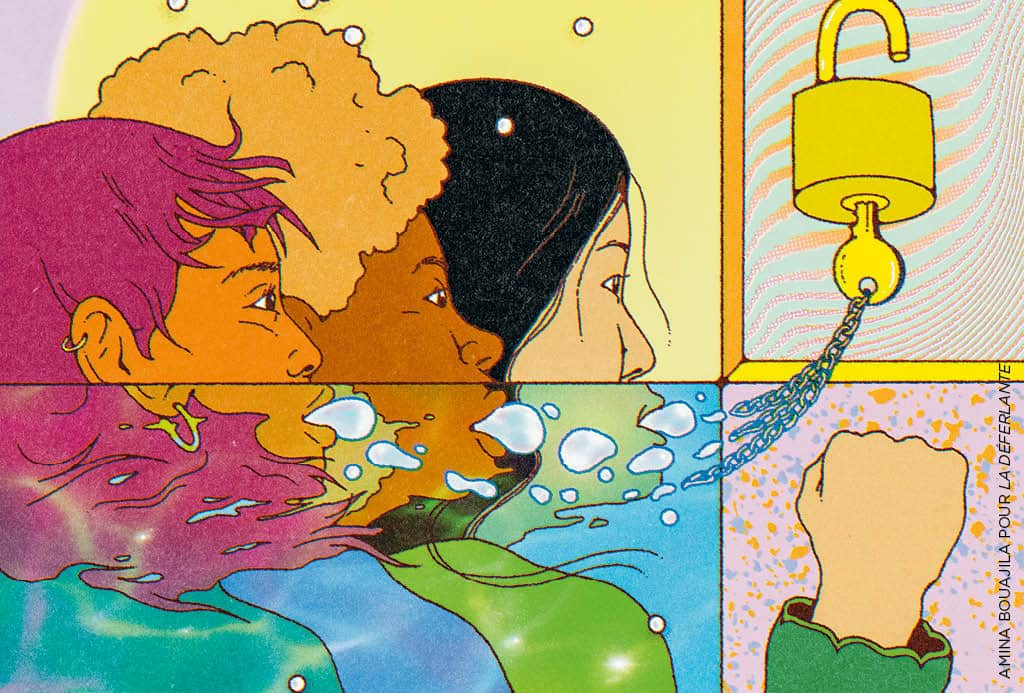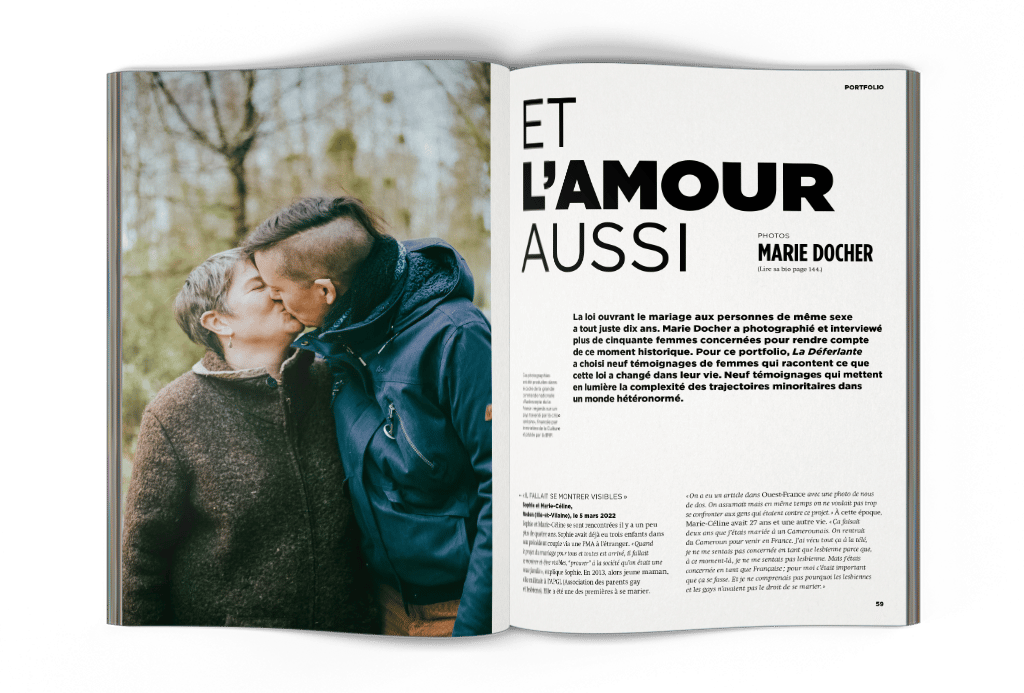Bolewa Sabourin, pouvez-vous nous raconter la création de votre association Loba qui signifie « exprime-toi » en lingala¹ ?
En 2007, on vivait en France une période très violente socialement. Le président d’alors, Nicolas Sarkozy, avait créé le ministère de l’Identité nationale. Je me souviens que l’idée de notre association nous est venue, à mon ami William Njaboum et moi, pendant un cours de hip-hop à l’école Smoking and Brillantine, dans le XIIIe arrondissement de Paris. William était étudiant en sciences économiques et danseur lui aussi. C’est d’une vibration commune que tout est parti. On a senti qu’avec la danse on trouvait un espace d’expression au-delà des mots, qui peuvent parfois manquer. Avec Loba, nous donnons des cours de danse, nous organisons des conférences et nous avons même mis sur pied un festival annuel qui mélange sculpture, peinture, rap, slam et rock. En 2012 j’ai fait un burn-out. J’ai senti le besoin de retourner voir ma grand-mère au Congo. De retour en France, j’ai repris mes études et obtenu mon master en science politique fin 2015.
Après une pause de 2012 à 2015, William et moi avons relancé l’association, en nous formant notamment à l’entrepreneuriat social. Et puis, en 2016, j’ai assisté à une intervention du docteur Denis Mukwege [qui a obtenu le prix Nobel de la paix deux ans plus tard], le gynécologue qui « répare » les femmes victimes de mutilations génitales. Avec le docteur Mukwege, ça a été un coup de foudre. Je crois que j’ai identifié en lui une figure paternelle. Il m’a raconté son travail auprès de femmes violées en République démocratique du Congo. Quelques mois plus tard, à sa demande, je lui ai soumis l’idée de « Re-création ».
Avec ce projet, vous entendez, vous aussi, « réparer » les femmes, mais par la danse. Comment procédez-vous et qui sont les participantes à vos ateliers ?
Nous avons commencé en 2017, à Bukavu au Congo, en travaillant avec Ami-Luce, la nièce du docteur Mukwege, qui menait déjà des ateliers de danse auprès de femmes victimes de viol là-bas. J’ai aussi œuvré en binôme au côté du psychologue qui était sur place. Avec les femmes, on travaillait la tête, le haut ou le bas du corps, les endroits où elles avaient subi des opérations de reconstruction lourdes. On les travaillait séparément, de manière à les dissocier pour faciliter la réappropriation de ces parties du corps traumatisées. On avait des temps de freestyle, des chorégraphies, des moments où elles partageaient leurs danses aussi, celles de leurs ancêtres, de leurs ethnies. C’était aussi ça le but : réveiller la mémoire de la résistance en interrogeant le corps, et passer par le corps pour atteindre l’esprit. Aujourd’hui, en France, nous intervenons dans sept structures médico-sociales, auprès de femmes âgées de 18 à 70 ans, primo-arrivantes et atteintes du VIH. Nous menons aussi des ateliers à l’hôpital Avicenne à Bobigny [Seine-Saint-Denis], dans les centres d’accueil pour les femmes en situation de vulnérabilité sociale ou médicale. Partout, la danse permet de faire remonter des choses que ces femmes ne peuvent pas dire d’emblée. Tout est circulaire : pour nous, c’est ça l’ubuntu² .
La méthode proposée est-elle la même pour les femmes congolaises, les primo-arrivantes ou les femmes porteuses du VIH ?
Nous adaptons les exercices aux vécus et aux corps, et nous affinons nos outils au fur et à mesure. Nous continuons à appliquer ce que nous avons découvert au Congo en 2017, c’est notre colonne vertébrale. Mais ici, l’approche est différente. Certaines femmes qui vivent avec le VIH nous racontent les innombrables thérapies, les sacs de médicaments qu’elles trimballent depuis des années. Il faut déjà penser quels outils de déconstruction mettre en place avec elles, leur faire prendre conscience qu’elles peuvent vivre jusqu’à 80 ans, par exemple. Elles n’ont pas le même vécu qu’une primo-arrivante qui peut notamment être victime de traite, mais c’est toujours la réappropriation du corps et de la psyché que l’on vise. Nous souhaitons former d’autres binômes composés de danseur·euses ou et de psychothérapeutes ; chacun avec sa sensibilité, va développer ses propres méthodes. Au final, ce sont les femmes qui suivent les ateliers qui valident l’efficacité de ce que nous proposons.
Les femmes s’engagent-elles à suivre vos ateliers pendant un temps déterminé ?
Les femmes viennent quand elles veulent et quand elles peuvent. Ce sont des endroits qui leur offrent la possibilité de se raconter et d’écouter ; nous sommes là pour faciliter la parole. C’est surtout en discutant entre elles qu’elles se réparent et se donnent de la force. La convivialité et la sororité ne sont pas seulement des mots, elles les expérimentent de façon très concrète. Nos ateliers permettent de sortir de l’isolement, de recoller des morceaux d’histoire, de recréer du lien social et émotionnel. Certaines viennent depuis trois ans. Elles sont très avancées sur leur chemin de guérison, mais elles continuent à venir pour leurs sœurs, elles se sentent utiles aux autres.
« Nous proposons des ateliers sur la thématique des violences sexuelles et sexistes. On part du cas congolais du viol de guerre en montrant que les violences sont un continuum, que l’on soit en temps de guerre ou en temps de paix. »
Bolewa Sabourin
Vous est-il parfois reproché d’être un homme hétéro cisgenre qui se donne pour mission de réparer les femmes ?
C’est toujours la question : qui valide qui ? Pour ma part, la seule validation que je cherche est celle des personnes qui bénéficient de mon travail. J’entends la critique, il est normal de refuser que ses propres combats soient récupérés par d’autres, et j’ai conscience d’être porteur de symboles qui dépassent ma propre personne. La rencontre avec le docteur Mukwege m’a aidé à me sentir légitime. Il martèle que c’est l’humanité entière qui souffre en créant des traumatismes qui se transmettent de génération en génération.
Ne serait-il pas tout aussi utile de « réparer » les hommes ? Comment faire comprendre aux hommes que la société est malade en grande partie à cause d’eux en tant que groupe social ?
En rentrant du Congo, j’ai ressenti une urgence à partager les histoires de ces femmes pour que l’on se rende compte que nous sommes tous et toutes responsables. J’ai écrit une pièce, LArmes, avec une amie autrice, Penda Diouf. On y mêle la danse, des percussions en live et les récits des victimes. De spectateurs et spectatrices, les gens du public deviennent acteurs et actrices en réfléchissant ensemble à la question : comment lutter contre les violences sexuelles et sexistes en France et au Congo, individuellement et collectivement ? Mais réparer ces femmes dans une société toujours malade, c’est vider la mer avec une petite cuillère. Il faut faire de la prévention et interpeller le grand public. Avec Loba nous intervenons dans des lycées. Pendant neuf mois, nous proposons des ateliers sur la thématique des violences sexuelles et sexistes. On part du cas congolais du viol de guerre en montrant que les violences sont un continuum, que l’on soit en temps de guerre ou en temps de paix. La question des masculinités est très importante. En 2019, nous avons proposé une concertation sur la question « C’est quoi un homme au xxie siècle ? ». Nous intervenons dans les entreprises, les écoles et auprès du grand public avec un collectif d’hommes bénévoles que nous formons à la facilitation d’ateliers.
Si les hommes ne font pas leur travail d’introspection et ne se remettent pas à leur place, c’est-à-dire à côté ou en dessous, on n’y parviendra pas. C’est aussi la raison pour laquelle nous faisons des interventions en prison, qui sont des espaces de vulnérabilité pour les femmes et pour les hommes. Notre action doit être systémique, partir du « je » pour aller vers le « nous » et inversement. •
Entretien réalisé le 15 janvier 2023 à Paris par Douce Dibondo.
1. Le lingala est l’une des quatre « langues nationales » de la République démocratique du Congo.
2. L’« ubuntu » est un mot qui existe dans (presque) toutes les langues bantoues. Il désigne une notion proche des concepts d’humanité et de fraternité. Il peut aussi signifier la volonté de se voir en autrui, d’apprendre à l’écouter pour mieux le comprendre. Le concept recouvre l’idée que les êtres humains sont liés les uns aux autres.