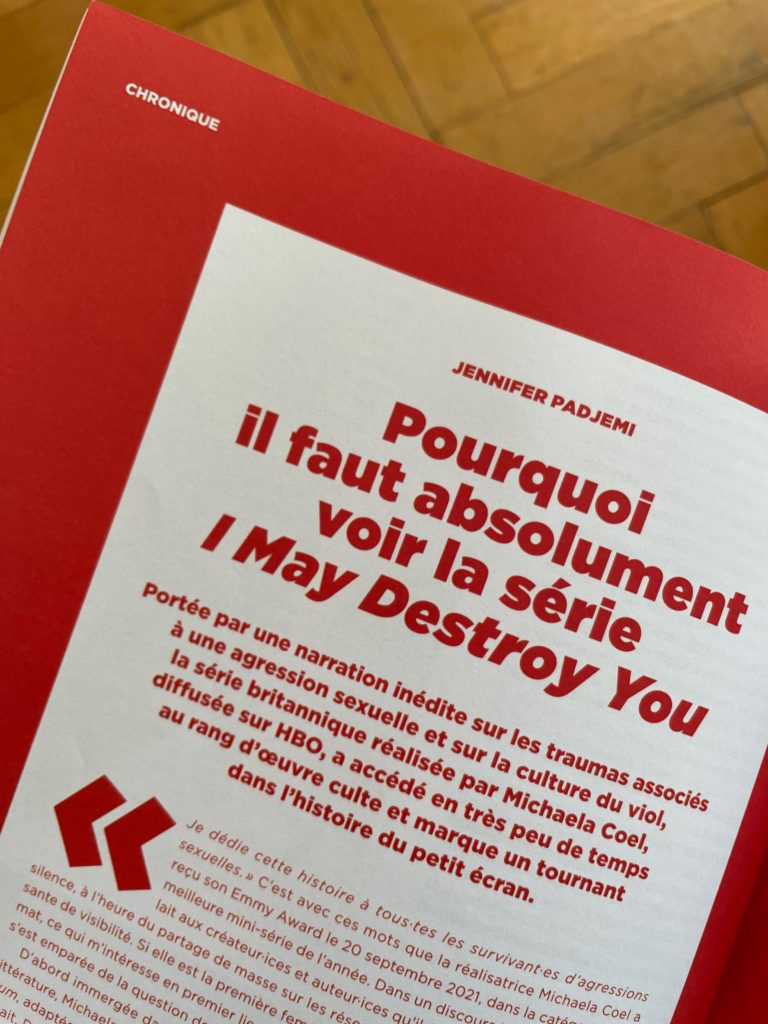Son discours était particulièrement attendu par la grande « famille » du cinéma français. Le 23 février 2024, Judith Godrèche prend la parole lors de la 49e cérémonie des Césars, dans un exercice auquel elle est désormais habituée : dénoncer les violences sexistes et sexuelles dans le milieu du cinéma.
Après sa plainte pour viols sur mineure contre les deux réalisateurs, d’autres comédiennes sont sorties du silence. Julia Roy et Isild Le Besco ont elles aussi déposé plainte contre le réalisateur Benoît Jacquot pour des faits similaires. Ce dernier a depuis été mis en examen pour viol, agression sexuelle et viol sur mineure sur Isild Le Besco et pour viol par conjoint et concubin sur Julia Roy. Dans le cas de Judith Godrèche, les faits sont prescrits. Ces témoignages ainsi que la médiatisation de l’affaire Depardieu (1) ont permis de relancer la lutte contre les VSS dans le milieu du cinéma, et ont eu un effet immédiat : en mai 2024, l’Assemblée nationale a créé une commission d’enquête parlementaire (2).
Après 2017 et l’avènement médiatique du mouvement MeToo (3), de nombreuses artistes ont dénoncé des violences sexistes et sexuelles dans les milieux culturels. Dans les arts considérés comme « nobles » que sont le cinéma et la littérature, les prises de parole de victimes se sont multipliées, d’Adèle Haenel en novembre 2019 à Vanessa Springora avec Le Consentement (Grasset, 2020).
Mais les témoignages d’artistes racisées demeurent dans un angle mort. Leurs récits sont plus rares, et moins pris au sérieux, comme le montre notre enquête. Pendant plus de neuf mois, nous avons recueilli la parole d’autrices, actrices, productrices, et réalisatrices. Victimes à la fois de sexisme et de racisme, ces femmes non blanches évoluant dans le domaine du cinéma disent toutes éprouver un grand sentiment de frustration dans cette période de libération de l’écoute.
Victimes à la fois de sexisme et de racisme, ces femmes non blanches DU milieu du cinéma disent toutes éprouver un grand sentiment de frustration dans cette période de libération de l’écoute.
Parler pour être entendue
Cela n’empêche pas certaines actrices racisées de dénoncer les violences qu’elles subissent, avec la volonté que cela incitera d’autres personnes à sortir de la peur et du silence. Quatre des nombreuses personnes que nous avons interviewées ont accepté que leurs témoignages, qui font état d’agressions sexuelles et de viols, soient rendus publics ; deux d’entre elles à condition que le nom de leur agresseur soit anonymisé, de peur de représailles (lire l’encadré ci-dessous).
Myriam – son prénom a été changé à sa demande – une jeune écrivaine afrodescendante nous a confié avoir été victime d’un viol par l’auteur haïtien Makenzy Orcel, finaliste du prix Goncourt 2022 pour son roman Une somme humaine (Payot & Rivages). D’après sa plainte, consultée par La Déferlante, les faits auraient eu lieu en avril 2023. L’autrice fréquentait Makenzy Orcel depuis quelques semaines, et avait déjà eu plusieurs relations sexuelles consenties avec le romancier aujourd’hui âgé de 40 ans depuis leur rencontre à Paris quelques mois plus tôt.
Elle affirme que Makenzy Orcel a mis en place un système « d’emprise », s’imposant petit à petit comme son mentor : « Il s’est servi de sa position dans le milieu de l’édition pour me mettre en confiance. Il mentionnait souvent le fait qu’on était deux auteurs noirs dans un milieu littéraire très blanc, qu’on devait se soutenir, et qu’il pouvait m’aider pour plein de choses, que ce soit les prix ou les bourses. » Un soir d’avril 2023, selon les dires de Myriam, elle et lui se retrouvent dans l’appartement d’un ami de Makenzy Orcel. « Il me fait signe de venir, je m’assois sur ses genoux, et il m’embrasse. Il veut que nous ayons une relation sexuelle mais je ne veux pas car nous ne sommes pas seuls. » L’écrivain l’emmène dans la cuisine de l’appartement, qui est plongée dans le noir. « Il insiste de nouveau pour qu’on ait une relation sexuelle, ce que je refuse encore. Il insiste encore. Cette fois, je ne pouvais plus bouger, j’étais sidérée. Il m’a enlevé mon pantalon et m’a pénétrée sans préservatif. »
Elle porte plainte pour viol quelques mois plus tard, en août 2023, dans un commissariat francilien qui a ouvert une enquête préliminaire. Mais la plainte est classée sans suite pour manque de preuve, comme 86 % des plaintes pour violences sexuelles et 94 % des plaintes pour viols (selon une étude de 2024 de l’Institut des politiques publiques). Contacté par mail, Makenzy Orcel conteste les faits qui lui sont reprochés. Il affirme avoir « couché […] quatre fois » avec l’autrice, « tous les deux [étant] consentants ».
Il déclare aussi à La Déferlante avoir déposé une main courante contre l’autrice, ainsi qu’une plainte pour diffamation : « Elle ne rate pas une occasion de me vernir, nous écrit-il. Elle a écrit à des gens avec qui j’ai travaillé pour me pourrir en dépit de la décision du procureur, c’est extrêmement grave. » Dans nos échanges, il insiste vigoureusement pour que son identité ne soit pas révélée dans la presse, arguant du fait qu’il s’agit d’une affaire classée et se juge « jeté en pâture à l’appréciation publique ».
De son côté, l’écrivaine a beaucoup hésité avant d’aller au bout de son témoignage. « Les hommes noirs sont déjà tellement criminalisés dans la société française que, parfois, on estime que les dénoncer quand ils commettent des violences, c’est donner du grain à moudre à la négrophobie », explique-t-elle. Outre cette autocensure, il y a également parfois un sentiment d’illégitimité à être reconnue comme une victime de violences qui alimente la silenciation à l’œuvre. « Pour beaucoup de gens, les femmes racisées ne sont pas des femmes, et donc, ne sont pas des victimes », estime Myriam, faisant référence à l’ouvrage de bell hooks Ne suis-je pas une femme ?, un essai critique publié en 1981 aux États-Unis sur la marginalisation des femmes noires dans les sphères féministes.
Elle a finalement décidé de témoigner publiquement afin de protéger d’autres potentielles victimes. Dans la plainte que nous avons pu consulter, la plaignante affirme s’être rapprochée d’une ex-compagne de Makenzy Orcel, elle aussi autrice, et noire, qui aurait affirmé avoir été victime de violences physiques de sa part. Contactée, cette dernière n’a pas donné suite à nos sollicitations.
Une perception biaisée des violences sexuelles
Parmi les éléments recueillis au cours de notre enquête, les stéréotypes dont souffrent de nombreuses femmes racisées ont été très souvent évoqués. Ces stéréotypes genrés et raciaux trahissent un biais dans la perception des violences sexuelles. « Dès leur enfance, les femmes noires sont perçues comme provocatrices et à l’aise avec leur sexualité, donc l’agression n’en serait pas vraiment une », analyse la psychologue Racky Ka-Sy, spécialiste des questions de racisme et de discriminations.
Des stéréotypes qui perdurent, en particulier dans les milieux artistiques. « Les femmes racisées sont moins perçues comme des êtres fragiles, moins susceptibles d’être des victimes, estime la productrice de cinéma Laurence Lascary, fondatrice du Collectif 50/50, qui promeut depuis 2018 la parité et la diversité dans le cinéma et l’audiovisuel. Dans les milieux culturels, les victimes non blanches sont moins protégées, et n’ont pas forcément le réseau qui fait que leur parole trouve un écho », qui leur permettrait de porter leur parole au plus haut. Dans les témoignages que nous avons recueillis, nos interlocutrices regrettent le manque de représentation des femmes racisées dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, notamment du fait d’un manque de réseau.
« Dès leur enfance, les femmes noires sont perçues comme provocatrices et à l’aise avec leur sexualité, donc l’agression n’en serait pas vraiment une. »
Racky Ka-Sy, psychologue spécialiste des questions de racisme et de discriminations.
Cette question de la représentation fait pourtant l’objet d’une vigilance accrue. Une polémique survenue en pleine résurgence du #MeTooCinema en témoigne. Le 7 mai 2024, l’actrice et réalisatrice Judith Godrèche, devenue figure du mouvement, révélait sur son compte Instagram l’affiche de son court-métrage Moi aussi sur laquelle figure la photo d’une foule. Toutes les personnes que l’on peut distinguer sur cette image sont blanches. Cela n’a pas échappé aux internautes : « Magnifique affiche, mais fortement déçue que les femmes de couleur ne soient pas représentées », « Zéro diversité sur cette affiche, dommage », « Pas une seule femme racisée sur cette affiche… ce n’est vraiment pas acceptable », peut-on lire en commentaires de la publication.
Même colère froide pour l’écrivaine franco-camerounaise Léonora Miano, qui, dans un texte publié sur son compte Instagram le 20 mai – le post a depuis été supprimé – dénonce elle aussi cette absence de diversité : « Où cela se passe-t-il ? En France ? Dans toute la France/la société française ? Sur la planète Terre, où chacune se souvient à la vue de cette affiche que #MeToo fut créé par une femme répondant au nom de Tarana Burke et qu’elle n’est pas blanche ? »
Pour Judith Godrèche, « celles qui ont sursauté en voyant cette affiche, avec une foule blanche, ont raison. Moi aussi, ça m’a troublée le jour du tournage, et depuis, ça me pose problème. C’est un problème. » Les personnes sur l’affiche avaient répondu présentes à l’appel à témoignage de la réalisatrice pour son court-métrage. « Cela n’aurait pas été une solution de cacher la réalité en mettant en avant sur l’affiche les rares personnes racisées. C’est une logique systémique, qui correspond malheureusement à la réalité de la société dans laquelle nous vivons, et à la place que j’y occupe. Je suis d’accord avec les femmes racisées qui ont pu critiquer cette image : on ne peut pas s’y résigner. Il faut donc essayer de changer les choses », explique-t-elle.
Selon l’autrice afroféministe Fania Noël, chercheuse à la New School for Social Research à New York, cette invisibilisation globale de la parole des femmes racisées découle notamment d’une « fabrique de l’absence » des femmes racisées dans les discours féministes : « On reconnaît que le profil des victimes est divers, pour ensuite faire des femmes blanches le visage de #MeToo, pour faire de la femme blanche une figure hégémonique. »
Une « fabrique de l’absence » dont l’actrice Nadège Beausson-Diagne estime avoir été victime. En 2019, lors de la 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Burkina Faso), elle révélait avoir été agressée lors de deux tournages, au Burkina Faso et en Centrafrique. À la suite de ces révélations, elle décide de lancer le mouvement #MemePasPeur pour que les Africaines victimes de violences sexuelles puissent mettre des « mots sur des maux ». Pendant le Festival de Cannes 2024, à l’occasion de la présentation du film Les Femmes au balcon, dans lequel elle tient un second rôle, la comédienne de 52 ans monte les marches vêtue d’un costume noir, sa poitrine griffée d’un « MeToo ». Deux ans plus tôt, le 12 mars 2022, Nadège Beausson-Diagne a porté plainte pour « agression sexuelle et circonstance aggravante avec alcool » contre la productrice de cinéma Juliette Favreul, alors membre du conseil d’administration du Collectif 50/50, pour des faits qui se seraient déroulés lors d’une soirée organisée par le collectif. Juliette Favreul a été relaxée en mai 2023 (lire l’encadré ci-dessous).
L’affaire qui a fait imploser le collectif 50/50
Le 12 mars 2022, Nadège Beausson-Diagne a porté plainte au commissariat du 19e arrondissement de Paris, pour « agression sexuelle » (l’emprise de l’alcool étant retenu comme circonstance aggravante) contre la productrice Juliette Favreul. La veille, elle était invitée par l’actrice Aïssa Maïga à une soirée du Collectif 50/50. Selon le procès-verbal de la plainte auquel La Déferlante a eu accès, Juliette Favreul lui a « caressé la cuisse en remontant sa main en direction de son sexe avant d’être arrêtée par ses collants ». Plusieurs invité·es ont vu Nadège Beausson-Diagne en état de sidération à la suite de l’agression présumée, mais aucun·e n’affirme en avoir été un·e témoin direct·e. Juliette Favreul a quant à elle toujours contesté l’agression, arguant notamment pendant le procès, devant le tribunal judiciaire de Paris en mars 2023, que Nadège Beausson-Diagne était « imposante », et donc impossible à agresser. Le ministère public avait requis contre elle huit mois de prison ainsi qu’une obligation de soins et une interdiction de contacter la plaignante. Juliette Favreul a finalement été relaxée le 23 mai 2023. Le 19 juin 2023, dans le magazine Elle, elle s’est de nouveau défendue de toute agression, affirmant n’être « ni violente ni attirée par les femmes ».
Les rapports de pouvoir d’ordre racial invisibilisés
Cette affaire a provoqué une crise majeure au sein de l’association : l’ensemble du conseil d’administration a démissionné à la fin d’avril 2022. Pour Nadège Beausson-Diagne, cette crise a été symptomatique des biais racistes toujours à l’œuvre dans le milieu du cinéma français. Une scène est particulièrement édifiante : Juliette Favreul a passé sa main dans la coiffure afro de Nadège Beausson-Diagne – acte que la productrice a reconnu. Dans le journal Le Nouvel Obs, elle a déclaré plus tard : « Je ne savais pas que c’était un geste postcolonial et offensant. J’ai toujours été complexée par mes cheveux… Je lui ai mis la main dans les cheveux… et c’est tout. » Acte considéré comme banal par Juliette Favreul, toucher les cheveux d’une personne noire sans son consentement est pourtant offensant, voire humiliant.
De son côté, Nadège Beausson-Diagne dit s’être sentie très seule tout au long de la procédure judiciaire et estime ne pas avoir bénéficié de soutiens clairs de la part des membres du collectif durant le procès. Pour elle, la notion de sororité a été « dévoyée ». « Quasiment aucune féministe blanche reconnue ne m’a soutenue publiquement ou en privé. Je ne suis jamais citée comme faisant partie de celles qui ont eu le courage de dénoncer. Sûrement parce que j’ai dénoncé la mauvaise personne », déplore-t-elle.

Amina Bouajila pour La Déferlante
Cette affaire semble avoir mis en évidence l’aveuglement du Collectif 50/50 quant aux rapports de pouvoir d’ordre racial, dans un espace qui se voulait pourtant engagé sur ces questions-là. Selon Fanny De Casimacker, déléguée générale du Collectif 50/50 depuis 2021, « même si l’association a pris très au sérieux la plainte, les membres n’étaient pas suffisamment préparé·es à réagir à un témoignage de violence en interne ». Pour la psychologue Racky Ka-Sy, « l’empathie différenciée, c’est aussi ça le racisme. Car les femmes racisées sont plus déshumanisées. Contrairement aux femmes blanches, on ne les imagine pas ressentir de la souffrance, on ne les imagine pas comme victimes, donc elles ne peuvent pas avoir mal. On minimise l’agression subie. » Après le dépôt de plainte, le Collectif 50/50 a assuré un soutien moral et financier à Nadège Beausson-Diagne. Depuis, il a renouvelé l’entièreté de son organe de direction, pour « un conseil d’administration plus divers, déclare Fanny De Casimacker, qui porte notre combat en incluant les autres critères de discrimination qui sont en jeu dans nos industries, en dehors du genre ».
En mai 2018, avec cette fois-là à ses côtés 16 actrices afrodescendantes, Nadège Beausson-Diagne foulait déjà les marches du Festival de Cannes, pour dénoncer le racisme systémique dans l’industrie du cinéma français. Toutes ont en commun d’avoir témoigné dans l’ouvrage Noire n’est pas mon métier (Seuil, 2018). Dans ce livre collectif initié et porté par l’actrice et réalisatrice Aïssa Maïga (4), plusieurs actrices racisées relatent des situations relevant à la fois du racisme et du sexisme dont elles ont été victimes. Un livre qui a mis au jour une discrimination spécifique dans le cinéma français : la misogynoir qui combine la misogynie et le racisme (lire l’encadré ci-dessous).
Misogynoir : itinéraire d’un concept
« Misogynoir » est un terme inventé par la chercheuse et militante afro-américaine Moya Bailey en 2010. Il décrit une forme particulière de discrimination qui combine la misogynie et le racisme spécifiquement dirigée contre les femmes noires. Moya Bailey montre que les oppressions ne fonctionnent pas isolément, mais se croisent et s’amplifient pour celles qui sont à l’intersection de plusieurs systèmes de domination. Elle s’illustre par exemple par des représentations déshumanisantes des femmes noires dans les médias ou les œuvres culturelles mais également dans la manière dont elles sont moins protégées ou moins prises au sérieux face aux violences, qu’elles soient verbales, physiques ou institutionnelles. En France, le concept peine à s’imposer en dehors des cercles académiques. Le mouvement #AntiHSM (pour harcèlement sexuel et misogynoir) lancé en août 2024 afin de lutter contre le cyberharcèlement misogynoir, lui a toutefois donné un fort écho sur les réseaux sociaux.
Mécaniques de la silenciation
Deux ans plus tard, le soir du 28 février 2020, cette misogynoir semblait encore intacte. Lors de la 45e cérémonie des Césars, alors qu’elle devait remettre le prix du meilleur espoir féminin, Aïssa Maïga a dénoncé sur scène le manque de représentation des personnes noires dans l’industrie, devant un public muet et gêné. Sa prise de parole a par la suite provoqué de nombreuses réactions négatives. Dénoncer le racisme dans le cinéma est déjà un chemin semé d’embûches ; dénoncer les VSS subies par les femmes racisées l’est d’autant plus.
« Pour parler de violences sexistes et sexuelles dans l’industrie, commente une actrice noire qui souhaite garder l’anonymat, il faut déjà pouvoir en faire partie. » En effet, en 2021, le Collectif 50/50 publiait l’étude « Cinégalités », qui montrait que, parmi les personnages féminins des films français sortis en 2019, seuls 19 % étaient perçus comme non blancs. En septembre 2024, Mediapart révèle que les comédien·nes racisé·es Claudia Mongumu et Ryad Baxx, en couple à l’écran dans la série Scènes de ménages, sur M6, auraient été écarté·es de l’antenne car « ne racontant pas quelque chose de suffisamment universel ». Une décision jugée comme relevant du racisme par l’actrice afrodescendante.
« Prendre la parole sur les VSS est aussi une question de pouvoir. Si [les dénonciations d’]Adèle Haenel et Judith Godrèche ont eu autant de retentissement, c’est aussi parce qu’elles sont deux actrices récompensées au plus haut sommet. Malheureusement, il n’y a pas assez de rôles pour les femmes noires pour leur permettre d’atteindre ce niveau », poursuit la productrice Laurence Lascary, qui œuvre pour une meilleure représentation des Noir·es dans le cinéma français. « Quand on ouvre trop sa gueule, on a moins de propositions », constate une comédienne afrodescendante qui préfère désormais éviter de prendre publiquement la parole sur les violences sexuelles.
Malgré cela, certaines actrices racisées ne se censurent pas, et osent dénoncer les violences qu’elles subissent. C’est le cas de la comédienne Tracy Gotoas, qui joue dans Braqueurs (2020, 2022) ou encore dans Sage-homme (2023). Elle confie à La Déferlante avoir porté plainte contre X en janvier 2021 pour agression sexuelle. Selon elle, c’est la police qui lui a conseillé de porter plainte contre X au motif qu’elle ne disposait pas de toutes les informations sur son agresseur. Pourtant, dans la plainte, l’agresseur présumé est identifié : il s’agirait de l’acteur et danseur Kévin Bago. Les faits auraient eu lieu dans la nuit du 19 au 20 octobre 2017, pendant le Festival international du film indépendant de Bordeaux (Fifib).
À l’époque, Tracy Gotoas est adhérente de l’association 1 000 visages. Créée en 2006 par la réalisatrice Houda Benyamina, l’association propose une initiation gratuite au jeu d’acteur, à l’écriture de films et de scénarios en ciblant une population venant des quartiers populaires. Tracy Gotoas présente un court-métrage, Elikia, dont elle est la réalisatrice et dans lequel Kévin Bago tient le rôle principal. Selon la plainte à laquelle La Déferlante a eu accès, l’agression se serait déroulée dans une chambre d’hôtel, où les deux artistes séjournent à l’occasion du festival.
Tracy Gotoas parle d’un « flirt » entre elle et le danseur, qui aurait eu lieu au début de l’année 2017, mais elle réfute toute envie de relation sexuelle avec lui ce soir-là : « Il y avait zéro ambiguïté. » Dans sa plainte, Tracy Gotoas déclare « avoir demandé à l’association 1 000 visages d’avoir deux lits séparés dans la chambre, puisque le festival ne pouvait pas défrayer deux chambres d’hôtel ». La réalisatrice et l’acteur finissent par dormir dans un lit double. Plus tard dans la soirée, alors que la jeune femme dormait dos au danseur, il aurait placé sa main sur son sein à plusieurs reprises. La réalisatrice dit l’avoir repoussé, mais Kévin Bago aurait par la suite baissé son pantalon et plaqué son sexe en érection contre elle.
Tracy Gotoas serait parvenue à s’extraire du lit, et l’acteur aurait terminé sa nuit ailleurs, après avoir quitté la chambre d’hôtel. Au lendemain de l’agression présumée, Tracy Gotoas s’est confiée par téléphone à des proches. Contactée par nos soins, l’une d’entre elles décrit une amie « en pleurs » lors de leur échange. L’actrice et réalisatrice dit avoir souffert d’une dépression après cette nuit.
Kévin Bago, que nous avons contacté par mail, « conteste avec la plus grande fermeté les faits évoqués », indiquant notamment que le choix de partager une chambre pendant le festival s’est fait d’un commun accord. Il évoque « une relation amicale très proche, accompagnée de relations charnelles consenties sur une période de plusieurs mois durant l’année 2016–2017 ». Il admet avoir essayé ce soir-là d’obtenir un rapport sexuel avec la réalisatrice : « Je me suis alors rapproché d’elle, conformément à notre habitude lors de nos couchers. À cet instant, Mme Gotoas m’a expressément manifesté son refus d’engager une relation charnelle. […] Toutefois et dès lors que son refus m’a été signifié, j’ai immédiatement pris la décision de me lever, en lui précisant que je ne me sentais pas à l’aise avec la situation et qu’afin d’éviter tout malentendu je préférais quitter la chambre et passer la nuit ailleurs. »
Contactée, Mathilde Le Ricque, directrice générale de 1 000 Visages en 2017, se dit « surprise » par les accusations de Tracy Gotoas. Elle déclare n’avoir « jamais eu écho ou un retour sur une agression sexuelle de [la part de Tracy Gotoas] ni d’une plainte déposée ». L’ancienne directrice précise que Kévin Bago n’était pas membre de l’association 1 000 Visages et qu’il aurait été amené dans le projet de court-métrage par Tracy Gotoas, la réalisatrice. Mathilde Le Ricque insiste également sur le fait que la participation au festival n’aurait pas été organisée par l’association, mais gérée par les réalisateur·ices. Dans un échange de mails datant de février 2023, auquel La Déferlante a pu avoir accès, la cellule d’écoute et de traitement des doléances du commissariat du 13e arrondissement de Paris confirme que l’enquête relative à la plainte de Tracy Gotoas contre X est toujours en cours.
Un imaginaire colonial
Les femmes asiatiques souffrent également d’une invisibilisation importante dans le cinéma français. Rares sont les rôles de premier plan qui leur sont accordés. Et encore plus rares sont ceux qui ne font pas appel à un imaginaire imprégné de stéréotypes coloniaux. « À mes débuts, je jouais la femme de ménage ou la prostituée. La prostituée est revenue très souvent, et c’est clairement lié à mes origines asiatiques », estime Guiying – son prénom a été changé à sa demande –, comédienne depuis plus de vingt ans. Âgée d’une quarantaine d’années, elle souhaite rester anonyme afin, dit-elle, de préserver sa famille, qui n’est « pas fan » de son choix de carrière.
« Au début des années 2000, quand je disais que j’étais actrice, les gens me demandaient tout de suite si je faisais du porno. Je me suis déjà fait appeler Katsuni (5) par des figurants hilares sur un plateau », confie-t-elle. Pour Guiying, échapper aux stéréotypes hypersexualisant les femmes asiatiques dans le cinéma français demeure très difficile. Selon elle, cette misogynie qui se mêle au racisme l’empêche d’exercer son travail dans un environnement sain.
Guiying nous confie avoir échappé à une agression sexuelle de la part d’un réalisateur de documentaires d’origine est-asiatique rencontré lors d’un festival de cinéma à Paris en 2008. Elle ne souhaite pas révéler son identité. La tentative d’agression a eu lieu après un café « au cœur de Châtelet, près de chez lui. » Elle raconte : « On s’entendait très bien. Il m’a demandé si je voulais regarder son documentaire chez lui, car il vivait à deux pas. J’ai accepté, et le piège s’est refermé. » Alors que le réalisateur lance le long-métrage, il lui aurait apporté un verre de Coca. « Je commence à boire, tout en regardant le documentaire. D’un coup je sens que mon corps est dans un total épuisement, un épuisement que je n’ai jamais ressenti de toute ma vie, encore aujourd’hui. Pendant ce temps, lui ne regardait pas son film mais m’observait, comme s’il attendait quelque chose. » Guiying soupçonne aujourd’hui le réalisateur de l’avoir droguée pour l’agresser.
Pour Guiying, échapper aux stéréotypes hypersexualisant Les femmes asiatiques dans le cinéma français demeure très difficile ; cette misogynie mêlée au racisme l’empêche d’exercer son travail dans un environnement sain.
L’actrice aurait tenté de quitter l’appartement du réalisateur, mais il l’aurait retenue. Elle parvient tout de même à partir. Tant elle était pétrie de honte, elle n’ose en parler à personne. Ce n’est que des années plus tard que Guiying se renseigne sur la soumission chimique, et comprend ce qui lui est arrivé. Cette mauvaise rencontre, Guying dit n’en avoir parlé à personne avant cette enquête. Contacté par mail, le réalisateur incriminé n’a pas souhaité répondre à nos sollicitations.
Un témoignage fait écho à celui de Guying. Comme elle, l’actrice et ancienne directrice de casting de la série Plus belle la vie, Marisa – qui ne souhaite pas donner son nom de famille – a dès le début de sa carrière eu le sentiment d’être fétichisée en raison de ses origines asiatiques. « Quand j’ai commencé à travailler pour la télé et au cinéma, on m’a souvent proposé des rôles secondaires, de prostituée, de boat people, de la serveuse dans un restaurant asiatique ; le plus souvent des rôles de femmes victimes d’agression. » La fiction s’est transformée en réalité. Marisa confie à La Déferlante avoir été agressée sexuellement et pense avoir été victime de soumission chimique (6) dans un cadre professionnel. En 2007, elle croise la route d’un cinéaste multiprimé dans les festivals internationaux, dont elle ne souhaite pas révéler l’identité. Il lui propose le rôle principal de son prochain film, qu’elle obtient quelques semaines plus tard. Le scénario de ce long-métrage est une histoire d’amour basée sur la vie du réalisateur, celle entre un homme exilé et une femme d’origine asiatique.
« Sororité retrouvée »
Lors de la préparation du tournage, il l’invite à dîner pour la présenter à d’autres membres de l’équipe. « Quand j’arrive, je suis toute seule. Il s’excuse, affirme que les autres n’ont finalement pas pu venir. Je suis très mal à l’aise, mais malgré tout, je ne sais pas pourquoi, je me sens obligée de rester, donc je reste. Il me sert des shots de vodka, que je bois pour me donner une contenance. À un moment, j’ai la tête qui tourne, je me lève, me dirige vers la porte d’entrée, dis que je veux partir, et je vois une main qui claque la porte. Je me sens basculée à plat ventre sur un matelas et puis plus rien. Black-out. » La suite de la soirée, l’actrice n’en a que des flashs. Elle dit avoir reçu quelques jours plus tard, des textos du réalisateur évoquant « une soirée magnifique ».
Des semaines après cette soirée, elle se rend à Berlin pour le tournage. Elle est récupérée à l’aéroport par les assistants du réalisateur, qui l’amènent dans l’appartement dans lequel elle sera logée. Marisa affirme avoir été de nouveau violée, par ce même réalisateur, cette fois-ci sans soumission chimique. Contacté, il n’a pas donné suite à nos sollicitations.
Une actrice souhaitant garder l’anonymat, présente lors de ce tournage, décrit ce réalisateur comme un « harceleur envers les femmes ». Elle se souvient avoir vu Marisa « triste et à la merci du réalisateur, contrainte de loger avec lui ». Marisa finit par quitter le tournage. Le film ne sortira finalement pas en salle. De retour en France, elle renonce petit à petit à son rêve d’actrice, tout en gardant un pied dans l’industrie et devient directrice de casting. « J’ai mis du temps à mettre le mot viol sur ce qui s’était passé, concède Marisa, et surtout je m’en suis énormément voulu. J’ai pensé que c’était ma faute, que c’était moi qui avais déclenché ça. » Marisa est réticente à porter plainte face à l’incapacité du système judiciaire français à croire les victimes. « C’est difficile de se reconstruire, alors pourquoi prendre le risque de tout foutre l’air à nouveau ? » s’interroge-t-elle. Mais les prises de parole des actrices Adèle Haenel et Judith Godrèche lui ont fait beaucoup de bien, lui donnant le sentiment d’une « sororité retrouvée ».
Ce qui ressort pourtant de la plupart des témoignages récoltés, c’est le sentiment de solitude ressentie par ces actrices racisées, pour la plupart isolées. Pour l’autrice afroféministe Fania Noël, ces violences sexistes et sexuelles les contraignent à se mettre en retrait, comme Marisa l’a fait : « Certaines subissent des VSS au commencement de leur carrière, ou avant même leurs débuts. On leur vole quelque chose. Elles vont donc abandonner avant même que la carrière commence. Ce qui crée une épuration qui, du côté du dominant, justifie l’absence d’inclusivité. »
Une meilleure représentation des personnes non blanches
L’Association des acteurices (ADA) est apparue comme un espace où les actrices, racisées comme blanches, pouvaient espérer parler plus librement des discriminations vécues dans le cinéma. Le collectif, créé en 2022 par les comédiennes Suzy Bemba, Zita Hanrot, Ariane Labed et Daphné Patakia, s’est positionné contre la mise en concurrence des actrices et pour une meilleure représentation des personnes perçues comme non blanches au cinéma.
Au sein du Collectif 50/50 également, de nombreuses pratiques ont été mises en place pour prendre en compte les biais racistes : « On a tiré des leçons du passé, affirme la déléguée générale Fanny De Casimacker. La gouvernance a été repensée en profondeur. On fait désormais des formations internes de prévention des violences, mais aussi des formations sur la communication empathique, car on sait que, au sein d’un collectif militant, les violences se jouent aussi beaucoup dans la manière dont on peut s’exprimer les unes avec les autres. »
La commission d’enquête parlementaire sur les violences sexistes et sexuelles réclamée par Judith Godrèche peut aussi être une piste de réflexion pour lutter contre ces violences. La comédienne n’a aucune mainmise sur l’élaboration de cette commission. Elle estime que les discussions autour des VSS subies par les artistes racisées ne fait que commencer, et espère que leur invisibilisation dans les différents mouvements #MeToo pourra être combattue : « Comment ? J’essaie d’y réfléchir. […] Mais déjà, en parler, le dire, publiquement. Considérer que c’est un problème. Ne plus trouver ça normal – car ce n’est pas normal. » Une démarche que nous avons tenté d’effectuer avec cette enquête. Si l’ensemble de nos témoins souhaitent que leur parole de femmes racisées ne soit plus invisibilisée, il reste encore difficile pour elles d’oser dénoncer des violences sexistes et sexuelles subies. Dans les milieux culturels français, où l’omerta quant aux violences sexuelles, mais également quant au racisme, est excessivement présente, évoquer le croisement de ces deux violences est périlleux pour celles qui les vivent. •
(1) Accusé de violences sexuelles par de nombreuses femmes, Gérard Depardieu a été renvoyé le 14 août 2024 par le parquet de Paris devant la cour criminelle pour viols et agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnould.
(2) Le 2 mai 2024, l’Assemblée nationale a approuvé à l’unanimité la création d’une commission d’enquête chargée d’étudier les « abus et violences » dont sont victimes les mineur·es et les majeur·es dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité. Suspendue après la dissolution, cette commission a été relancée en octobre 2024.
(3) C’est Tarana Burke, travailleuse sociale afro-américaine, qui a lancé le mouvement #MeToo en 2007, devenu viral dix ans plus tard. En 2006, elle a créé l’association Just Be Inc qui vient en aide aux femmes et filles noires issues des quartiers populaires victimes de violences sexuelles.
(4) Dans le cadre de cette enquête, Aïssa Maïga n’a pas donné suite à nos sollicitations.
(5) Star franco-vietnamienne de l’industrie du porno dans les années 2000–2010.
(6) La soumission chimique est définie comme l’administration aux victimes, à leur insu ou sous la menace, d’une ou de plusieurs substances psychoactives à des fins criminelles ou délictuelles. Les substances utilisées sont majoritairement des médicaments (somnifères, sédatifs, anxiolytiques, etc.).
Une enquête difficile mais nécessaire
Cet article sur les violences sexistes et sexuelles subies par les personnes racisées dans les milieux culturels a été particulièrement difficile à mener. Durant ces neuf mois d’enquête, les personnes que nous avons interrogées ont toutes évoqué leur peur de prendre la parole – peur des représailles et des procédures-bâillons que peuvent être les procès pour diffamation.
Les témoignages publiés décrivent des violences, des processus d’emprise ou des modes opératoires qui feront certainement écho au vécu d’autres femmes, quels que soient leurs milieux. Bien que plusieurs d’entre eux soient anonymisés – dans le respect du choix des victimes –, que certains n’aient pas fait l’objet d’une plainte ou que la plainte ait été classée sans suite, nous assumons pleinement de les publier. Ils ont été recueillis dans le respect rigoureux de la déontologie journalistique. Nous avons sollicité le point de vue de chaque personne mise en cause, comme l’exige le principe essentiel du contradictoire. Fidèle à son engagement, La Déferlante espère en publiant cette enquête contribuer à la lutte contre les violences patriarcales. Ce combat relève de l’intérêt général.