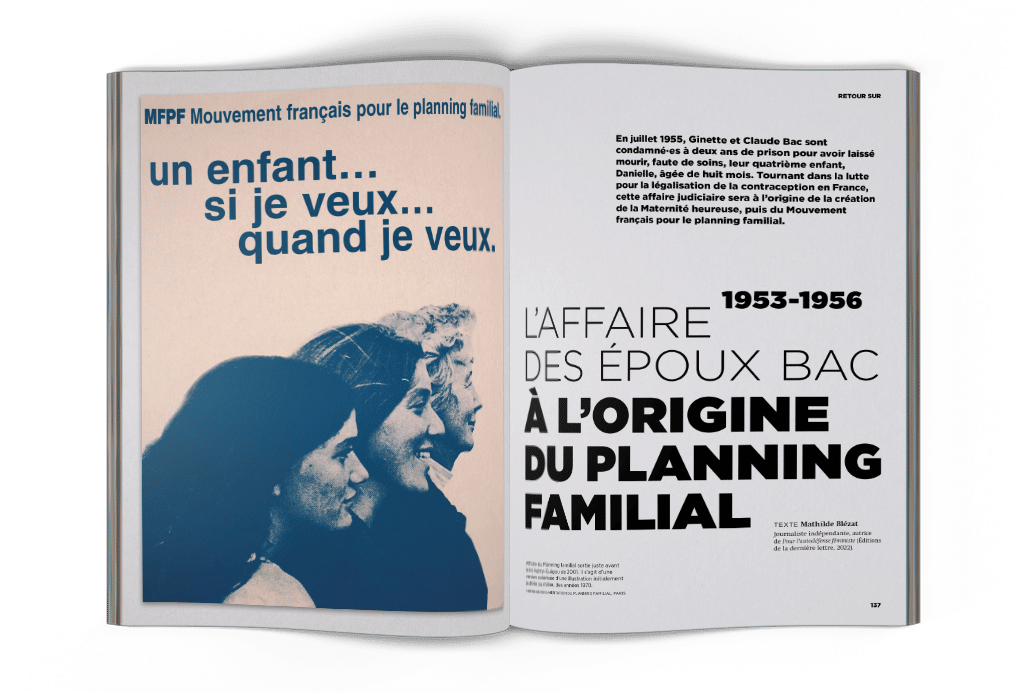C’est ce qu’a constaté la Dares¹, qui s’est penchée en mai dernier sur ces travailleur·euses « de la deuxième ligne », comme les appelle le gouvernement. Leur salaire est inférieur de 30 % à celui des autres salarié·es du privé, leurs contrats sont deux fois plus souvent courts, avec de faibles durées de travail hebdomadaire et un risque supérieur de chômage et d’accidents du travail. Sur ces postes, les femmes sont les plus nombreuses et occupent les métiers où les salaires sont les plus faibles. Elles sont caissières, aides à domicile, agentes d’entretien. Les hommes – souvent racisés et issus de l’immigration – sont ouvriers du bâtiment et de la manutention, conducteurs de véhicule ou agents de sécurité.
Beaucoup de femmes ont ainsi continué à travailler sur site pendant toute la durée de l’épidémie ; par ailleurs, ce sont principalement les femmes qui ont subi de plein fouet la crise économique qui s’en est suivie, parce qu’elles composent le gros des troupes des travailleur·euses précaires.
Carrières interrompues par les congés maternité
Présentes dans les secteurs les moins bien rémunérés, parce qu’il s’agit d’activités dites féminines ou féminisées, elles représentent deux cinquièmes des salarié·es mais deux tiers des salarié·es payé·es au Smic. Elles sont également surreprésentées parmi les contrats courts (80 % des signataires de CDD récurrents sont des femmes, les hommes étant surtout concernés par l’intérim) et dans l’emploi à temps partiel (consultez notre glossaire de concepts) (près d’une femme sur trois, contre moins d’un homme sur dix). Exclues des emplois à durée indéterminée et à temps plein, elles ont longtemps subi un niveau de chômage plus élevé que les hommes. Aujourd’hui, si cet écart s’est réduit dans la catégorie A de Pôle emploi (personnes sans aucun emploi), elles demeurent plus nombreuses en catégories B et C (cumul de chômage et d’activité réduite).
C’est à ces tendances structurelles que vient s’ajouter l’effet négatif des carrières interrompues par les congés maternité, freinées par les différences à l’embauche, à la rémunération et à la promotion. On ne saurait, dès lors, résumer l’inégalité de genre sur le marché du travail à une somme de discriminations interpersonnelles qu’il conviendrait d’enrayer à coups de chartes et de formations à l’égalité.
Cette inégalité apparaît, au contraire, constitutive de la structure même du marché du travail, segmenté entre un marché primaire constitué de CDI et de temps pleins, occupés principalement par des hommes blancs, qualifiés, correctement rémunérés et pouvant prétendre à des évolutions professionnelles ; et un marché secondaire d’emplois « atypiques », à temps partiel et de courte durée, peu rémunérés, aux conditions difficiles et principalement occupés par des populations minorisées, qu’il s’agisse de femmes ou de personnes racisées.
Les dispositifs de protection sociale ignorent – ou ne la compensent qu’au minimum – cette segmentation du marché du travail, et en particulier sa dimension genrée. Ainsi, une carrière complète et à temps plein est nécessaire pour bénéficier d’un niveau de pension décent – ce que ne parviennent à corriger ni les majorations liées à la venue d’un enfant ni les pensions de réversion dues aux veuves, les hommes à la retraite percevant en moyenne le double de ce que perçoivent les femmes. De même, le montant des allocations chômage, paramétrées pour des CDI à temps plein, est d’un tiers plus élevé pour les hommes – écart que la réforme du chômage qui doit entrer en vigueur cette année ne fera que creuser. Enfin, le montant du Smic, avec lequel un·e salarié·e à temps plein peut vivre 200 euros au-dessus du seuil de pauvreté, ne permet en revanche pas à un·e salarié·e à temps partiel et sans sécurité de l’emploi de subsister, encore moins si la personne a la charge d’une famille monoparentale.
La dépendance économique permet les emplois précaire
La dimension genrée de la segmentation du marché du travail n’a rien d’un hasard. Elle épouse parfaitement la structuration de la société, révélant une imbrication étroite entre économie domestique et économie de marché, laquelle justifie l’existence d’emplois qui n’ont pas pour objectif d’offrir à celles qui les occupent la possibilité de gagner leur vie, mais seulement de mettre à profit leurs savoir-faire féminins afin d’éventuellement compléter le revenu d’un conjoint. Pour les femmes les plus pauvres, souvent issues de l’immigration, il n’est d’ailleurs souvent que la continuation marchande du travail domestique (consultez notre glossaire de concepts), qu’on fait alors pour le mari ou la famille d’autrui. Ce n’est pas seulement que le travail précaire empêche l’indépendance économique des femmes : leur dépendance économique et politique est ce qui permet à ces emplois précaires typiquement féminins d’exister.
Cette analyse peut être étendue à certains hommes dans des secteurs dits « atypiques ». Le travail sans statut, ni protection sociale, ni salaire minimum, au service des plateformes de VTC ou de livraison, existerait-il s’il n’y avait pas de main-d’œuvre d’hommes racisés, migrants ou fils d’immigrés, sans titre de séjour ou perspectives professionnelles ? Il est probable que non. Et eux non plus n’ont pas cessé de rouler pendant l’épidémie de Covid.
*****
¹ Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère du Travail.