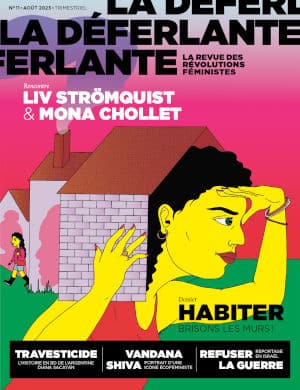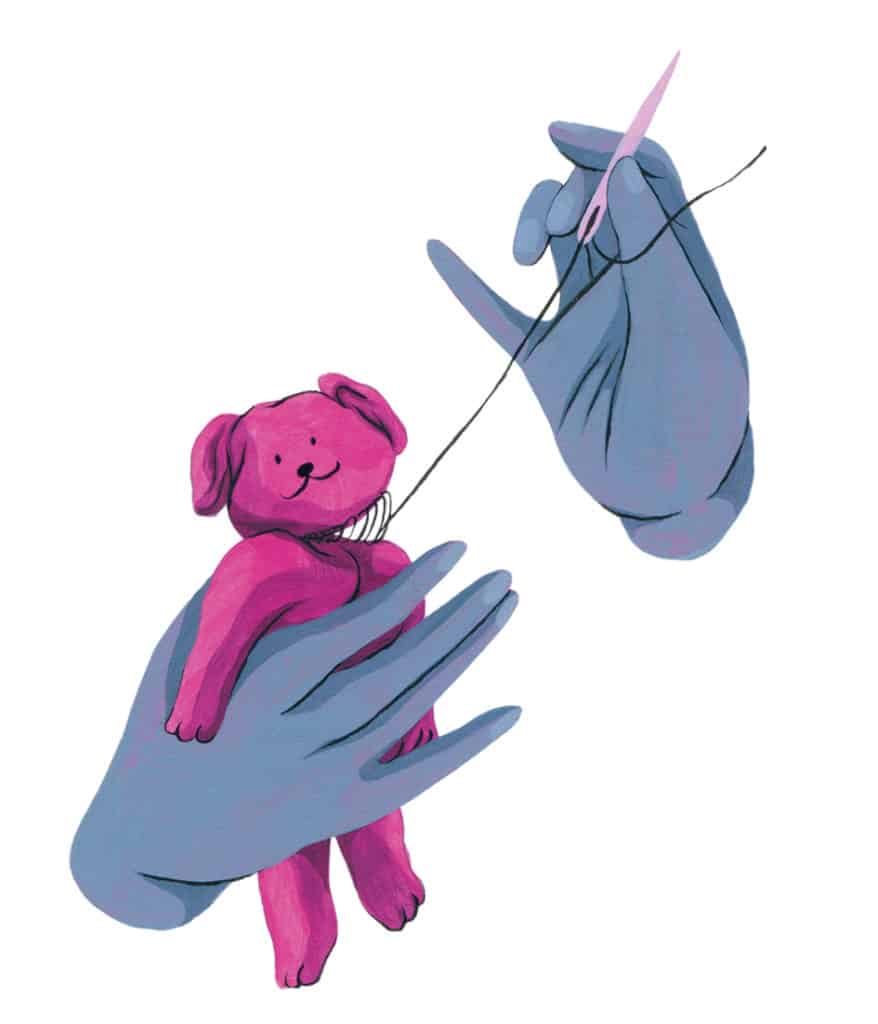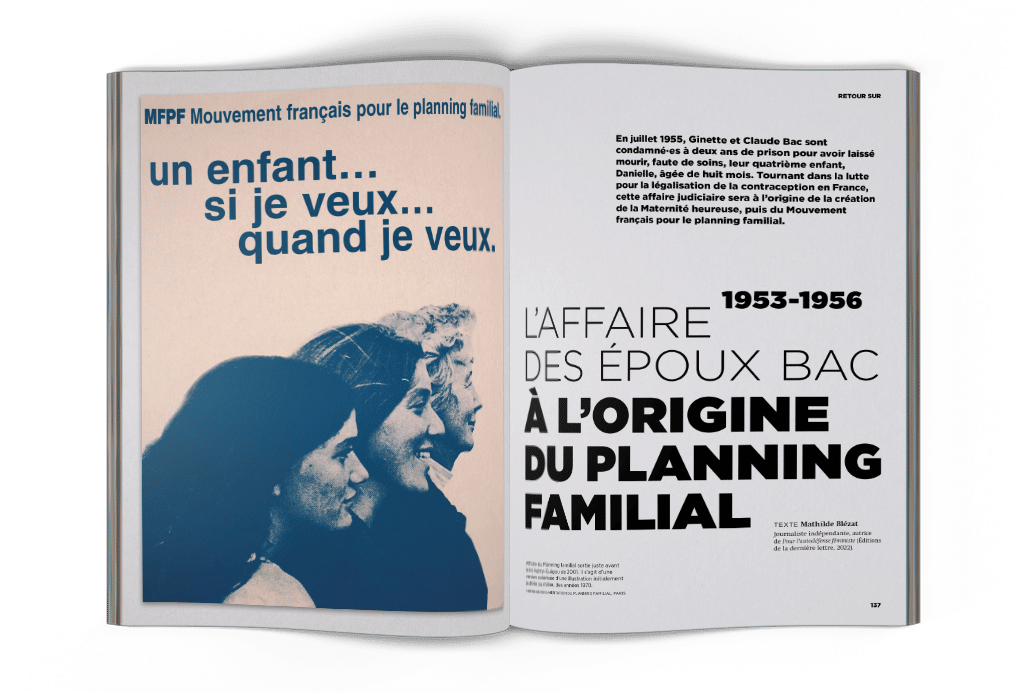En novembre 2021, quelques semaines après la promulgation de la loi autorisant la PMA pour les couples de femmes, Coralie et Pauline* s’inscrivaient auprès du Centre de conservation des œufs et du sperme humain (Cecos) de l’hôpital Tenon à Paris. « 23 mois plus tard, 12 rendez-vous en présentiel à deux, et des heures passées au téléphone et par mail à stresser », Coralie est aujourd’hui enceinte de six mois.
Comme elles, Hanane Ameqrane, la quarantaine, fait partie de cette nouvelle génération de femmes à avoir accès à la PMA en France, à la suite du vote de la loi du 2 août 2021 ouvrant aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires cisgenres la possibilité de concevoir des enfants par PMA. De plus, depuis un décret promulgué en août dernier, les femmes trans ayant conservé leur sperme peuvent l’utiliser en vue d’une PMA – mais les hommes trans restent exclus du dispositif. Documentaliste, militante antiraciste et féministe en Seine-Saint-Denis, Hanane « s’accroche à ce droit » pour concevoir et porter son deuxième enfant en France. Déjà mère d’une petite fille de 4 ans, portée par sa compagne après un parcours en Belgique, elle se prépare encore une fois à une attente interminable : « On s’est embarquées dans un parcours médicalisé et scientifique, où la douceur, l’intime et l’amour disparaissent. »
« Un an et demi d’attente »
Selon l’Agence de la biomédecine, l’attente entre la prise du premier rendez-vous et l’attribution de paillettes de sperme est, en moyenne, de 14 mois dans les Cecos français, contre 6 mois avant la loi. Au bout du fil, Coralie nous fait patienter. On l’entend fouiller dans son épais dossier médical. « On nous avait annoncé un an et demi d’attente ». Elles ont finalement attendu treize mois avant que l’hôpital ne leur confirme la disponibilité de gamètes : « C’était très stressant parce que si on loupait un rendez-vous en présentiel ou qu’on n’envoyait pas l’original de tel ou tel papier, on ajoutait trois mois d’attente supplémentaires. »
Mécaniquement, l’ouverture des 33 Cecos français aux lesbiennes et aux femmes célibataires a fait exploser les demandes : elles ont bondi de 2 000 en 2019 (de couples hétérosexuels exclusivement) à 15 000 en 2021. Or, cet afflux est loin d’avoir été anticipé : la loi de 2021 n’a été accompagnée d’aucune campagne de sensibilisation au don de gamètes, et ces dons restent bénévoles. « La France a l’ambition de prendre en charge toutes les patientes uniquement grâce à des donneurs altruistes, contrairement à ses voisins européens », déplore Catherine Guillemain, présidente de la Fédération française des Cecos. Elle-même constate, au sein de sa consultation, l’explosion des demandes : « Je pourrais accueillir des patientes nuit et jour. »
Nouvelle loi, nouvelles inégalités
L’attente est plus longue encore pour les personnes non blanches, car beaucoup de Cecos pratiquent, par défaut, l’appariement entre les mères et les donneurs. En d’autres termes, ils recherchent systématiquement des gamètes en provenance d’hommes dont les caractéristiques physiques et ethniques correspondent à celles des receveuses. Par chance, le centre où Hanane est inscrite a identifié un donneur originaire d’Asie du Sud-Est, concordant avec les critères physiques de sa compagne, d’origine hmong. Mais « j’ai des copines à qui on a dit qu’il y avait un manque de donneurs racisés, alors elles sont de fait exclues de la PMA ! » Selon l’Agence de la biomédecine, le temps d’attente pour ces personnes passerait de trois à dix ans pour un don d’ovocytes, contre deux ans en moyenne pour les personnes blanches. La docteure Catherine Guillemain confirme prudemment : « Ça peut être plus difficile pour certaines ethnies. »
LA LEVÉE DE L’ANONYMAT DU DONNEUR PRÉVUE PAR LA LOI DE 2021 N’EST PAS APPLICABLE
À ces délais d’attente, il faut ajouter les humiliations régulières liées au caractère jusqu’ici très hétéronormé du parcours de PMA à la française : outre qu’elle a régulièrement dû rayer la mention « Monsieur » sur les formulaires, Pauline raconte avec humour la fois où on lui a demandé de « venir pour un prélèvement de sperme en tant que conjoint ». À l’hôpital Tenon, la gynécologue « m’a prévenue qu’il y aurait beaucoup d’échographies pelviennes et que ça pouvait rompre mon hymen, raconte Coralie. Comme si, en tant que lesbiennes, nous n’avions aucune vie sexuelle ! »
Un système à deux vitesses
Autre problème de taille engendré par le manque d’anticipation des pouvoirs publics, la levée de l’anonymat des donneurs, prévue par la loi d’août 2021, n’est actuellement pas applicable. En raison de la pénurie de sperme, les Cecos ont toujours recours aux banques de donneurs ayant été prélevés sans avoir donné leur accord pour que leur identité soit communiquée à la majorité de l’enfant. « Au moment où notre tour est venu, ils n’avaient toujours pas de nouvelle banque de sperme, regrette Pauline. Soit on attendait sans savoir combien de temps cela pouvait prendre, soit on faisait avec un donneur anonyme. »
La loi de 2021 oblige également les couples de femmes à établir chez un·e notaire une reconnaissance de maternité conjointe anticipée. Une règle qui ne concerne pas les couples hétérosexuels ayant recours à la PMA. Et, pour Hanane, « une absurdité à 400 euros minimum, qui ajoute charge mentale et frais à une démarche censée être gratuite ». Coralie et Pauline, qui ont dû se tourner vers une notaire avant même que le processus de procréation ait commencé, se sont également vu demander « un papier qui justifie que le donneur n’a aucun droit sur l’enfant et que l’on consent au don de gamètes. » Or, « plus on fait de papiers, plus on paye », tranche Pauline.
« La parentalité queer est une aventure en soi, faite de découvertes et de bricolages », résume Hanane. Une formule pudique qui dit bien les embûches poussant, aujourd’hui encore, les personnes queers qui en ont les moyens à tenter la PMA à l’étranger. Tandis que le système français continue de s’engorger.
* À la demande des interviewées, seuls leurs prénoms sont mentionnés.
→ Retrouvez la revue de presse ainsi que les coups de cœur de la rédaction juste ici.