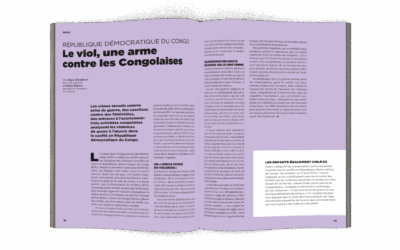Selon la militante féministe et essayiste Valérie Rey-Robert, la culture du viol est un système de représentations qui « s’appuie et se nourrit […] d’un certain nombre d’idées reçues autour des violences sexuelles et provoque systématiquement des phénomènes similaires observables : fatalisation du viol, excuse des coupables et culpabilisation des victimes » (Une culture du viol à la française, Libertalia, 2020 [1ère éd. 2019]). Ainsi, dans notre imaginaire collectif, un agresseur sexuel ou un violeur est un homme marginal, armé, mal éduqué et rôdant la nuit dans les parkings. Une représentation très éloignée de la réalité, puisque les chiffres montrent que, dans 9 cas sur 10, le violeur est une connaissance de la victime.
La culture du viol s’observe particulièrement à travers le traitement journalistique des violences faites aux femmes. Comme le rappelle l’autrice et journaliste Rose Lamy dans un article qu’elle consacre à l’affaire « DSK » qui est un cas d’école. Certaines expressions pour désigner le crime imputé à Dominique Strauss Kahn, en 2011 – « troussage de domestique », « il n’y a pas mort d’homme », « aimer les femmes sans modération » – étaient symptomatiques de cette culture du viol à la française. L’affaire va provoquer une prise de conscience : le concept devient un sujet de débat en France. À partir de 2016, « des initiatives militantes “sémantiques” émergent sur les réseaux sociaux, explique Rose Lamy, pour dénoncer la culture du viol qui s’exprime dans le traitement journalistique des féminicides ou des violences sexuelles. Le terme « féminicide » va alors peu à peu remplacer celui de « crime passionnel », dans la presse et dans nos représentations.
Pour aller plus loin
Valérie Rey-Robert, Une culture du viol à la française, Libertalia, 2020. (en accès libre)