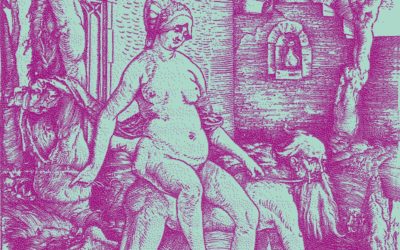Forgé par l’essayiste et militante féministe Françoise d’Eaubonne, ce mot apparaît pour la première fois en 1974 dans son livre Le Féminisme ou la mort. Rapidement oublié en France, le terme ressurgit outre-Atlantique dans les années 1980 pour désigner une multitude de mouvements portés par des femmes à travers le monde, en particulier dans les aires géographiques et pays dits du Sud (Inde, Afrique, Amérique du Sud…), autour de luttes écologistes : marches antimilitaristes ou antinucléaires, mobilisations contre la pollution, la déforestation ou l’extractivisme (c’est-à-dire l’exploitation massive et irraisonnée des ressources terrestres), luttes pour la justice environnementale, etc. Très visibles dans les manifestations pour le climat, notamment en 2015 lors des manifestations autour de la COP 21 de Paris, les collectifs écoféministes se sont multipliés en Europe. En France, le terme est aujourd’hui revendiqué par divers courants. On observe par ailleurs, depuis plusieurs années, une approche écoféministe de l’urgence climatique qui tend à introduire le genre comme grille de lecture de la catastrophe environnementale.
Ces mouvements ne relèvent pas tous d’une même doctrine, une constante est cependant à noter : il y a entre les luttes des femmes et les mobilisations écologiques une « connexion étroite qui renvoie à la commune domination des femmes et de la nature. Que les femmes et la nature soient l’objet d’une domination croisée, telle est la découverte propre de l’écoféminisme. Et les écoféministes, académiques aussi bien que militantes, se sont employées à dégager et expliciter la logique de cette domination », souligne la philosophe Catherine Larrère dans un article consacré à l’États-unienne Carolyn Merchant, pionnière de la philosophie écoféministe.
L’écoféminisme fait aussi l’objet de critiques : certaines féministes s’inquiètent du risque d’essentialisme que comporte le fait d’associer les femmes à une prétendue « nature » mythifiée ; des écologistes affirment de leur côté que l’écologie doit être l’affaire de tous·tes. Il est par ailleurs instrumentalisé par certains mouvements réactionnaires pour justifier des discours racistes ou transphobes, comme le montre la journaliste Christelle Gilabert dans un article intitulé « Écologie : les idéologies réactionnaires en embuscade ». Le collectif écologiste Floraisons, par exemple, articule sa dénonciation de « la civilisation industrielle patriarcale » au rejet des transitions de genre ou de la PMA, innovations médicales qualifiées de « contre-nature ». Pour Cannelle Fourdrinier, militante écoféministe, queer et décoloniale, le manque de déconstruction des mouvements écologistes « mainstream » qui « néglige[nt] les conditions matérielles des humain·es » et se concentrent trop sur l’environnement, ouvre la voie à des écoféminismes réactionnaires.
Pour aller plus loin
Catherine Larrère, L’Écoféminisme, La Découverte, 2023.
Françoise d’Eaubonne, Le Féminisme ou la mort, Le Passager Clandestin, 2020 [1974]