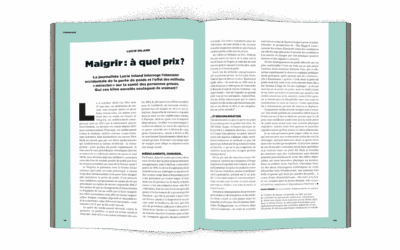La grossophobie désigne l’ensemble des phénomènes de marginalisation sociale des personnes perçues comme grosses. Elle se manifeste de manière explicite, par des insultes et des remarques, mais aussi par un ensemble de discriminations qui font système : difficultés d’accès à l’emploi, aux soins médicaux, ou encore à des infrastructures adaptées (les sièges trop étroits dans les transports, par exemple). Elle s’exprime aussi par le fait d’imputer au seul poids le décès des personnes grosses, alors que d’autres facteurs de comorbidités peuvent entrer en compte, comme cela s’est vu pendant la pandémie de Covid-19.
Dans une chronique intitulée « Pourquoi les grosses ne portent pas de vêtements éthiques », la journaliste Lucie Inland explique comment l’injonction à boycotter l’industrie de la fast-fashion pour se tourner vers la mode éthique peut s’analyser comme une forme de grossophobie. Cette injonction n’est en effet pas tenable pour les personnes grosses. Les vêtements adaptés à leur morphologie, c’est-à-dire « accessible[s], inclusi[fs], pas [chers], jusqu’à la taille 68 », ne sont souvent disponibles que dans des enseignes de la fast-fashion comme Shein. En France, les tailles de vêtements les plus communes sont le 40 et 42, mais cela ne représente que 37 % de la population féminine, et, au-dessus du 42, avoir accès à des vêtements est bien plus compliqué : « À Rennes, par exemple, la seule enseigne où je peux acheter des pantalons convenables est à l’extérieur de la ville, ce qui m’impose une heure de transports en commun juste pour m’y rendre », explique Lucie Inland.
Pour aller plus loin :
Daria Marx, Dix questions sur la grossophobie, Libertalia, 2024.
Gabrielle Deydier, On ne naît pas grosse, Goutte d’or, 2017.
Solenne Carof, Grossophobie. Sociologie d’une discrimination invisible, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2021.