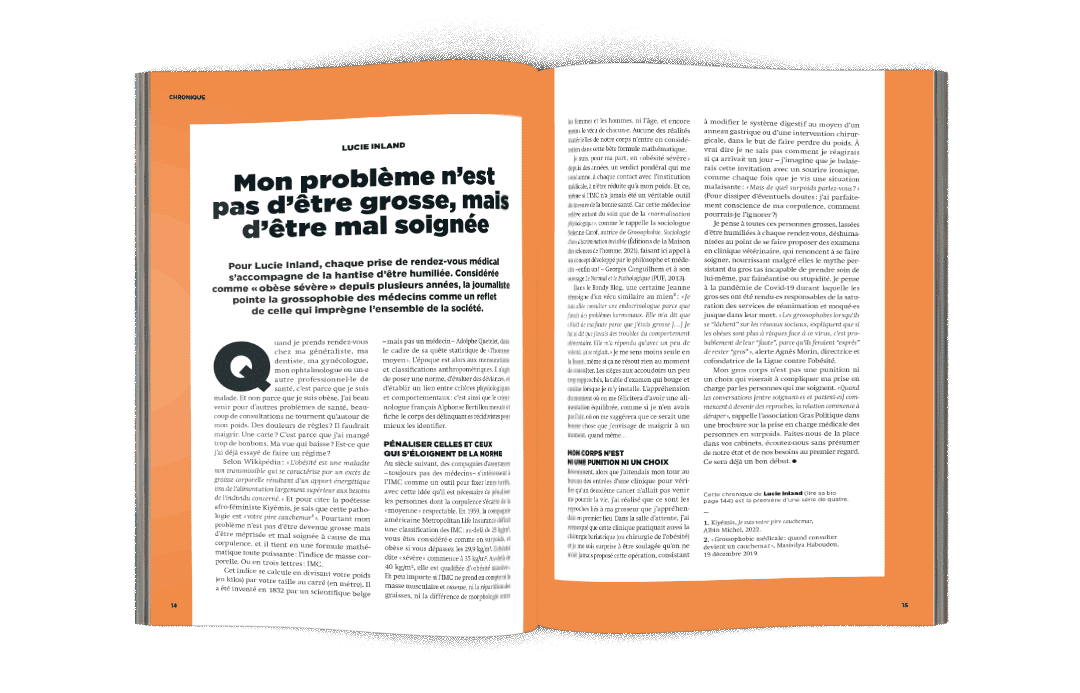Quand je prends rendez-vous chez ma généraliste, ma dentiste, ma gynécologue, mon ophtalmologue ou un·e autre professionnel·le de santé, c’est parce que je suis malade.
Selon Wikipédia : « L’obésité est une maladie non transmissible qui se caractérise par un excès de graisse corporelle résultant d’un apport énergétique issu de l’alimentation largement supérieur aux besoins de l’individu concerné. » Et pour citer la poétesse afro-féministe Kiyémis, je sais que cette pathologie est « votre pire cauchemar ». Pourtant mon problème n’est pas d’être devenue grosse mais d’être méprisée et mal soignée à cause de ma corpulence, et il tient en une formule mathématique toute puissante : l’indice de masse corporelle. Ou en trois lettres : IMC.
Cet indice se calcule en divisant votre poids (en kilos) par votre taille au carré (en mètre). Il a été inventé en 1832 par un scientifique belge – mais pas un médecin – Adolphe Quetelet, dans le cadre de sa quête statistique de « l’homme moyen ». L’époque est alors aux mensurations et classifications anthropométriques. Il s’agit de poser une norme, d’évaluer des déviances, et d’établir un lien entre critères physiologiques et comportementaux : c’est ainsi que le criminologue français Alphonse Bertillon mesure et fiche le corps des délinquant·es récidivistes pour mieux les identifier.
Pénaliser celles et ceux qui s’éloignent de la norme
Au siècle suivant, des compagnies d’assurances – toujours pas des médecins – s’intéressent à l’IMC comme un outil pour fixer leurs tarifs, avec cette idée qu’il est nécessaire de pénaliser les personnes dont la corpulence s’écarte de la « moyenne » respectable. En 1959, la compagnie américaine Metropolitan Life Insurance définit une classification des IMC : au-delà de 25 kg/m², vous êtes considéré·e comme en surpoids, et obèse si vous dépassez les 29,9 kg/m². L’obésité dite « sévère » commence à 35 kg/m². Au-delà de 40 kg/m², elle est qualifiée d’« obésité massive ». Et peu importe si l’IMC ne prend en compte ni la masse musculaire et osseuse, ni la répartition des graisses, ni la différence de morphologie entre les femmes et les hommes, ni l’âge, et encore moins le vécu de chacun·e. Aucune des réalités matérielles de notre corps n’entre en considération dans cette bête formule mathématique.
Je suis, pour ma part, en « obésité sévère » depuis des années, un verdict pondéral qui me condamne, à chaque contact avec l’institution médicale, à n’être réduite qu’à mon poids. Et ce, même si l’IMC n’a jamais été un véritable outil de mesure de la bonne santé. Car cette médecine relève autant du soin que de la « normalisation physiologique », comme le rappelle la sociologue Solenne Carof, autrice de Grossophobie. Sociologie d’une discrimination invisible, faisant ici appel à un concept développé par le philosophe et médecin – enfin un ! – Georges Canguilhem et à son ouvrage Le Normal et le Pathologique.
Dans le Bondy Blog, une certaine Jeanne témoigne d’un vécu similaire au mien : « Je suis allée consulter une endocrinologue parce que j’avais des problèmes hormonaux. Elle m’a dit que c’était de ma faute parce que j’étais grosse […] Je lui ai dit que j’avais des troubles du comportement alimentaire. Elle m’a répondu qu’avec un peu de volonté, ça se réglait. » Je me sens moins seule en la lisant, même si ça ne résout rien au moment de consulter. Les sièges aux accoudoirs un peu trop rapprochés, la table d’examen qui bouge et couine lorsque je m’y installe. L’appréhension du moment où on me félicitera d’avoir une alimentation équilibrée, comme si je n’en avais pas l’air, où on me suggérera que ce serait une bonne chose que j’envisage de maigrir à un moment, quand même…
Mon corps n’est ni une punition ni un choix
Récemment, alors que j’attendais mon tour au bureau des entrées d’une clinique pour vérifier qu’un deuxième cancer n’allait pas venir me pourrir la vie, j’ai réalisé que ce sont les reproches liés à ma grosseur que j’appréhendais en premier lieu. Dans la salle d’attente, j’ai remarqué que cette clinique pratiquait aussi la chirurgie bariatrique (ou chirurgie de l’obésité) et je me suis surprise à être soulagée qu’on ne m’ait jamais proposé cette opération, consistant à modifier le système digestif au moyen d’un anneau gastrique ou d’une intervention chirurgicale, dans le but de faire perdre du poids. À vrai dire je ne sais pas comment je réagirais si ça arrivait un jour – j’imagine que je balaierais cette invitation avec un sourire ironique, comme chaque fois que je vis une situation malaisante : « Mais de quel surpoids parlez-vous ? » (Pour dissiper d’éventuels doutes : j’ai parfaitement conscience de ma corpulence, comment pourrais-je l’ignorer ?)
Lire aussi : L’invention du « summer body » : un siècle d’injonctions sexistes à la plage
Je pense à toutes ces personnes grosses, lassées d’être humiliées à chaque rendez-vous, déshumanisées au point de se faire proposer des examens en clinique vétérinaire, qui renoncent à se faire soigner, nourrissant malgré elles le mythe persistant du gros tas incapable de prendre soin de lui-même, par fainéantise ou stupidité. Je pense à la pandémie de Covid-19 durant laquelle les gros·ses ont été rendu·es responsables de la saturation des services de réanimation et moqué·es jusque dans leur mort. « Les grossophobes lorsqu’ils se “lâchent” sur les réseaux sociaux, expliquent que si les obèses sont plus à risques face à ce virus, c’est probablement de leur “faute”, parce qu’ils feraient “exprès” de rester “gros” », alerte Agnès Morin, directrice et cofondatrice de la Ligue contre l’obésité.
Mon gros corps n’est pas une punition ni un choix qui viserait à compliquer ma prise en charge par les personnes qui me soignent. « Quand les conversations [entre soignant·es et patient·es] commencent à devenir des reproches, la relation commence à déraper », rappelle l’association Gras Politique dans une brochure sur la prise en charge médicale des personnes en surpoids. Faites-nous de la place dans vos cabinets, écoutez-nous sans présumer de notre état et de nos besoins au premier regard. Ce sera déjà un bon début. •
Cette chronique de Lucie Inland (lire sa bio page 144) est la première d’une série de quatre.