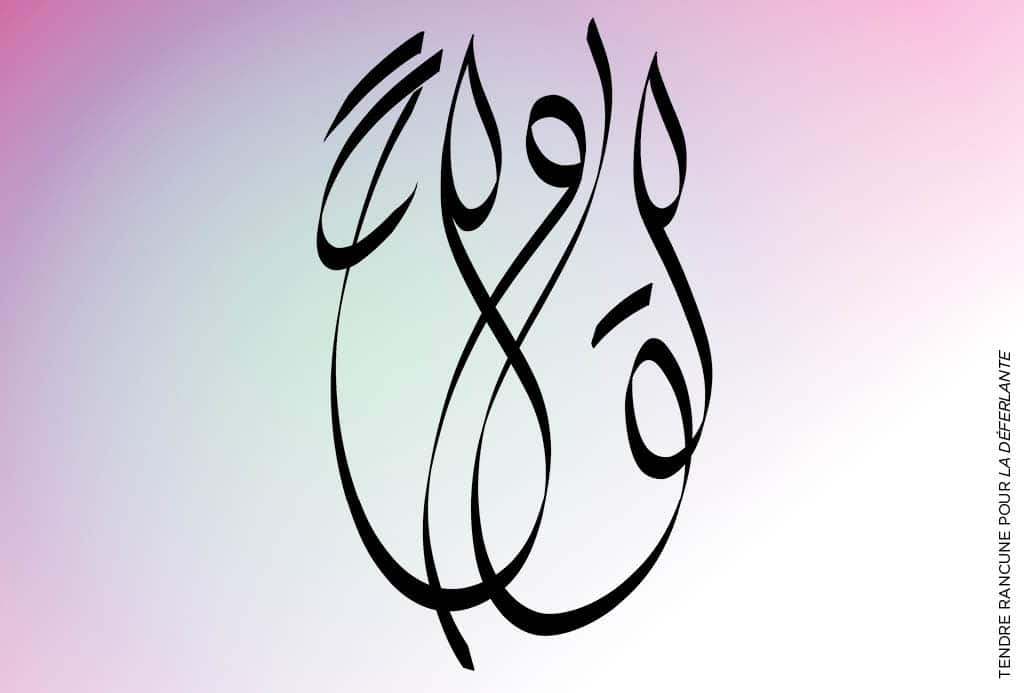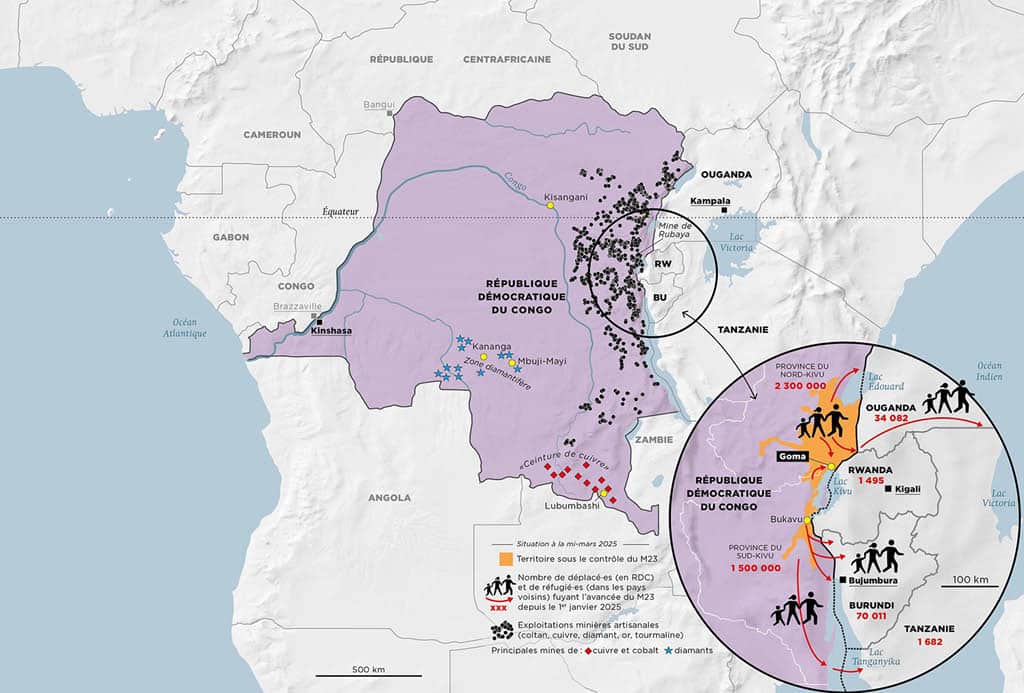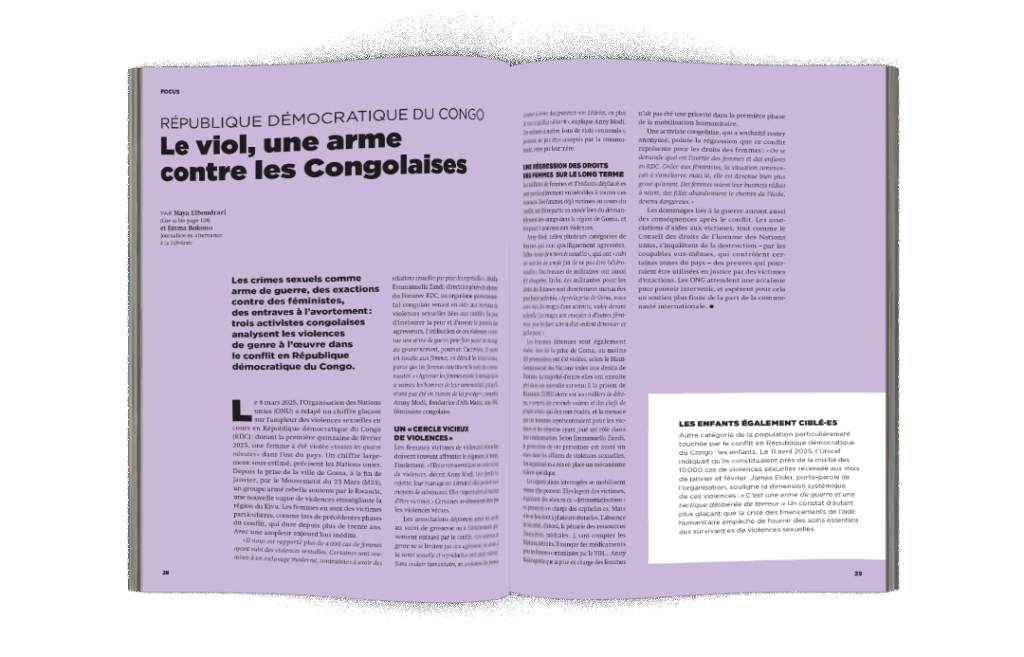Dans le centre Vilna, au cœur de Kyiv, une quinzaine de femmes sont réunies autour d’Olga pour un atelier de découverte de l’écriture cosaque, ces guerriers historiques, héroïsés en Ukraine. « Combien pesait l’arme d’un cosaque selon vous ? », demande-t-elle. « Deux kilos », « un kilo », tentent les participantes.
« On s’approche de la bonne réponse. Elle pesait entre 600 et 800 grammes », précise la professeure de calligraphie, une activité parmi d’autres proposée par ce centre aidant les femmes victimes de violences conjugales. Face à la hausse brutale de leur effectif depuis l’invasion de l’Ukraine le 24 février 2022, il a ouvert ses portes au printemps 2023 avec le soutien du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) en Ukraine.
Ce vendredi après-midi, les femmes, âgées de 30 à 65 ans, ont les traits tirés par le manque de sommeil. La nuit dernière, la capitale ukrainienne a essuyé une énième attaque de drones russes. Aucune d’entre elles ne s’en plaint. Aucune n’évoque non plus les raisons qui l’amènent ici. Le but de ce centre est d’offrir un espace safe : aucune justification n’est requise. Les participantes s’inscrivent anonymement aux activités : yoga, méditation, art-thérapie.

Le sujet des violences conjugales est tabou. Si le ministère de l’Intérieur ukrainien a enregistré en 2023 une hausse de 20 % des infractions pénales liées aux violences conjugales et intrafamiliales depuis 2022, les chiffres restent bien en dessous de la réalité tant les violences auxquelles les femmes sont confrontées au sein de leur foyer sont tues.
« Il y a d’autant plus de difficultés à demander de l’aide – et beaucoup plus de culpabilité de la part des victimes – du fait du contexte de guerre dans lequel nous vivons », explique Alyona Kryvuliak, directrice du département Hotlines de La Strada, l’ONG ukrainienne référente pour l’assistance apportée aux victimes de violences conjugales et intrafamiliales. « En temps normal, elles pensent déjà être responsables de cette violence et ont du mal à se reconnaître en tant que victimes. Avec la guerre, elles estiment que d’autres personnes souffrent davantage, qu’elles ont de la chance d’être en vie ou de ne pas se trouver sur la ligne de front. »

Séance de yoga au centre Vilna, un centre d’aide pour femmes victimes de violences conjugales, à Kyiv, Crédit : Oksana Parafeniuk.
Un sujet tabou en temps de guerre
Tamara*, 31 ans, réfugiée de Bakhmout (1), vit à Kyiv avec ses trois enfants depuis cinq mois, dans un centre d’hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Dans la cuisine commune, les enfants jouent avec un poupon, quelques peluches et des tanks en plastique tandis que les mères préparent le déjeuner.
Enceinte de sept mois, Tamara ne parvient pas à se défaire de sa petite dernière, qui ne jure que par ses bras. Elle a hâte que vienne l’heure de la sieste : ensuite, ce sera son moment à elle, celui où elle tente de trouver la paix en pratiquant l’art-thérapie.
« Il est d’autant plus difficile de dénoncer son compagnon qu’il combat ou a combattu sur la ligne de front. »
Alyona Kryvuliak, de l’ONG La Strada
Lors de ses passages à l’hôpital avant son arrivée à Kyiv, elle n’a pas précisé la raison qui l’y amenait. « Je ne voulais pas parler de problèmes intimes à des gens que je ne connaissais pas, explique-t-elle avec difficulté. Ils avaient déjà trop de choses à gérer à cause de la guerre, assure-t-elle en frottant ses mains l’une contre l’autre. Et mon mari aussi. » Dans une société où le soldat, défenseur de la patrie, est vu comme un héros, rares sont les femmes qui s’autorisent à parler. « Il est d’autant plus difficile de dénoncer son compagnon qu’il combat ou qu’il a combattu sur la ligne de front », explique Alyona Kryvuliak, qui travaille à La Strada depuis 2014.

Un constat partagé par Anna Hrubaya, psychologue spécialiste des violences genrées. « La Russie est l’agresseur, le démon, dans l’imaginaire collectif, explique-t-elle juste après une alerte aérienne forçant à se mettre à l’abri. C’est accepté et attendu qu’on parle d’eux comme des ennemis. La violence de la part de l’homme qu’on aime, dans ce contexte, est impossible à imaginer. C’est beaucoup plus difficile de dépeindre les Ukrainiens comme des agresseurs. » Celles qui l’ont fait sur les réseaux sociaux ont reçu des tombereaux de commentaires haineux.
Pour autant, dans le cabinet où elle exerce, Anna Hrubaya a vu sa patientèle, issue de classes sociales privilégiées, exploser pour cette raison depuis le début de la guerre. L’une de ses patientes, dermatologue, « a bien conscience du problème. Elle sait que ce n’est pas normal, mais elle ne veut pas demander le divorce de peur de faire souffrir son mari, qui est sur la ligne de front et n’en reviendra peut-être jamais. » Il a fallu du courage à Olga*, 37 ans, pour le faire. La majorité de ses ami·es lui a tourné le dos depuis. « Ils le soutiennent lui, en me disant que je suis un monstre de l’avoir abandonné dans de telles circonstances », explique-t-elle.
Des agresseurs insoupçonnables
À la tête d’un centre d’hébergement pour femmes victimes de violences conjugales depuis une dizaine d’années, Olga s’est elle-même retrouvée dans cette situation à partir de 2022. En visio depuis une ville à environ 200 kilomètres à l’est de Kyiv, elle raconte : « En tant qu’experte du sujet, je savais très bien de quoi il s’agissait. J’ai rapidement pris conscience de la situation dans laquelle je me trouvais, même s’il m’a fallu un an pour réagir et pour faire moi-même ce que je conseille aux autres femmes. »
Avant le début de la guerre, Olga n’avait jamais « eu de problèmes de cet ordre ». Elle décrit un époux aimant, « un homme lambda qui [la] soutenait dans [son] travail ». La quinquagénaire parle presque sans émotion, comme s’il s’agissait d’une autre vie que la sienne, celle qu’elle menait « avant le 242 et qui n’existera plus jamais ».
Celle où son mari ne s’était pas engagé sur la ligne de front quelques jours après l’invasion du pays, « lui qui n’avait jamais tenu d’arme, qui aimait les promenades en forêt et la pêche comme loisir le week-end ». « Tous les hommes autour de lui ou presque s’engageaient. À ce moment-là, toute la société voulait en être », poursuit-elle avec amertume. Il a alors rejoint les Forces spéciales ukrainiennes et a été envoyé en première ligne. « Rapidement, je me suis rendu compte qu’il buvait beaucoup avec ses “frères d’armes”, comme il les appelait, et il a fini par m’avouer qu’il se droguait aussi de temps en temps pour relâcher la pression. »
L’augmentation des violences genrées en temps de guerre
D’après une étude réalisée conjointement par ONU Femmes et Care sur les violences basées sur le genre (VBG) en zones de guerre, la situation en Ukraine est alarmante. « En période de guerre, les femmes sont les premières à perdre leur emploi, à subir les répercussions économiques de la guerre, et donc à perdre leur indépendance, décrit dans son bureau à Kyiv Daria Chekalova, chargée de plaidoyer genre pour l’ONG Care. C’est l’un des facteurs qui explique que, au cours de ces trois années de guerre, les stéréotypes sexistes et les VBG se sont intensifiées. Le stéréotype de la mère protectrice de la famille et du père protecteur de la nation s’est renforcé, comme dans chaque conflit. Toute guerre exacerbe le renforcement des rôles traditionnels, l’Ukraine n’y échappe pas. » L’État ukrainien n’a pas les moyens de répondre correctement à l’urgence de parer à
ces violences. Or les questions de genre, en temps de guerre, « ne sont pas du tout vues comme une priorité par la communauté internationale, rappelle Diane Richard, porte-parole de l’ONG Plan international France, dans un rapport sur le sujet en février 2024. Seulement 4 % des financements sont alloués à cette question, ce qui en fait le secteur le moins financé dans la réponse à la guerre en Ukraine. »
À son retour des tranchées, près d’un an plus tard, les violences commencent, d’abord verbales et psychologiques, puis physiques. Olga comprend que son mari a basculé. « J’ai compris que c’était fini le soir où il m’a demandé de fermer les yeux et de le suivre dans la salle de bain. Il a posé une grenade dégoupillée dans ma main. J’étais paniquée. Ma fille de 15 ans dormait dans la chambre à côté. Il s’est mis à rire et m’a dit avec mépris : “Oh ça va, elle n’est même pas chargée !” » Olga lui annonce alors qu’elle veut divorcer. « Quelques jours après, il m’a séquestrée plusieurs heures. Il me hurlait que j’inventais tout parce que je côtoyais trop de “vraies” victimes de violences conjugales. »
Avant la guerre, l’Ukraine commençait à faire bouger les lignes en matière de législation contre les violences genrées, mais l’invasion du pays a freiné ces avancées. Le pays a criminalisé les violences conjugales en 2017, mais les femmes restent mal informées sur leurs droits. Paradoxalement, la guerre a tout de même permis une avancée majeure : l’Europe ayant les yeux rivés sur le pays, la Convention d’Istanbul3 a été ratifiée en juin 2022, après des années de réclamation des associations féministes. Mais dans les faits, la prise en charge des victimes reste à la peine.
« Le victim blaming est encore trop présent en Ukraine, explique Kateryna Ilikchiieva, avocate spécialiste des violences faites aux femmes. Le pays est encore très imprégné de croyances anciennes avec l’idée que toutes les familles vivent ça, que c’est normal. Ça se traduit dans nos lois et dans l’accueil que réservent aux victimes la police, la justice et le corps médical ». C’est ce qu’illustre le témoignage d’Olga : « La police a fini par intervenir, mais elle n’a rien fait pour moi. Elle ne m’a pas proposé de porter plainte ou de me mettre à l’abri. »
« Le pays est encore très imprégné de croyances anciennes avec l’idée que toutes les familles vivent ça, que c’est normal. »
Kateryna Ilikchiieva, avocate spécialiste des violences faites aux femmes
Indépendante financièrement, Olga a pu louer un autre appartement sans faire appel à un centre d’hébergement similaire à celui qu’elle gère. Elle est un cas à part. La majorité des femmes ont perdu leur emploi à cause de la guerre et sont désormais économiquement dépendantes de leur conjoint.
C’est pourquoi le centre Vilna propose des réunions d’information sur les aides financières auxquelles les femmes peuvent prétendre, même si elles sont minimes. Elles sont peu nombreuses à s’y rendre. Si cela est déjà compliqué en temps de paix, en temps de guerre, cela nécessite davantage de ressources et une énergie que toutes n’ont pas toujours. La fatigue physique et psychologique, ajoutée au stress accumulé au quotidien du fait des bombardements russes, explique aussi la difficulté à fuir le bourreau qui partage leur intimité.

Une précarisation décuplée
Olena*, 40 ans, vient de trouver refuge avec sa fille dans un centre d’hébergement à Kyiv, après avoir fui son compagnon. Juriste dans une banque d’affaires avant l’agression russe, elle non plus n’avait jamais été confrontée à la violence de son compagnon jusque-là. Elle a « tout perdu du jour au lendemain », à commencer par son emploi. « La majorité des déplacé·es internes sont tombé·es dans la pauvreté et n’ont plus le même niveau de vie ni la même place au sein de la société, ce qui favorise l’augmentation des violences », décrypte Alyona Kryvuliak, de La Strada.
Le compagnon d’Olena a « vrillé quelques semaines après le début de la guerre » : « Il possédait une maison de famille qu’il pensait être un lieu sûr. Face à l’avancée des Russes, il a proposé à plusieurs de ses proches de les héberger, mais un bombardement les a tous·tes tué·es. Il a fait une dépression nerveuse. » Elle continue : « Il m’avait envoyée dans l’ouest du pays pour me mettre à l’abri avec ma fille et le bébé que j’attendais. Il m’a demandé de revenir pour être à ses côtés afin de le soutenir, ce que j’ai fait. Je n’allais pas le laisser seul dans de telles circonstances. Les violences ont commencé quelques jours après. »
Olena a bien conscience de l’anormalité de la situation, mais… « Où pouvais-je aller ? demande-t-elle avec amertume. Mes parents sont en zone occupée, mes amies sont toutes éparpillées à l’étranger. Enceinte et sans argent, comment pouvais-je prendre de nouveau le chemin de l’exil ? » Aujourd’hui, elle paye cher le fait d’être parvenue à se libérer de son bourreau.
Son fils, né à la fin de l’année 2022, est resté avec son père. « Il me détenait enfermée chez nous, il a pris tous mes documents administratifs. J’ai réussi à fuir un jour où il est parti faire des courses avec notre bébé. » L’enfant est aujourd’hui l’objet de tous les chantages : si elle veut le revoir, elle n’a qu’à retourner auprès de son agresseur. Le cadre juridique ukrainien pêche à défendre les femmes dans une telle situation.
La double peine
Irina*, elle, vit toujours sous le même toit que son agresseur. Gérante d’un magasin d’alimentation avec son mari depuis trente-cinq ans, elle n’a pas d’autre choix que de rester à ses côtés. Survivante de violences sexuelles commises par les troupes russes, elle a accepté de témoigner en visio depuis une région du sud de l’Ukraine. Aux traumatismes des violences déjà subies s’ajoutent désormais ceux liés à la violence de son mari.
« Quand les soldats russes sont partis, mon mari ne m’a plus adressé la parole, murmure-t-elle. Une seule fois, il m’a demandé pardon de n’avoir pas su me protéger. » Irina a 60 ans ; elle a été violée par des soldats « qui avaient l’âge de [son] fils ». « Mon mari me rabaissait constamment. Il me disait que je ne valais rien, que je n’étais rien sans lui, et il a fini par me reprocher d’avoir failli mourir à cause de moi. Il inversait la situation en se faisant passer pour la victime. Oui, les Russes lui avaient braqué un fusil sur la tempe parce que je ne me laissais pas faire, raconte-t-elle de manière mécanique. Mais il n’a même pas essayé de les empêcher. Il ne m’a jamais demandé ce qu’il s’était passé après… Moi, j’ai fini par arrêter de lutter pour que les Russes ne tuent pas mon mari, ce qu’ils menaçaient de faire si je ne cédais pas, mais lui n’a jamais voulu savoir ce que j’avais vécu pour le protéger. »
Elle interrompt régulièrement son récit. « Il ne voulait rien entendre. Alors j’ai arrêté d’essayer de parler. » Irina confie : « Plus personne ne peut poser une main sur moi sans que je veuille l’étrangler. Alors je comprends qu’il ait besoin d’aller voir ailleurs. » Si elle reconnaît subir l’agressivité, le harcèlement et les menaces de son mari, paradoxalement, elle affirme aujourd’hui : « Je n’ai plus peur de lui. Je me fiche de ce qu’il me dit. Je me sens mieux armée face à lui. Mon attitude a changé à son égard. Je ne suis plus sa chose. Après ce que j’ai vécu, sa violence me paraît insignifiante. »
Dans un bar de Kyiv, un vendredi à 18 heures, non loin d’un groupe de jeunes qui commencent leur soirée tôt en raison du couvre-feu, Kateryna Ilikchiieva explique que « le niveau de tolérance à l’égard de la violence a augmenté à cause de la guerre ». Elle s’interrompt, sur le qui-vive : « C’est le bruit de l’alerte qu’on entend là ? Ah non, c’est une voiture de police. » Elle reprend : « On vit dans un contexte de telles violences depuis trois ans que certaines paraissent aujourd’hui dérisoires. »
Irina, elle, promet que quand la guerre sera finie, si elle en trouve la force, elle demandera le divorce. Une parole rare pour une femme de 60 ans vivant en zone rurale en Ukraine, survivante de l’inhumanité d’une guerre qui l’a rendue plus combative. •
Cet article a été réalisé grâce à une bourse attribuée par The Europe-Ukraine Desk, un projet lancé par l’ONG n‑ost. Audrey Lebel remercie la fixeuse Olga Podorozhna pour son aide. Le reportage a été réalisé à Kyiv en octobre 2024.
* Pour des raisons de sécurité, les prénoms ont été modifiés et certains lieux ne sont pas mentionnés.
(1) Bakhmout, « la Verdun de l’Ukraine », est une ville située dans l’est du pays, rasée après plusieurs mois de batailles entre l’armée russe et l’armée ukrainienne.
(2) « Le 24 » est l’expression utilisée dans la société ukrainienne pour parler de l’offensive générale aérienne, maritime et terrestre déclenchée par la Russie sur l’ensemble du territoire ukrainien le 24 février 2022.
(3) La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, appelée « Convention d’Istanbul », est un traité européen adopté en 2011 amenant les 45 États signataires à ce jour à s’entendre et à mettre en œuvre les mesures législatives nécessaires à l’élimination de toutes les formes de violences envers les femmes.