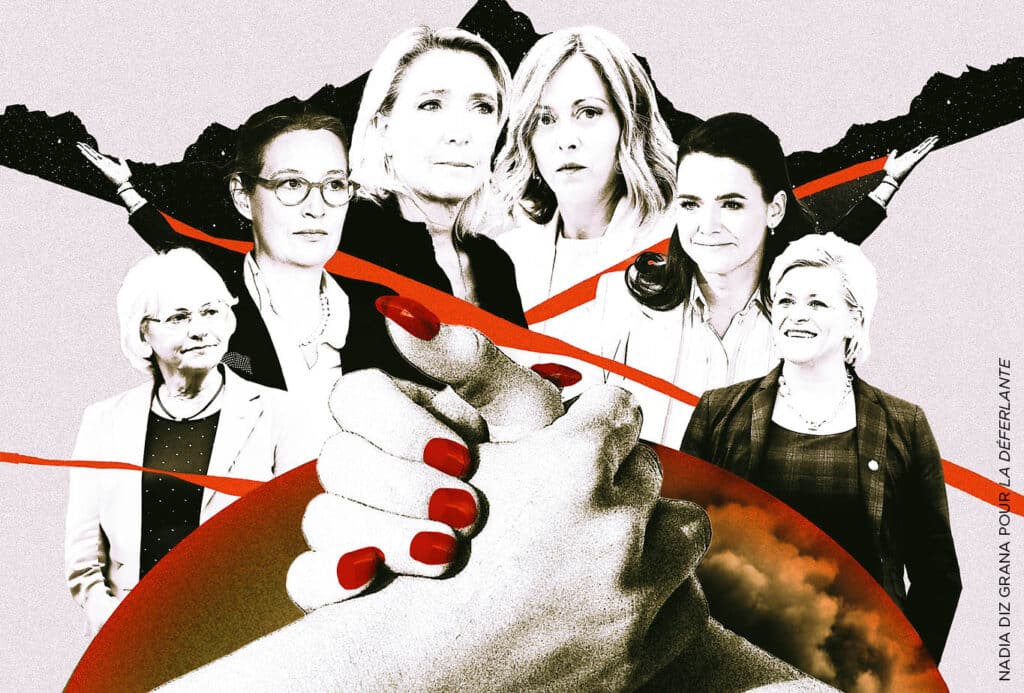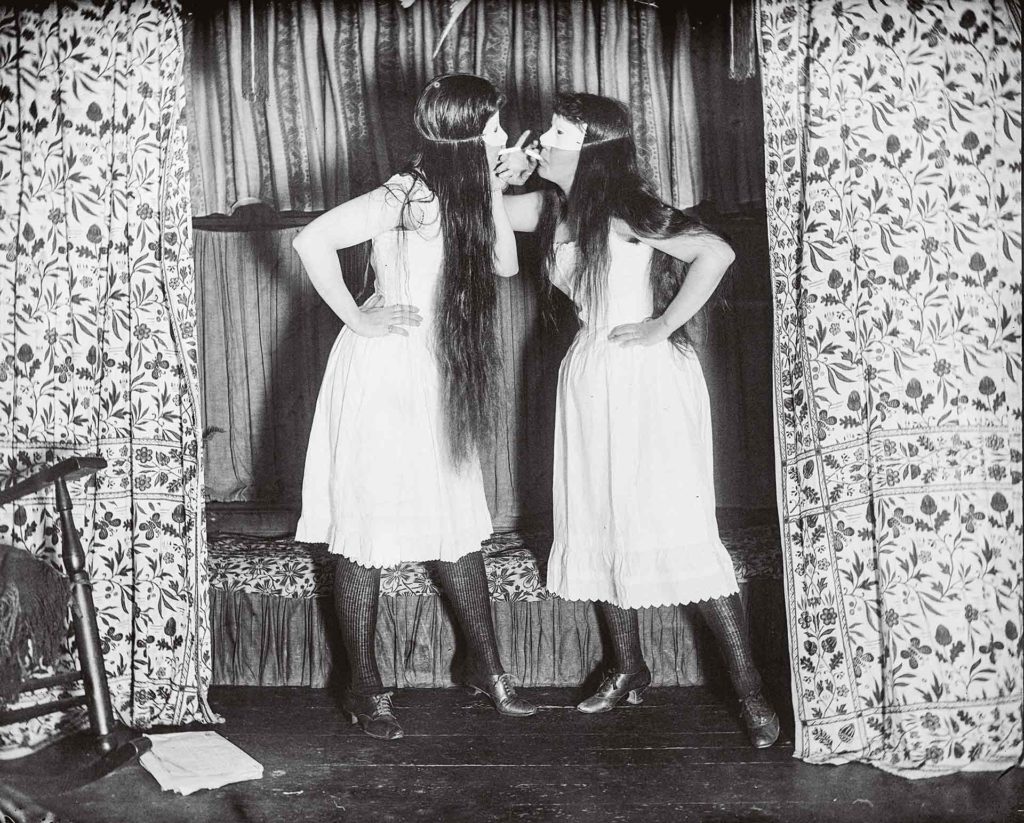La transphobie condamnée en Argentine
Le tribunal de La Plata, près de Buenos Aires a reconnu Luis Alberto Ramos coupable du meurtre de Tehuel de la Torre, jeune homme trans disparu le 11 mars 2021 et dont le corps n’a pas été retrouvé. Il a été condamné à la prison à perpétuité pour homicide aggravé en raison de la haine de l’identité de genre de la victime. C’est une première : jusqu’ici la justice argentine n’avait reconnu la dimension transphobe de crimes de haine que dans des cas où des femmes trans en étaient victimes.
Les Sud-Coréennes face à la violence sexuelle en ligne
Le 22 août 2024, le média sud-coréen Hankyoreh a mis en lumière l’ampleur de la pratique des deepfakes pornographiques, ces montages générés par intelligence artificielle sans le consentement des personnes concernées – des femmes et des filles majoritairement. Dans nombre d’établissements scolaires et universitaires, par l’application Telegram, des garçons et des jeunes hommes diffusent ces images, accompagnées parfois d’informations personnelles sur les victimes. Le 27 août, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a annoncé l’ouverture d’une enquête approfondie sur les crimes sexuels numériques (voir aussi le portfolio dans le numéro 15 de La Déferlante, août 2024).
En Inde, vagues de manifestations contre les féminicides
Le 9 août 2024, une médecin de 31 ans a été violée puis assassinée dans un hôpital public de Calcutta. En réaction, pendant plusieurs semaines, les professionnel·les de santé ont multiplié les grèves et les manifestations. Des milliers d’Indien·nes ont rejoint les mobilisations qui se sont tenues partout dans le pays, et lors desquelles sont dénoncées à la fois les conditions de travail des soignant·es et les violences sexuelles endémiques dont sont victimes les femmes en Inde.
En Namibie, les relations homosexuelles décriminalisées
La Haute Cour de Namibie a déclaré, le 21 juin 2023, que « le délit de sodomie [était] anticonstitutionnel et invalide », tout comme « les délits de sexe contre nature ». Adoptés en 1927, à une époque où le pays était une colonie sud-africaine, maintenus après l’indépendance en 1990, ces textes législatifs étaient rarement appliqués. Bien qu’elle puisse faire l’objet d’un appel auprès de la Cour suprême, leur abrogation est une victoire pour les personnes LGBT+, attaquées violemment ces derniers mois par les autorités politiques et religieuses.
Les Afghanes refusent le silence
Elles se sont filmées chantant et récitant de la poésie, le visage flouté ou à découvert, et ont posté ces vidéos sous les hashtags #MaVoixN’estPas’Awra (« awra » désigne en arabe les parties du corps qu’il conviendrait de cacher) ou #LetUsExist (Laissez-nous exister). À la fin d’août, des dizaines d’Afghanes dénonçaient une loi tout juste promulguée par le régime taliban qui leur interdit notamment de chanter, de réciter de la poésie, et même de parler en public. Une énième preuve de ce que l’Organisation des Nations unies qualifie d’« apartheid de genre », mais qui, au-delà des protestations convenues, ne suscite guère d’émotion particulière au sein des diplomaties occidentales.