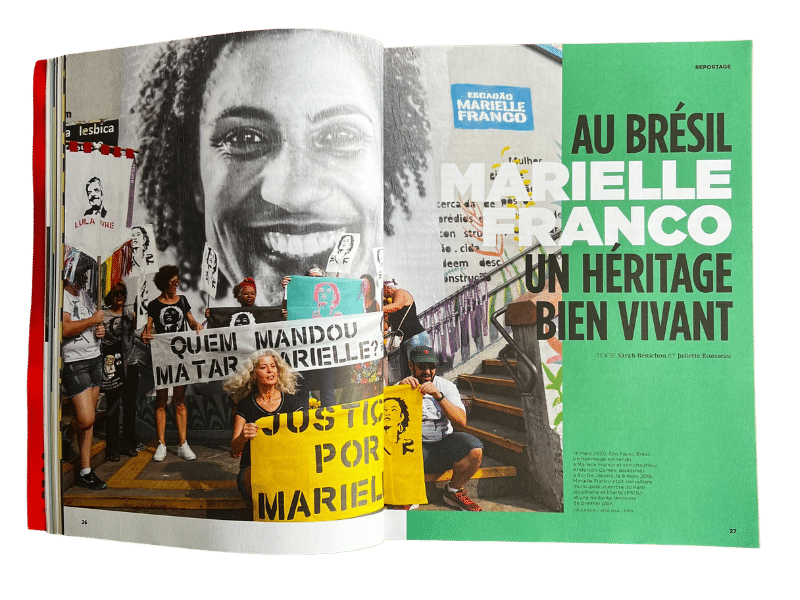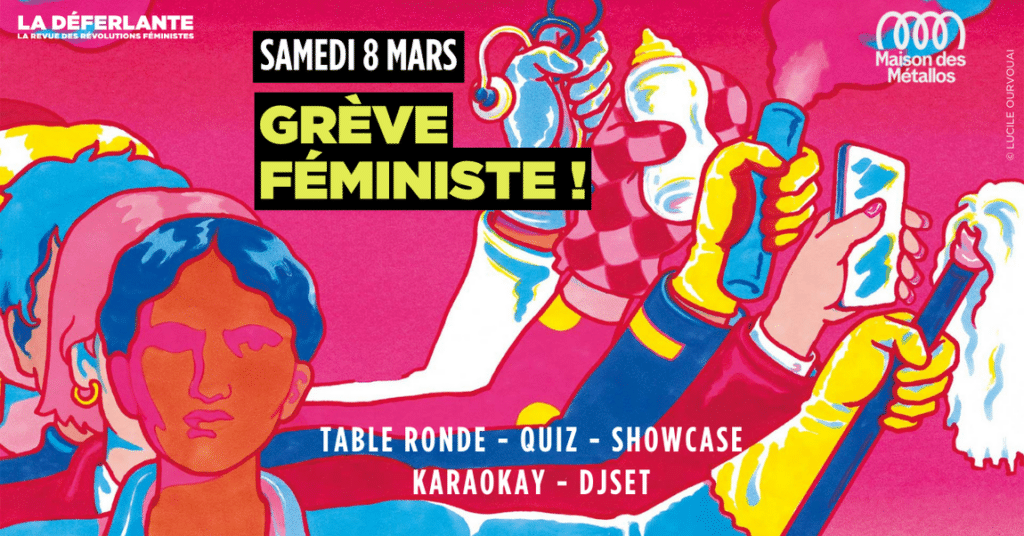Dans le placard parental, côté mère, il y a une étagère pleine de chutes de tissu. De l’écossais, du madras, du wax, du coton uni, du Liberty, de la toile épaisse. Des morceaux de toutes tailles enroulés en boudins, parfois rassemblés dans des sacs plastique ou juste laissés en vrac, car trop grands pour y entrer. Rien n’est jeté : les doublures des vêtements d’enfants sont des restants de chemises pour adultes.
Les rubans de soie peuvent épouser des boutonnières, garnir des bords de manches ou décorer des coussins. Un canevas d’antan est épinglé au dossier d’un fauteuil du salon. Ma mère a toujours été fascinée par les patchworks, mais ne s’y est jamais vraiment essayée, alors tout est gardé en attente d’une utilisation future. Je passe la main dans sa penderie, et de ces vêtements qu’elle a imaginés et cousus, déborde sa coquetterie, sa fantaisie aussi.
Le corps de ma mère n’est pas taillé pour la fast-fashion, ni pour la fashion tout court. Petits bras, épaules minuscules et inégales, grosse poitrine, dos pas droit, ventre sans abdos d’où l’on a extrait trois enfants. Sanglée à sa jambe gauche pour soutenir la marche, une orthèse imposante, de fer et de cuir, qui accélère l’usure des vêtements à la cuisse : ma mère vit avec la polio depuis qu’elle est en âge de se tenir debout. 90 % de ses muscles ne fonctionnent pas. Elle a appris à marcher en composant avec les absences, utilisant tous les subterfuges pour évoluer librement.

Marie-Claire Pineau Bénudeau (deuxième enfant en partant de la droite de la photo) entourée de ses frères et sœurs. Les vêtements des enfants étaient cousus par sa mère.
Les vêtements de la grande distribution sont faits pour les minces, pour la démarche des gens que l’on dit valides, pas pour celle, balancée, de ma mère, quand elle marchait encore. Encore moins pour l’assise dans le fauteuil roulant. Alors pour être à l’aise et grappiller son droit à la coquetterie, ses vêtements, elle les a faits sur mesure. Elle les a adaptés à sa vie.
Le corps de ma mère n’est pas taillé pour la fast-fashion, ni pour la fashion tout court.
Ado, elle s’obstinait à se rendre aux bals du village, où elle regardait ses sœurs danser la valse, le tango, la java. Elle faisait bonne figure. Il faut bien appartenir à quelque chose. Sa mère lui fabriquait – comme à ses neufs frères et sœurs – des tenues adorables, un jumper avec des petits motifs, des robes courtes mais pas trop, des chasubles col bateau, des pantalons évasés, parfaits pour l’orthèse. Elle se sentait « très mode », avec ses longs cheveux tressés, son air de gentille baba cool proprette. Son seul regret : ne pas pouvoir porter des panties en dentelle qui dépassaient des jupes de ses camarades de classe et que son orthèse aurait déchirés tout de suite.
Mais, toujours, elle s’efforçait de voir les choses du bon côté : son handicap lui donnait toute liberté d’explorer des chemins de traverse. Fumer la pipe, manquer les cours, rouler en voiture pour aller chercher les soleils couchants. Les bonnes sœurs du collège la réprimandaient, mais pas tant que ça.
Quand je lui ai demandé quelle était la première tenue qu’elle avait vraiment confectionnée, après des années à porter les créations maternelles, j’imaginais une blouse seventies, un pantalon pattes d’eph’, bref quelque chose de seyant. Maman m’a dit « un peignoir, sans modèle, sans patron ». Fuyant alors le destin de secrétaire dans les poulaillers industriels qui lui tendait les bras, elle quittait la ferme familiale pour partir à Rennes faire ses études. Elle allait avoir son espace, sa salle de bains, puis son métier, sa vie indépendante.
Avant de mettre ses affaires dans sa petite Austin et de tailler sa route, elle s’était donc fabriqué un peignoir, comme ceux qu’elle voyait petite dans les vitrines à Angers, quand sa mère l’amenait chez le kiné une fois par semaine. « Nous on s’essuyait avec des serviettes, c’était efficace. Pour moi ce vêtement en éponge c’était la montée dans le rang social où on pense au confort aussi. C’est douillet, c’est le repos, la vie saine. » Elle était allée chez l’une de ses sœurs pour travailler sur une machine électrique et le terminer à temps, ce vêtement synonyme de revanche sur la prédestination. Des années plus tard, avec l’argent reçu en cadeau de mariage, mon père et elle avaient décidé d’acheter une machine à coudre. Son coin couture : sa chambre à elle, dans leur chambre à eux.

Marie-Claire Pineau Bénudeau en train de broder. Crédit photo : Mélanie Bahuon / Neutral Grey pour La Déferlante.
Année après année, elle a adapté ses créations à l’évolution de son corps. Elle a taillé des pantalons de grossesse sans prendre modèle nulle part. Et puis une sortie-de-bain pour l’enfant à venir, avec des petites chouettes brodées à la machine. Ses pantalons, elle était la seule à savoir les faire car la seule à les habiter : des poches et une ceinture faisant office de sangle abdominale pour aider à la marche, des jambes larges, des renforts aux endroits de frottement. Pour les chemises, elle taillait une épaule plus haute que l’autre, des emmanchures larges pour que ses bras puissent s’appuyer sur sa poitrine et conserver toute latitude pour se gratter la tête, se nourrir, attraper, enfourner, couper, coiffer ou chatouiller.
Son handicap lui donnait toute liberté d’explorer des chemins de traverse. Fumer la pipe, manquer les cours, rouler en voiture pour aller chercher les soleils couchants.
Et un jour il a fallu accepter le fauteuil roulant, temporairement, puis pour toujours. Une dure étape qu’elle a pu tourner à son avantage grâce à son éducation dure au mal… et à la mode. Car elle a pu enfin se fabriquer des robes amples et légères dans des tissus fleuris, des tops, ses jambes nues ont retrouvé le vent frais, elles qui s’étaient habituées à la fournaise du pantalon, porté toute l’année.
Elle a commencé à mettre des colliers, du rouge à lèvres, des bracelets, des bagues, elle s’est acheté de belles et imposantes lunettes. Elle voulait attirer l’attention sur le haut du corps comme pour regagner la crédibilité que le fauteuil lui enlèverait forcément, dans un monde bâti pour les verticaux. Elle garde toujours dans un coin de sa tête l’image de Léone, la femme du village si jolie et si bien habillée, malgré ses déformations terribles, aux bras et aux jambes. Son visage poudré, sa mise en plis et ses petits chemisiers pastel étaient une revanche sur les sœurs de l’orphelinat qui l’exposaient – « façon foire aux bestiaux » – pour obtenir les dons des « bonnes gens ».
Aujourd’hui, l’atelier de couture de ma mère occupe l’ancienne chambre de mon frère, son fauteuil électrique passe facilement du couloir à sa table, pas besoin de manœuvrer pour se mettre au travail. Quand j’étais petite, l’odeur de l’huile dans la bouteille jaune, le ronronnement de la machine, les morceaux de fils en pagaille, les gigantesques papiers calques, les piles de Modes et Travaux faisaient partie de mon quotidien. La petite main de maman qui touche les tissus, vérifie la texture. Sa bouche pleine d’aiguilles piquantes quand elle nous faisait essayer des tenues reprisées ou confectionnées. Il fallait que ça tienne. On se piquait toujours.
Quand j’ai eu douze ans, ma mère m’a fait cadeau d’une boîte à couture. Une jolie boîte blanche, avec des compartiments aimantés pour les aiguilles, un espace pour les bobines, les petits ciseaux, le mètre, le dé à coudre. Quelques semaines plus tard, je la vidais et j’en faisais ma nouvelle boîte à crayons, toujours dans mon tiroir aujourd’hui. Elle adorait l’odeur des merceries, moi c’était les papeteries. Elle avait déjà tenté de m’offrir des canevas, qui à peine entamés – pour lui faire plaisir –, mouraient dans le fond d’un tiroir. Elle a tenté de m’impliquer dans la fabrication des vêtements de poupée, dans la réparation des chaussettes et des boutonnières, mais rien n’y faisait : la couture, pour moi ce n’était pas une passion comme ça l’était pour elle, pour sa mère avant elle, et peut-être pour celle d’avant, qui partageait la même date de naissance que moi. Cette transmission de mère en fille, elle a dû y renoncer.
Ma grand-mère, déjà, adorait vêtir ses filles, surtout. Les pantalons des garçons, elle les achetait. Mais la couture était aussi une question de bon sens paysan : un sou est un sou et ce qu’on peut faire soi-même, pourquoi l’acheter ? Quand elle allait à la ville avec ma mère et un autre de ses enfants parfois, elle passait au magasin de tissus et achetait des mètres de nylon, de percale de coton. Ma mère circulait – démarche chaloupée – entre les étagères en bois, où les rouleaux étaient bien organisés.
Elle imaginait qu’un jour elle aurait un meuble comme celui-là, en bois ciré. Elle regardait les dames de la ville, avec des vêtements qui les mettaient en valeur, leurs coiffures, leurs rouges à lèvres. Dans sa petite tête ronde, se dessinaient des modèles qui pourraient lui aller, avec des adaptations. Elle en voulait presque à sa mère courage de se coiffer avec des peignes dans les cheveux, pour les ramasser, plus que pour les décorer et d’éternellement porter des robes « coupe princesse » qui galbent les hanches fortes, les mollets musculeux, mais sans excès de coquetterie.

Marie-Claire Pineau Bénudeau en train de choisir un tissu parmi les chutes. Crédit photo : Mélanie Bahuon / Neutral Grey pour La Déferlante.
Pour habiller ses enfants, ma grand-mère prenait modèle sur d’anciens vêtements – les patrons étaient trop chers – les adaptait en fonction des centimètres gagnés des plus petits. Elle leur demandait de tourner autour de la grande table, pour regarder le vêtement bouger sur leurs petits membres. Elle voulait que ce soit parfait. Elle finissait les coutures dans la nuit, les enfants s’endormaient avec le battement de la machine mécanique, et le matin chacun·e avait sa tenue toute neuve, bien pliée. Le bonheur régnait dans la maison.
Pour les mariages, les baptêmes, ma grand-mère s’offrait exceptionnellement un tissu de qualité, pour elle. Ma mère a gardé cette habitude, pour les grandes occasions, de confectionner quelque chose de particulier, de se lancer dans un défi : un pli dans le dos, une couture alambiquée, du tissu très fin et cher qu’il ne faudrait pas gâcher. Sur la table du salon, elle passe des heures à faufiler, la couture à la main a sa préférence. Et puis elle tire une grande fierté de fabriquer pour pas cher, plutôt que d’acheter des « trucs fabriqués en Chine par des enfants ».
Un jour, au lycée, ma meilleure amie Jennifer m’a demandé de l’accompagner faire du shopping avec sa mère dans un centre commercial d’Angers. Je les observais faire, elles connaissaient les tailles des vêtements et avaient leurs boutiques. Peut-être aurais-je aimé aussi partager cela avec ma mère ? Quand on allait faire le trousseau de rentrée, dans la galerie commerciale, on ne s’attardait pas longtemps dans les magasins de vêtements, m’habiller n’était pas une de mes préoccupations. Ni coudre, ni danser. Comme si je refusais ce à quoi mon corps valide avait droit.
Mais aujourd’hui, quand je passe du temps dans la maison parentale ou quand je discute avec ma mère en visio, ce que j’aime le plus c’est quand elle me raconte les avancées de ses travaux de couture, et les commentaires sur mes vêtements.
Et quand elle dit : « Tu sais te mettre en valeur », résonne dans mon cœur la chanson de Dolly Parton Coat of many colors : « Je me sentais si riche dans ce manteau de toutes les couleurs et je racontais l’amour que ma mère mettait dans chaque coup d’aiguille, toutes les histoires qu’elle me disait quand elle faisait la couture. Mon manteau de toutes les couleurs valait bien plus que tous leurs vêtements réunis. » •