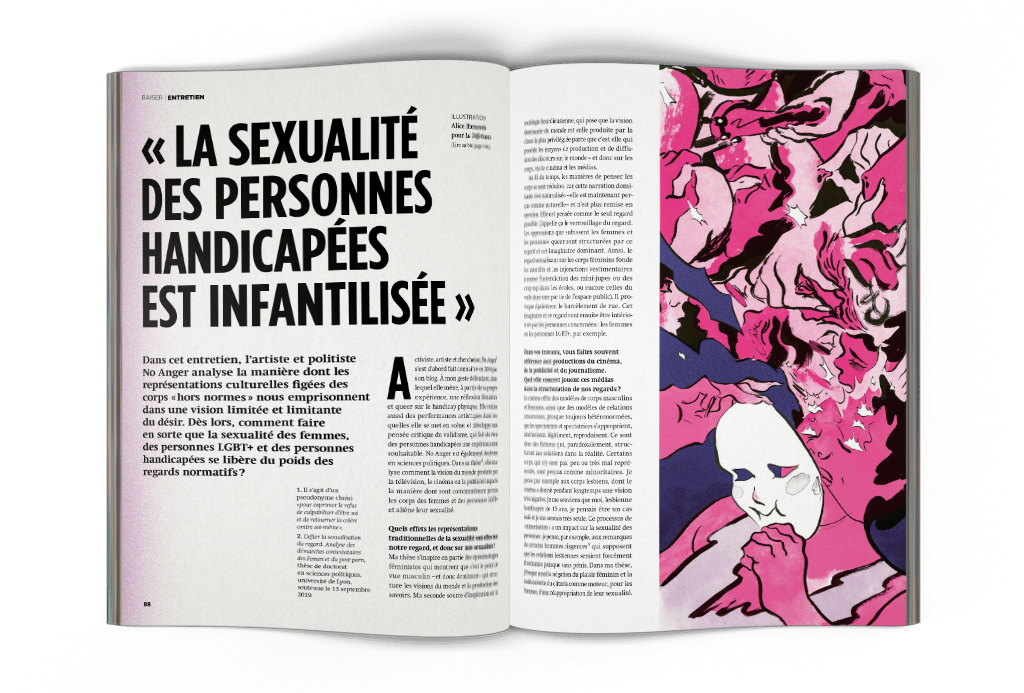« Aujourd’hui, je sors », annonce Florence Roux¹. Élancée, elle a mis du vernis à ongles rouge vif et porte un T‑shirt sombre discrètement pailleté.
Florence a 56 ans, elle vit au Puy-en-Velay (Haute-Loire) et alterne chantiers d’insertion, travail en centres d’appels et revenu de solidarité active (RSA). Elle touche actuellement le RSA majoré. Cette allocation est versée à la mère ou au père qui assume seul·e la charge d’un·e enfant ou de plusieurs. En avril 2022, un «parent isolé² » avec un·e seul·e enfant touche un montant maximum de 985,39 euros. Pour un père ou une mère avec quatre enfants, ce sont 1 724,41 euros maximum, selon les barèmes appliqués par la CAF. «
C’est discriminatoire d’avoir d’aussi petits revenus, explique Florence. Normalement, quand on voit d’autres familles, on discute des projets qu’on a. Mais nous, on n’a pas de projets, on vit au jour le jour. On est toujours en train de compter. » La vie de famille s’en ressent: elle n’a pas emmené ses enfants en vacances depuis plusieurs années, souffre de ne pas encore avoir payé l’enterrement de sa mère, décédée il y a sept mois, se rappelle son fils revenu de l’école primaire en pleurs parce qu’un camarade de classe lui avait dit: « Tu ne vas pas à la cantine parce que tu es trop pauvre. »
Florence Roux raconte les « rapports sociaux qui se délitent », les invitations qu’elle a dû refuser faute de pouvoir apporter un bouquet de fleurs. Sa santé pâtit aussi de cette « vie de privation et d’humiliation » : elle souffre de régulières crises d’angoisse. « Je rentre dans ma coquille quand je ressens un danger », dit-elle en se comparant à une tortue.
Les mères, grandes perdantes des séparations
On compte en France environ deux millions de familles monoparentales³ , soit une famille sur quatre. L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) considère comme « famille monoparentale » un parent qui vit seul avec ses enfants. Dans 82 % des cas, il s’agit de la mère. Les conditions de vie des familles monoparentales sont bien moins favorables que la moyenne. Selon l’Insee, le divorce conduit à une perte de niveau de vie de 20 % en moyenne pour les femmes, contre 3 % pour les hommes⁴. Un seul revenu est souvent insuffisant pour assurer un niveau de vie confortable : en 2019, 27,5 % des familles monoparentales étaient « pauvres en conditions de vie », contre 11,1 % des ménages et 17,5 % des personnes seules⁵. Pour l’Insee, « cela signifie qu’elles cumulent plusieurs difficultés parmi les suivantes : insuffisance des ressources, restrictions de consommation, retards de paiement, difficultés de logement ».
Dans la grande majorité, ce sont les mères qui se retrouvent à devoir assumer seules l’essentiel, voire la totalité, de l’éducation des enfants. Pourquoi ? Sibylle Gollac, sociologue, étudie depuis vingt ans les arrangements économiques qui ont lieu dans les familles, notamment au moment des séparations conjugales. « La demande de fixer la résidence principale des enfants chez la mère n’est pas le résultat de décisions de juges qui auraient un a priori favorable aux mères. La plupart du temps, c’est le résultat d’un consensus entre les parents », explique-t-elle⁶. Un consensus qui résulte de « l’organisation du travail dans la vie de couple ». Avant la séparation, l’essentiel de l’organisation familiale repose déjà sur les mères dans la majorité des couples. Des courses alimentaires à la prise de rendez-vous médicaux, le travail domestique est pris en charge aux deux tiers par les femmes.
Dans 97 % des dossiers de séparation, c’est le père qui doit payer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. En théorie, le montant de la pension alimentaire doit être décidé en fonction des ressources du père, de celles de la mère et des besoins des enfants. Mais, dans les faits, « les montants fixés dépendent avant tout du revenu du père débiteur. […] Un facteur est notablement absent des critères retenus par le tribunal : les ressources et conditions de vie des mères chargées des enfants » observent Sibylle Gollac et sa collègue Céline Bessière dans Le Genre du capital. Comment la famille reproduit les inégalités (La Découverte, 2020). Or, ces mères sont en moyenne, par rapport aux pères, plus souvent au chômage, travaillent davantage à temps partiel et/ou sont moins bien rémunérées. Appauvries, elles ont besoin que soit fixé rapidement le montant d’une pension alimentaire. Mais 20 % à 40 % de celles-ci, pourtant prévues par la justice française ne sont pas payées. Un état de fait contre lequel le collectif Abandon de famille – Tolérance zéro se bat depuis 2013. À partir du 1er janvier 2023, la Caisse d’allocations familiales (CAF) devrait prélever le montant des pensions non payées sur le compte bancaire du mauvais payeur (puisqu’il s’agit du père dans la plupart des cas) pour le verser sur celui de la créditrice. Cette mesure représente un progrès ; c’est en effet les mères qui se retrouvent systématiquement à devoir faire les démarches administratives pour obtenir les aides auxquelles elles ont droit.
Des représentations et des injonctions contradictoires
Lorsque les mères célibataires travaillent, on leur reproche parfois de ne pas assez s’occuper de leurs enfants. Lorsqu’elles ne travaillent pas, c’est le fait qu’elles ne soient pas autonomes financièrement qui inquiète. Les conditions d’attribution du RSA majoré en sont une illustration. Les parents isolés qui en bénéficient (des femmes à 96 %, dont la moitié a moins de 30 ans) doivent signer un « contrat d’engagement réciproque » dans lequel elles s’engagent à « rechercher activement un emploi ». Une phrase revient souvent dans la bouche des assistantes sociales auquel ont eu affaire les mères isolées avec lesquelles je me suis entretenue : « Il faut travailler, madame. » La priorité de la personne bénéficiaire doit être la recherche d’emploi. Mais cette recherche n’est pas toujours évidente. « Quand mon fils était petit, j’avais choisi mon travail en fonction des horaires scolaires, raconte Sylvie Lacroix, 49 ans, qui vit à Vorey-sur-Arzon (Haute-Loire) et élève seule son fils depuis qu’il est né, il y a quinze ans. Pendant cinq ans, j’ai été “emploi de vie scolaire⁷ ” dans une école. J’aimais beaucoup ce que je faisais, mais ça n’existe pas comme “vrai travail” : j’étais payée entre 650 et 850 euros par mois. Ça a été très compliqué pendant des années. Par la suite, j’ai fait une formation d’accompagnante éducative et sociale. Lors de mon premier stage, on m’a reproché de prendre trois jours parce que mon fils était malade. Pour mon premier travail, j’ai travaillé de nuit pendant quatre mois. Mon père est venu pour garder mon fils. Puis il est parti plusieurs semaines chez ma soeur. Moi je souffrais de tachycardie et mon fils faisait n’importe quoi. Mère célibataire précaire, c’est un parcours du combattant, il faut une énergie dingue. »
Ces mères doivent donc faire face à une injonction contradictoire : bien s’occuper de leurs enfants ET accepter des emplois, même peu rémunérés, avec des horaires souvent incompatibles avec ceux de l’école ou de la crèche. Florence Roux se souvient ainsi de discussions avec plusieurs conseillers et conseillères principales d’éducation (CPE). « Dès qu’il y avait un souci à l’école, les CPE me disaient : “C’est toujours pareil avec les femmes seules.” Un père seul, on ne lui dira jamais ça, on l’encouragera. Moi, personne ne m’encourage. » Les représentations de la famille monoparentale sont « variées mais elles restent malgré tout souvent négatives ; elles oscillent entre le blâme, la pitié et l’admiration. La famille monoparentale est celle à qui, de toutefaçon, il manque “quelque chose⁸” », analyse Jean-François Le Goff, psychiatre et thérapeute familial. Lorsqu’il y a un problème avec la famille monoparentale, c’est toujours la structure de la famille qui est mise en cause, avec une insistance sur l’absence du père, « ou, plus idéologiquement sur le manque d’autorité », remarque-t-il.
Un foyer monoparental est une famille à part entière
Jean-François Le Goff déplore que beaucoup de thérapeutes de la famille tiennent à ce que, dans les cas de couples séparés, le parent absent·e participe à la thérapie. Il invite plutôt ses confrères et consoeurs à prendre en considération la famille monoparentale telle qu’elle est au quotidien : avec un seul parent. Ce foyer doit se reconnaître comme une famille à part entière, sans référence permanente à un manque. Il insiste par exemple sur l’importance de créer de « nouveaux rituels spécifiques » à chaque famille monoparentale, en « ne reproduisant pas les rituels de la famille d’avant la monoparentalité ».
Une mère isolée et son enfant, surtout quand l’enfant est très jeune, sont en permanence ensemble, y compris lors de rendez-vous avec les administrations. La mère est alors souvent accusée d’être fusionnelle. « C’est une critique que j’ai beaucoup entendue quand mon fils était petit, comme toutes les mères isolées, fait remarquer Sylvie Lacroix. Pour moi, la fusion est dans le regard des gens qui voient un·e enfant avec sa mère. Bien sûr qu’il est fortement attaché à moi : je suis son seul repère ! Mon enfant compte sur moi, et heureusement ! »
À l’automne 2018, lors du mouvement des Gilets jaunes, des mères de famille célibataires se sont mobilisées sur les ronds-points pour dénoncer les difficultés auxquelles elles faisaient face. Cependant, ce moment collectif passé, elles ont souvent retrouvé la solitude. Trop peu d’associations consacrées à leurs combats tiennent sur le long terme parce que les femmes concernées manquent cruellement de disponibilité. Des forums de discussion en ligne peuvent constituer des lieux fédérateurs, comme en témoigne l’expérience de La Collective des mères isolées
Pour remplir leur mission impossible, toutes organisent leur vie au mieux. Leslie, Sigrid et Céline ont ainsi fait le choix d’habiter ensemble il y a quelques années. À cette époque, Leslie et Céline se séparaient de leurs conjoints respectifs et se retrouvaient chacune seule avec un enfant de 3 ans. Sigrid était retournée vivre chez sa mère avec son enfant à la suite d’une mésaventure professionnelle. Aucune n’avait les moyens de louer un appartement avec deux chambres. Ensemble, elles ont trouvé une maison. « Nos trois ans de colocation nous ont permis de nous reconstruire, de nous soutenir psychologiquement », commente Leslie, 38 ans.
Elles se sont mutuellement encouragées à suivre des formations qui leur permettent aujourd’hui d’avoir de meilleurs revenus. Quand l’une était absente, les deux autres s’occupaient des enfants. Au bout de trois ans, leur colocation a pris fin « naturellement », quand Céline a rencontré quelqu’un et que Sigrid a eu une opportunité professionnelle. Elles sont toujours très liées, organisent chaque deuxième week-end de janvier « le Noël des amis » et leurs enfants se réclament quand ils ne se sont pas vus depuis longtemps. « Comme nos enfants sont tous des enfants uniques, ça leur a permis de connaître une vie de famille avec des frères et des soeurs, de jouer ensemble dans le jardin », explique Leslie. Une famille de fait, pour un temps ou pour la vie.
*****
1. Il s’agit d’un pseudonyme.
2. Aux yeux de l’État, un « parent isolé » est un·e célibataire, divorcé·e, séparé·e, veuf ou veuve, ayant un·e enfant ou plusieurs à charge
3. Élisabeth Algava, Kilian Bloch, Isabelle Robert-Bobée, « Les familles en 2020 : 25 % de familles monoparentales, 21 % de familles nombreuses », Insee Focus, n0 249, 2021.
4. Carole Bonnet, Bertrand Garbinti, Anne Solaz, « Les variations de niveau de vie des hommes et des femmes à la suite d’un divorce ou d’une rupture de pacs », Couples et familles, Insee Références, 2015.
5. Enquête « Statistiques sur les ressources et conditions de vie » de l’Insee, 2022.
6. Émission « Sous les radars », France Culture, 16 avril 2022.
7. Emplois précaires et peu rémunérés destinés à apporter une aide aux élèves handicapé·es ou une assistance administrative au personnel de direction de l’école.
8. Jean-François Le Goff, « Les familles monoparentales sont-elles les oubliées des thérapies familiales ? », Thérapie familiale, 2006.