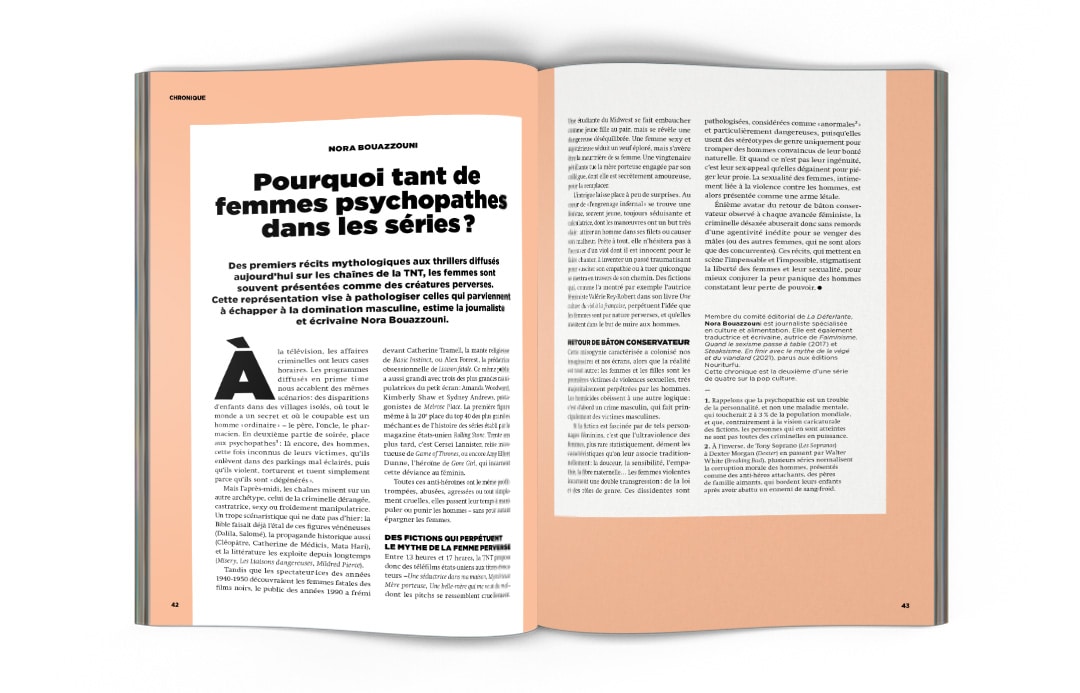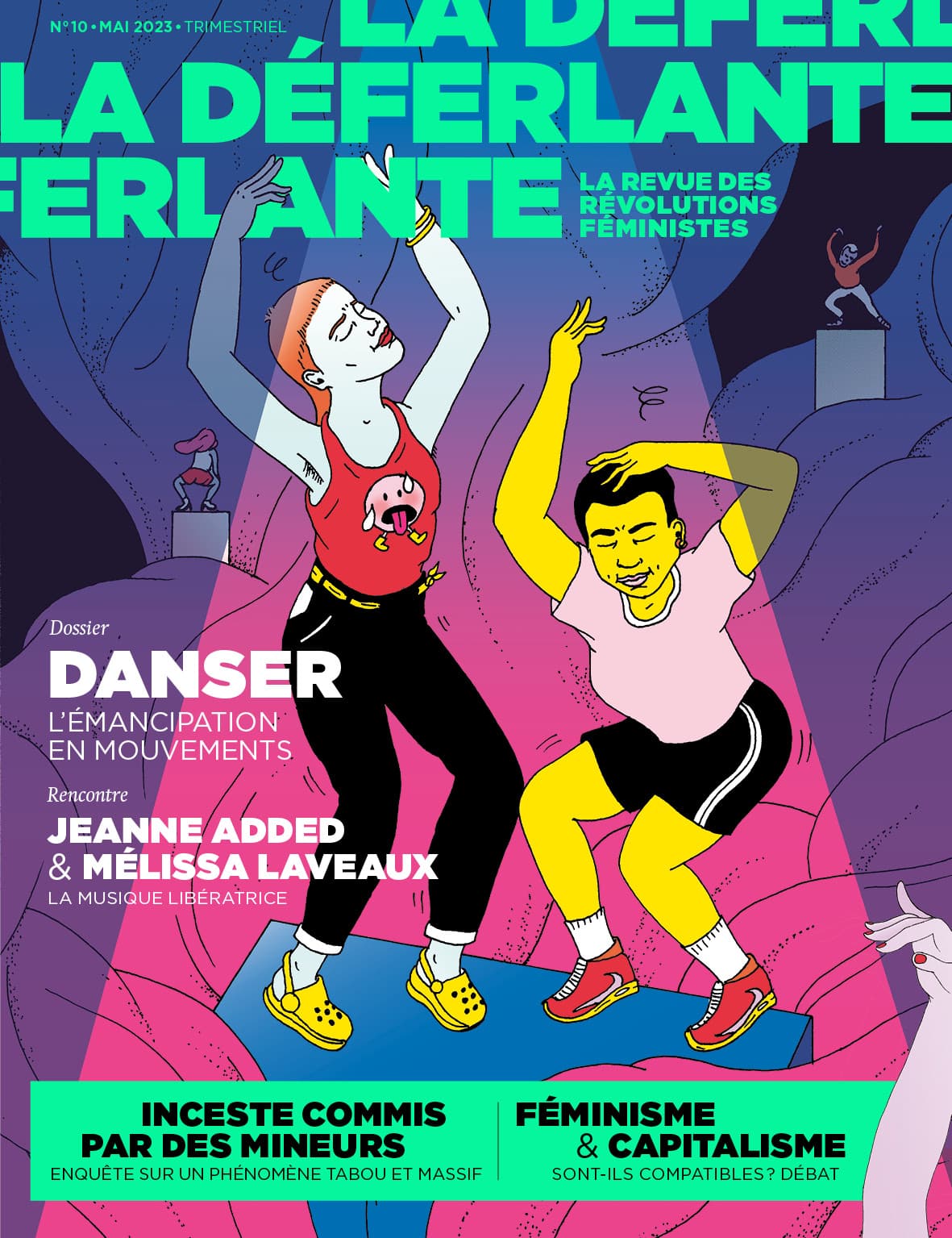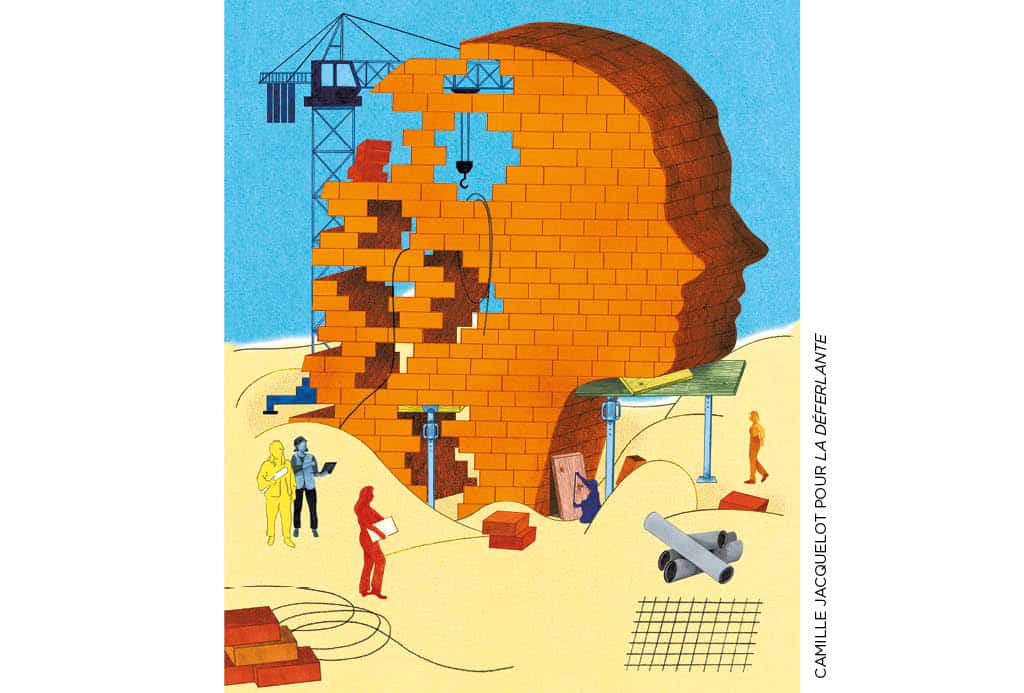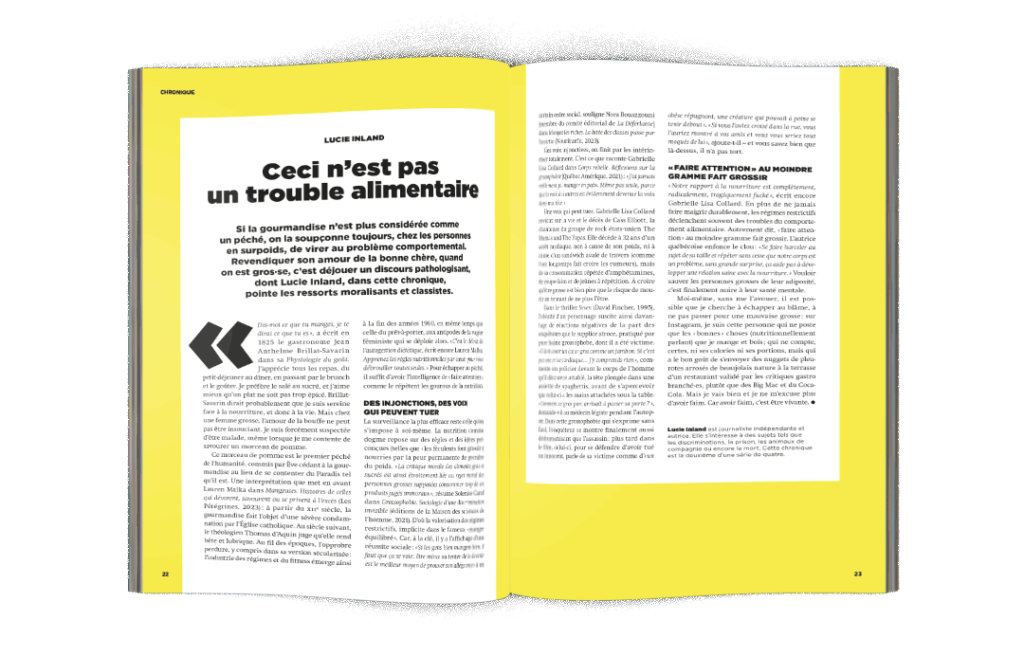À la télévision, les affaires criminelles ont leurs cases horaires. Les programmes diffusés en prime time nous accablent des mêmes scénarios : des disparitions d’enfants dans des villages isolés, où tout le monde a un secret et où le coupable est un homme « ordinaire » – le père, l’oncle, le pharmacien.
Tandis que les spectateur·ices des années 1940–1950 découvraient les femmes fatales des films noirs, le public des années 1990 a frémi devant Catherine Tramell, la mante religieuse de Basic Instinct, ou Alex Forrest, la prédatrice obsessionnelle de Liaison fatale. Ce même public a aussi grandi avec trois des plus grandes manipulatrices du petit écran : Amanda Woodward, Kimberly Shaw et Sydney Andrews, protagonistes de Melrose Place. La première figure même à la 20e place du top 40 des plus grand·es méchant·es de l’histoire des séries établi par le magazine états-unien Rolling Stone. Trente ans plus tard, c’est Cersei Lannister, reine incestueuse de Game of Thrones, ou encore Amy Elliott Dunne, l’héroïne de Gone Girl, qui incarnent cette déviance au féminin.
Toutes ces anti-héroïnes ont le même profil : trompées, abusées, agressées ou tout simplement cruelles, elles passent leur temps à manipuler ou punir les hommes – sans pour autant épargner les femmes.
Des fictions qui perpétuent le mythe de la femme perverse
Entre 13 heures et 17 heures, la TNT propose donc des téléfilms états-uniens aux titres évocateurs – Une séductrice dans ma maison, Mystérieuse Mère porteuse, Une belle-mère qui me veut du mal – dont les pitchs se ressemblent cruellement. Une étudiante du Midwest se fait embaucher comme jeune fille au pair, mais se révèle une dangereuse déséquilibrée. Une femme sexy et mystérieuse séduit un veuf éploré, mais s’avère être la meurtrière de sa femme. Une vingtenaire pétillante tue la mère porteuse engagée par son collègue, dont elle est secrètement amoureuse, pour la remplacer.
L’intrigue laisse place à peu de surprises. Au cœur de « l’engrenage infernal » se trouve une femme, souvent jeune, toujours séduisante et calculatrice, dont les manœuvres ont un but très clair : attirer un homme dans ses filets ou causer son malheur. Prête à tout, elle n’hésitera pas à l’accuser d’un viol dont il est innocent pour le faire chanter, à inventer un passé traumatisant pour susciter son empathie ou à tuer quiconque se mettra en travers de son chemin. Des fictions qui, comme l’a montré par exemple l’autrice féministe Valérie Rey-Robert dans son livre Une culture du viol à la française, perpétuent l’idée que les femmes sont par nature perverses, et qu’elles mentent dans le but de nuire aux hommes.
Retour de bâton conservateur
Cette misogynie caractérisée a colonisé nos imaginaires et nos écrans, alors que la réalité est tout autre : les femmes et les filles sont les premières victimes de violences sexuelles, très majoritairement perpétrées par les hommes. Les homicides obéissent à une autre logique : c’est d’abord un crime masculin, qui fait principalement des victimes masculines.
Si la fiction est fascinée par de tels personnages féminins, c’est que l’ultraviolence des femmes, plus rare statistiquement, dément les caractéristiques qu’on leur associe traditionnellement : la douceur, la sensibilité, l’empathie, la fibre maternelle… Les femmes violentes incarnent une double transgression : de la loi et des rôles de genre. Ces dissidentes sont pathologisées, considérées comme « anormales² » et particulièrement dangereuses, puisqu’elles usent des stéréotypes de genre uniquement pour tromper des hommes convaincus de leur bonté naturelle. Et quand ce n’est pas leur ingénuité, c’est leur sex-appeal qu’elles dégainent pour piéger leur proie. La sexualité des femmes, intimement liée à la violence contre les hommes, est alors présentée comme une arme létale.
Énième avatar du retour de bâton conservateur observé à chaque avancée féministe, la criminelle désaxée abuserait donc sans remords d’une agentivité inédite pour se venger des mâles (ou des autres femmes, qui ne sont alors que des concurrentes). Ces récits, qui mettent en scène l’impensable et l’impossible, stigmatisent la liberté des femmes et leur sexualité, pour mieux conjurer la peur panique des hommes constatant leur perte de pouvoir. •
Membre du comité éditorial de La Déferlante, Nora Bouazzouni est journaliste spécialisée en culture et alimentation. Elle est également traductrice et écrivaine, autrice de Faiminisme. Quand le sexisme passe à table (2017) et Steaksisme. En finir avec le mythe de la végé et du viandard (2021), parus aux éditions Nouriturfu. Cette chronique est la deuxième d’une série de quatre sur la pop culture.
- Rappelons que la psychopathie est un trouble de la personnalité, et non une maladie mentale, qui toucherait 2 à 3 % de la population mondiale, et que, contrairement à la vision caricaturale des fictions, les personnes qui en sont atteintes ne sont pas toutes des criminelles en puissance.
- À l’inverse, de Tony Soprano (Les Sopranos) à Dexter Morgan (Dexter) en passant par Walter White (Breaking Bad), plusieurs séries normalisent la corruption morale des hommes, présentés comme des anti-héros attachants, des pères de famille aimants, qui bordent leurs enfants après avoir abattu un ennemi de sang-froid.