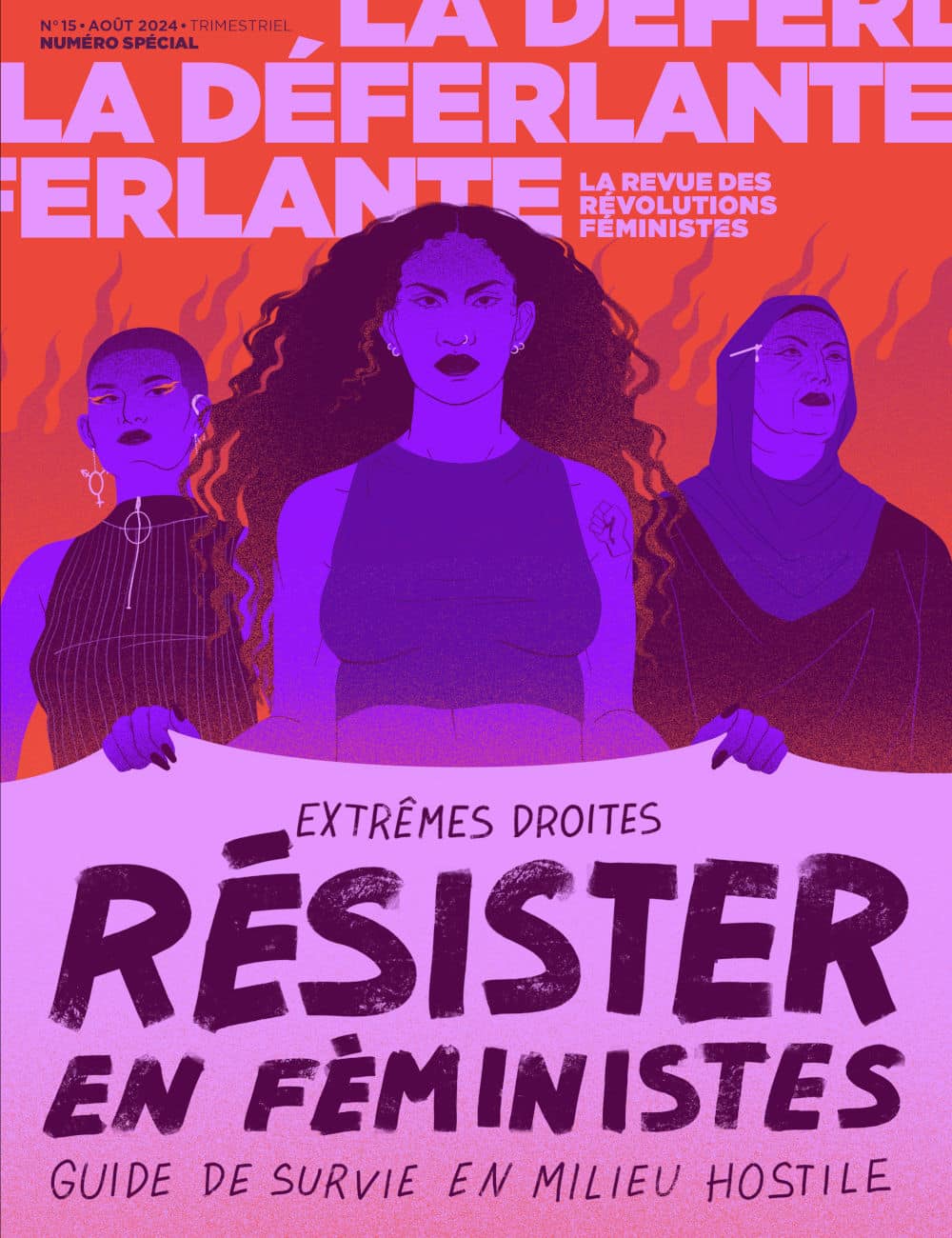« Tours et bourgs, même combat ! », scandent ce mercredi 3 juillet une cinquantaine de mères du collectif Kune : accompagnées de leurs enfants, elles défilent depuis Villejean, l’un des quartiers populaires de Rennes (Ille-et-Vilaine) jusqu’à la commune de Châteaubriant à une cinquantaine de kilomètres de là.
Derrière ce « grand déplacement », Juliette Rousseau et Régine Komokoli, deux militantes féministes, s’organisent depuis la dissolution de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron le 9 juin dernier. La première, militante de gauche depuis une vingtaine d’années, habite dans un hameau, en zone rurale. La seconde vit dans un quartier prioritaire de Rennes où elle a créé, en 2019, un collectif de femmes contre les violences conjugales. « Face à la panique, la tristesse et l’angoisse du projet fasciste, nous avons organisé cette marche, explique Régine Komokoli. Toutes les femmes du quartier avaient déjà été victimes d’agressions racistes, alors nous avions peur de nous rendre visibles, mais, foutu pour foutu, nous devions le faire pour nos enfants. » Quant à Juliette Rousseau, elle avait « envie de lancer un message concret contre la fatalité », pour sortir du « militantisme de gauche très urbain et très tourné vers les réseaux sociaux ».
C’est cette même nécessité d’action qui a fait renouer Caroline De Haas avec le militantisme de gauche, après les deux ans d’abstinence qui ont suivi l’échec de la Nouvelle union écologique et sociale (Nupes) aux élections législatives de 2022. Fin mai, la fondatrice de #NousToutes se retrouvait chez la députée Marie-Charlotte Garin (EELV) avec un groupe de militant·es pour discuter proposition de loi sur le consentement et grève féministe. La discussion s’est poursuivie les jours suivants sur un groupe WhatsApp. Au lendemain de l’annonce présidentielle, le groupe change d’objectif : la victoire contre l’extrême droite devient la priorité. Pour l’historienne du féminisme Bibia Pavard : « Oui, il y a eu priorisation des luttes ; mais même si la résistance face à l’extrême droite prime sur tout le reste, les féministes ont su se faire entendre dans cette campagne, en s’opposant notamment à la candidature d’hommes condamnés pour des violences sexuelles, ou encore en essayant d’imposer une femme [Marine Tondelier] dans le débat de l’entre-deux-tours. »
En réaction, Caroline de Haas crée avec Marylie Breuil, une autre ancienne du collectif #NousToutes, un canal Telegram très vite rejoint par près de 30 000 personnes. « On propose des actions concrètes : distribution de tracts, interpellations des candidat·es arrivé·es troisièmes au premier tour, porte-à-porte dans les circonscriptions pivots… », détaille la militante, qui a aussi créé le site Cette fois on gagne avec l’activiste écologiste et féministe Camille Étienne. Dans chacune de ces actions, les femmes sont les premières à s’impliquer : « À la dernière distribution de tracts à Montparnasse, sur les douze personnes présentes, dix étaient des femmes. »
Cibler « les pédés de droite »
La présence des féministes dans les mobilisations contre l’extrême droite n’est pas une nouveauté. « Au début des années 1930, alors qu’elles n’avaient pas encore le droit de vote, les femmes étaient très engagées dans la lutte contre le fascisme, rappelle l’historienne Bibia Pavard. Ensuite, elles ont soutenu, autant que les hommes, le Front populaire puis les républicain·es lors de la guerre d’Espagne en 1936. »
En 2024, le front féministe et LGBT+ se reforme. Léonce*, du collectif Les Inverti.e.s (réunissant « TrÅñ$ p€d€ G0UiñEs Cocommunist·e·s »), raconte : « Tous les soirs, nous tractons dans le Marais [quartier historiquement gay de Paris] pour cibler les pédés de droite. » Consciente de la bulle sociale dans laquelle elle se trouve, Apolline Bazin, cofondatrice du média culturel Manifesto XXI, développe : « L’urgence, c’est, dans un temps record, de ne pas prêcher qu’à des convaincu⸱es et d’aller au front. » Lundi et mercredi soir, elle était à Meaux, en Seine-et-Marne, pour soutenir la candidate du Nouveau Front populaire, Amal Bentounsi, face à une candidate du Rassemblement national.
« L’urgence, c’est de ne pas prêcher qu’à des convaincu⸱es et d’aller au front. »
Pour l’activiste et autrice Blanche Sabbah, « l’arrivée au pouvoir de l’extrême droite serait une catastrophe généralisée : pour les femmes, les personnes minoritaires et l’écologie. » Depuis le 9 juin, l’engagement de cette militante au sein du mouvement Action Justice Climat a donc pris un tournant : « La nouveauté, c’est de faire campagne pour un parti politique alors que je suis loin des appareils institutionnels. » Sandra*, membre du Collectif Féministe Calais, décrit elle aussi « une campagne avec beaucoup de personnes qui, comme moi, n’étaient encartées dans aucun parti politique auparavant. » Ce regain militant ne vaut pas que pour les partis traditionnels : il est perceptible dans l’ensemble des mouvements militants. Léonce, du collectif Les Inverti·es, abonde : « Ces trois dernières semaines, cinquante personnes ont rejoint nos rangs. »
À gauche tous·tes
Sur le terrain et les réseaux sociaux, les modes d’organisation reprennent des actions traditionnellement féministes. Tandis qu’à Paris les collages contre le Rassemblement national (RN) fleurissent sur les murs, à Tourcoing (Nord), ce sont les pochoirs qui habillent désormais les trottoirs, à l’initiative de la Brigade du respect. Ce collectif, originaire de Lille, lutte depuis 2019 contre le harcèlement de rue, mais « face à l’urgence de la situation, on se devait de s’exprimer, raconte Salomé*, avant de préciser : Je suis dans un tel niveau de nerfs que je suis incapable de tracter et de me retrouver face à une personne raciste. Avec la Brigade, on agit la nuit, sans personne autour. Ce n’est que le lendemain matin que les personnes voient nos messages. » Non loin, à Calais, au lieu de coller des feuilles blanches recouvertes de lettres noires contre le patriarcat comme elle le fait d’habitude, Céline* appose sur les murs les affiches du candidat Nouveau Front populaire.
En trois semaines de campagne, féministes, antiracistes et queers ont convergé dans une lutte commune à gauche contre l’extrême droite. Calais a accueilli une déambulation politique et citoyenne en défense des personnes exilées, queers et palestiniennes. Pour Léonce, des Inverti·es, « le consensus se crée plus facilement, nous n’avons plus le temps de débattre ».
« À gauche tous·tes », « No pasarán » ou « Président du chaos, joue pas avec nos vies », peut-on lire depuis le 9 juin sur les trottoirs de Tourcoing et Lille. Salomé, de la Brigade du respect, soutient : « Nos pochoirs sont faits avec de la bombe de peinture qui dure six mois au sol. Nous resterons présentes après les résultats de dimanche. » Tous et toutes l’affirment : quelle que soit l’issue du scrutin dimanche soir, la résistance féministe, queer, antiraciste n’en est qu’à ses débuts.
* Ces personnes n’ont pas souhaité mentionner leur nom de famille.