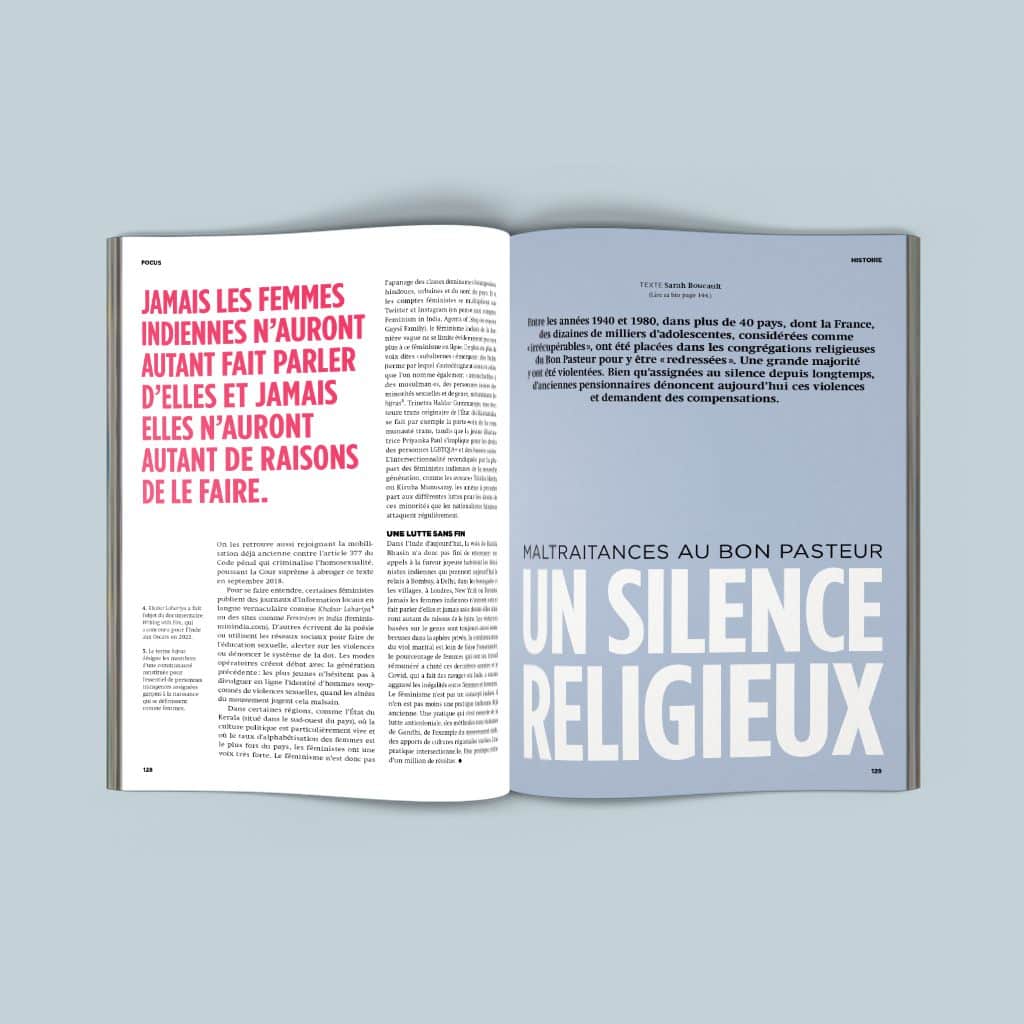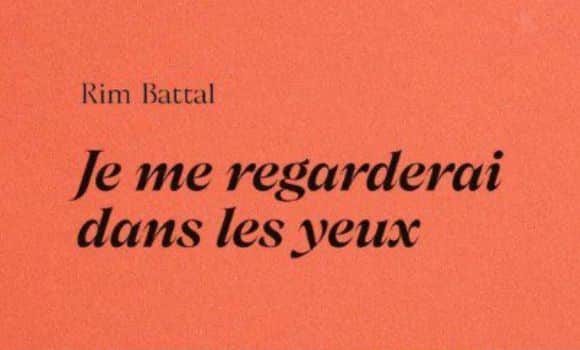Elles sont deux. Éveline Le Bris et Marie-Christine Vennat portent fièrement leurs revendications. La présidente et la trésorière de l’association Les Filles du Bon Pasteur apparaissent régulièrement dans les médias pour raconter leur parcours d’adolescentes cassées.
Les autres se risquent à des témoignages timides, ne parlent pas, répondent partiellement, se rétractent. Ont peur. Peur des répercussions sociales du stigmate de la « mauvaise fille », encore fortement ancré dans leur chair et dans l’imaginaire collectif. Peur de soulever la chape de plomb sous laquelle elles ont enfoui ces années noires.
Après deux heures de confidences à cœur ouvert, Nicole 1Le prénom a été modifié., 72 ans, nous a envoyé ce message : « Je suis désolée, mais ma fille ne veut pas que je parle de ce passé sinon elle se fâche. Mon fils est de son avis. Donc c’est avec regret que je vous demande de stopper, car je ne veux pas me fâcher avec mes enfants. » Nicole a un parcours « classique » : doublement violée, elle tombe enceinte à 14 ans avant d’être placée au Bon Pasteur. Elle y connaîtra le viol médical et les insultes des religieuses. Les femmes passées au Bon Pasteur jusque dans les années 1970 cumulent les injonctions au silence. Elles sont écrasées par la honte, envahies par la culpabilité et parfois victimes d’amnésie traumatique. Au plus fort de son activité, le forum des anciennes (créé en 2009) a regroupé 800 membres (aujourd’hui, elles sont environ 500). L’historien David Niget, spécialiste de la justice des mineur·es, estime entre 35 000 et 40 000 le nombre d’adolescentes françaises placées dans ces institutions entre 1940 et 1980. Environ 80 % y auraient subi des violences. Nombre d’entre elles sont décédées depuis, mais elles sont encore des milliers, meurtries et humiliées, susceptibles de demander réparation. « Nous n’avons reçu ni éducation, ni salaire pour le travail effectué, ni soins de santé », plaide Éveline Le Bris, enfermée au Bon Pasteur du Mans et coupée de sa famille entre 1963 et 1966, après avoir été violée par un voisin à l’âge de 11 ans. La présidente de l’association elle-même s’est tue pendant des décennies, avant de pouvoir raconter son histoire à voix haute.
Paternalisme judiciaire et « redressement genré »
Fondée en 1835 à Angers (Maine-et-Loire), la congrégation du Bon Pasteur se donne pour mission de « sauver » les jeunes filles de la « déchéance ». Autour des années 1940, au pic de son activité, 10 000 religieuses et 50 000 jeunes filles vivent dans 350 congrégations du Bon Pasteur réparties dans 40 pays. En France, des milliers d’adolescentes défavorisées y sont placées dans les années 1950 et 1960 par des juges pour enfants, consécutivement à l’ordonnance de 1945, qui leur donne le droit de décider de leur enfermement, jusque-là réservé au père de famille, avec l’argument de la protection (lire la chronologie). Contrairement aux filles des classes aisées, cloîtrées dans la sphère domestique, les filles des classes populaires grandissent dans un environnement plus libre, une menace dont il faudrait les « sauver ».
À l’époque, les défaillances morales des adolescentes inquiètent plus que les actes illégaux. Dans un ouvrage . 2Véronique Blanchard, Vagabondes, voleuses, vicieuses. Adolescentes sous contrôle de la Libération à la libération sexuelle, éditions François Bourin, 2019 consacré à la criminalisation des adolescentes dans les années 1950 et 1960, l’historienne Véronique Blanchard pointe ce « paternalisme judiciaire […] : des femmes peuvent être enfermées pour des faits non criminalisés, qui n’entraînent dans le cas des garçons aucune sanction. Ainsi, 64 % des filles sont placées pour des faits non pénaux, contre 5 % des garçons. » Si certaines ont fugué, commis des petits larcins, sont suspectées d’avoir de mauvaises fréquentations ou une sexualité précoce, beaucoup de ces jeunes filles placées ont aussi été victimes d’inceste ou d’agressions sexuelles et sont considérées comme fautives.
À l’intérieur de la congrégation, la vie est monacale, comme si les jeunes femmes avaient fait vœu de célibat et de chasteté. À l’entrée, le viol gynécologique, destiné à connaître leur statut virginal, est la norme. En cas de fugue, les cheveux sont rasés ; les corvées de ménage se font à genoux ; on leur met les draps sur la tête lorsqu’elles urinent au lit.
La discipline religieuse est très forte : messe obligatoire, culture de la mortification, silence toute la journée. Interdiction de parler du passé et de sa vie privée sous peine de punition. « La culpabilisation est permanente. Elles sont effacées en tant que sujets », explique David Niget. Cet effacement peut être très concret : certaines pensionnaires sont rebaptisées à leur entrée et ne retrouvent leur vrai prénom que des années plus tard. À la violence physique et psychologique s’ajoute l’incompréhension. Elles ne savent pas ce dont on les accuse. « Quand j’ai été enfermée, je n’ai rien compris, le ciel s’est abattu sur ma tête. En psychiatrie, on appelle ça la sidération, raconte Marie-Christine Vennat. Je n’étais pas une adolescente facile, je tirais les cordons de sonnette, je chipais des pommes. Mais pas de quoi fouetter un chat. »
« Elles se sont murées dans le silence pour pouvoir se marier, fonder une famille. Pour être crédible, il faut oublier, sinon, c’est insupportable. »
David Niget, historien
Quand elles sortent, le manque à gagner social est considérable : sous-qualifiées et marquées au fer rouge par la honte associée à l’institution, elles font table rase du passé. Aujourd’hui encore, beaucoup n’en ont jamais parlé à leur mari, leurs enfants, leur famille. « Elles craignent d’être rejetées par leurs proches et d’être renvoyées aux stigmates qui marquent les expériences carcérales ou assimilées », éclaire Hanan Sfalti, anthropologue, autrice du mémoire « Réformées au Bon Pasteur : comportements, morale et sentiments de femmes déviantes des classes populaires ». « Elles se sont murées dans le silence pour cacher leurs origines, pouvoir se marier, fonder une famille, renchérit David Niget. Elles ont dû mentir et se mentir à elles-mêmes. Pour être crédible, il faut oublier, sinon c’est insupportable. »
C’est parce qu’elle connaît le prix de la parole que Marie-Christine Vennat a été choquée de voir des photos de femmes non anonymisées lors de l’exposition « Mauvaises filles » en 2016, au théâtre du Quai à Angers : « C’est une honte, une fille peut reconnaître sa mère, sa tante, sa grand-mère. Elle peut être en colère de ne pas savoir ou de penser que sa mère était une mauvaise fille. Pour moi, cette exposition montre qu’on est toujours pointées du doigt. » Beaucoup d’entre elles ne voient pas l’intérêt de parler, à l’image de Patricia, cloîtrée à Pau de 1969 à 1973 : « Je n’ai jamais compris pourquoi on veut se souvenir de ça, les générations futures n’ont pas besoin de savoir, ça remue la merde et ça sent mauvais. Parler ne me soulage pas. » De même, la chanteuse Nicoletta, ancienne pensionnaire, n’a quasiment plus parlé du sujet après la sortie de son livre, La Maison d’en face (éditions Florent Massot, 2008), où elle raconte ses années au Bon Pasteur.
Le lourd retard français
Si les maltraitances dans les couvents du Bon Pasteur ont eu lieu dans les 40 pays où la congrégation était présente, les excuses, elles, ne sont pas aussi homogènes. Certains pays ont entamé des démarches de dédommagement depuis plusieurs décennies. En Australie, une dizaine d’enquêtes parlementaires ont été menées pour faire la lumière sur les maltraitances des sœurs, et le site de la congrégation nationale affiche ce message : « Des années 1860 aux années 1970, de jeunes personnes ont été négligées ou abusées. Nous reconnaissons la douleur […] et nous nous excusons. »
Le Canada a engagé des moyens considérables pour faire reconnaître les violences institutionnelles à l’égard des enfants ; tout comme en Irlande, où le scandale de la congrégation des Magdalene Sisters, voisine du Bon Pasteur, a été fortement médiatisé. En 2018, des Irlandaises victimes de violences ont obtenu jusqu’à 20 000 euros chacune. Aux Pays-Bas, un rapport universitaire, commandé par le gouvernement, a conclu au travail forcé et à la responsabilité de l’État, qui s’est excusé. Fin 2020, 140 femmes ont été dédommagées à hauteur de 5 000 euros chacune, au terme de trois ans de combat.
En France, ni enquêtes ni excuses officielles. « La France, comme la Belgique ou l’Espagne, n’a jamais cherché à enquêter, contrairement aux pays de droit britannique où le Parlement a plus de capacité à s’autosaisir, constate l’historien David Niget. La France, grande puissance colonisatrice, a tellement de casseroles historiques dans la longue liste des dossiers à rouvrir, que le Bon Pasteur arrive loin. »
Déni de la congrégation malgré de timides excuses
Quand elles consentent à se souvenir, les anciennes pensionnaires en disent d’abord très peu. Entre allusions et sous-entendus, les maltraitances mineures refont surface. Puis, celles qui se livrent (re)découvrent leur histoire avec stupeur – et horreur parfois – en discutant avec des chercheur·ses et des journalistes. « Récemment, une fille nous a raconté qu’on l’avait mise à quatre pattes et qu’on lui avait introduit des objets dans le vagin, raconte Marie-Christine Vennat. C’est très courageux de nous l’avoir raconté. Moi j’ai pris conscience que j’avais été violée par le médecin du Bon Pasteur il y a quelques années seulement. »
L’attitude actuelle de la congrégation française contribue à renforcer l’invisibilisation et la chape de plomb. Malgré de timides excuses 3« Là où l’objectif était de retrouver la joie de vivre et la dignité personnelle, nous reconnaissons que des comportements inadaptés sont parfois venus ternir des intentions louables. Je le regrette et demande pardon pour ces attitudes qui ont provoqué incompréhension et souffrance. » Patricia Diet, citée par Vincent Boucault, « Angers : d’anciennes pensionnaires du Bon Pasteur victimes de maltraitance », Le Courrier de l’Ouest, 25 novembre 2019. de la supérieure provinciale Patricia Diet, dans le quotidien régional Le Courrier de l’Ouest en 2019, « les sœurs continuent, collectivement et politiquement, d’être convaincues que ce qu’elles ont fait était pour le bien des jeunes filles, “pour les sauver” », affirme David Niget. Or, s’il y a bien des exceptions, la maltraitance règne dans presque toutes les congrégations jusqu’aux années 1970.
Cette réalité est totalement rejetée par l’équipe de la congrégation. Plusieurs semaines après que nous l’avons sollicitée pour une interview, sœur Marie-Paule Richard, l’une des cinq membres de la direction du Bon Pasteur de la Province (France, Pays-Bas, Belgique et Hongrie), a bien voulu répondre à nos questions. « Dans des maisons où il y avait cent filles révoltées, avec deux ou trois religieuses, ces dernières ont été dépassées et certaines ont dépassé les bornes, reconnaît-elle lors d’un entretien téléphonique. Mais ce n’est pas juste de dire que toutes les filles ont été maltraitées. Il n’y a jamais eu de système de répression ou d’exploitation voulu. Je suis ferme là-dessus, je ne supporte pas qu’on dise que c’est général. »
Si sœur Marie-Paule Richard assure qu’une « cellule d’écoute pour recueillir la parole et tendre la main aux femmes qui auraient envie de parler » va être mise en place, elle rejette en revanche toute idée d’indemnisation : « Nous pensons que leur donner une somme d’argent ne va pas les guérir. Toutes les sœurs n’ont pas été comme ça, alors demander pardon pour la congrégation tout entière, ce n’est pas cohérent. »
« Moi j’ai pris conscience que j’avais été violée par le médecin du Bon Pasteur il y a quelques années seulement. »
Marie-Christine Vennat
Dans d’autres pays, comme l’Australie, la congrégation a pourtant fait le choix de s’excuser. Et des enquêtes parlementaires ont été menées en Australie, au Canada, aux Pays-Bas, qui ont abouti à des excuses et des indemnisations de victimes. « En France, c’est de la responsabilité de l’État de conduire une enquête », estime David Niget.
Après des décennies de sourdine, la parole se libère lentement. Certaines sont parvenues à récupérer leur dossier et ont pu mieux comprendre les raisons de leur placement. Souvent, elles ont cru que leur famille les avait abandonnées et elles s’aperçoivent que les sœurs leur ont sciemment caché les lettres de leurs parents. Et le soulagement fait place à la colère quand, sans y être préparées, elles découvrent les commentaires malveillants, voire haineux, des religieuses à leur propos. « Les termes employés ne pourraient plus s’employer aujourd’hui, admet sœur Marie-Paule Richard. Quand on disait qu’une fille était un peu débile, paresseuse, c’était à proprement parler du jugement. Mais il faut remettre dans le contexte, il y a soixante ans, on ne considérait pas du tout les enfants comme on les considère aujourd’hui. Dans n’importe quelle institution, des choses répréhensibles ont été faites, on n’est pas les seules. »
La gestion des archives de la congrégation laisse penser qu’elles ne sont pas si sûres de leur bon droit. Dans les années 1990 et 2000, 8 000 dossiers ont été partiellement détruits. Incompétence ou intention malveillante ? « Je pense que, à un moment ou un autre, ces archives ont été considérées comme problématiques, estime l’historien David Niget. Mais je ne suis pas capable d’établir la preuve de leur destruction. »
Les religieuses exercent un contrôle drastique sur ces archives. Alors que la loi les oblige à les rendre accessibles, elles ont pratiqué la rétention jusqu’en 2020, freinant la remise de dossiers à d’anciennes pensionnaires et refusant l’accès à la plupart des chercheur·euses et des journalistes. Il existe une quantité énorme d’archives, rigoureusement tenues par les sœurs. Les archives départementales sont censées garantir leur ouverture mais n’ont pas la place de les accueillir et ferme les yeux sur cette politique de rétention. Les Filles du Bon Pasteur ne comptent pas en rester là.
« Nous voulons une réhabilitation morale pour l’ensemble des filles, un pardon franc et honnête et un dédommagement pour le travail et la maltraitance », revendique Éveline Le Bris. « Nous allons faire pression via notre avocat et la presse, renchérit Marie-Christine Vennat. Tout le monde saura ce que les sœurs ont fait dans les années 1960 et bien avant. » •
Filles « incorrigibles » : plus d’un siècle
de « correction » patriarcale et religieuse
1835
Sœur Marie-Euphrasie Pelletier crée la congrégation des sœurs de Notre-Dame-de-Charité-du-Bon-Pasteur, à Angers, pour éduquer les jeunes filles des classes populaires jugées « incorrigibles ».
1945
Réforme de la justice des mineur·es. Le Code civil de 1804 permettait au père de famille de placer ses enfants indiscipliné·es dans des maisons de correction (dont le Bon Pasteur). Cette prérogative est transférée au juge pour enfants qui décide seul de l’enfermement sans besoin de prouver qu’il y a eu délit.
1958
Ordonnance sur « l’enfance en danger » : le magistrat peut dorénavant prendre des mesures de protection des mineur·es qu’il juge vulnérables. Les placements des filles, considérées comme plus fragiles que les garçons, explosent.
2019
Premières excuses de la congrégation française dans Le Courrier de l’Ouest.