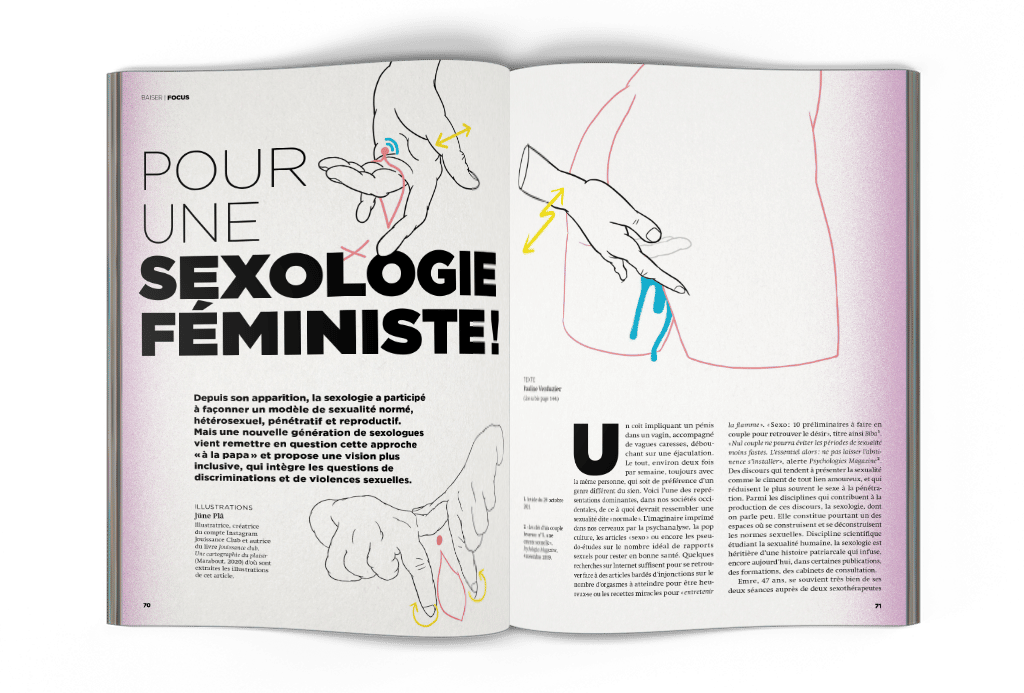Ce n’est pas tous les jours qu’une militante féministe peut savourer sa victoire. Anita Sarkeesian s’est accordé ce plaisir en mars 2022, à la Game Developers Conference (GDC), un évènement dédié aux professionnel·les du jeu vidéo à San Francisco.
« J’ai longtemps été le cauchemar de certains gamers : je représentais un nouveau monde, celui où les développeurs n’étaient plus libres, c’est-à-dire qu’on leur demandait de raconter des histoires où les femmes étaient des personnes humaines », a affirmé non sans ironie la blogueuse américano-canadienne, qui s’est fait connaître en dénonçant la misogynie dans la pop culture. Dix ans plus tôt, en 2012, Anita Sarkeesian lançait un appel aux dons pour financer une série de vidéos : Tropes vs Women in Video Games (littéralement : « les clichés contre les femmes dans les jeux vidéo »). Son but était d’analyser les stéréotypes sexistes qui collent à la peau des héroïnes virtuelles, souvent réduites à des objets de désir pour les joueurs hétérosexuels.
Très vite, Anita Sarkeesian reçoit des insultes sur les réseaux sociaux ; elle est même menacée d’un attentat à la bombe. Cette violence participe à la médiatisation de la campagne de financement participatif, qui finit par récolter près de 160 000 dollars, soit 26 fois le montant initialement visé. Anita Sarkeesian réalisera vingt vidéos au total, diffusées sur YouTube entre 2013 et 2017. Elle a contribué à visibiliser la question des représentations des femmes dans les jeux vidéo et elle est devenue l’une des figures de proue de la révolution féministe qui secoue ce milieu depuis dix ans. « Finalement, leurs craintes se sont réalisées. Nous avons gagné », c’est avec ces mots que la vidéaste concluait son discours.
En 2014, le tournant du Gamergate
Plus de la moitié de la population française joue au moins une fois par semaine aux jeux vidéo. 47 % sont des femmes1« Les Français et le jeu vidéo », étude réalisée par SELL/ Mediamétrie auprès d’un échantillon de 4 016 internautes âgé·es de 10 ans et plus, novembre 2021.. Pourtant, dans l’imaginaire collectif, les jeux vidéo ont longtemps été la chasse gardée des hommes. La France a connu une affaire similaire à celle d’Anita Sarkeesian. Après la publication, entre 2012 et 2013, sur le blog Genre ! créé par Anne-Charlotte Husson de deux articles traitant de l’apologie du viol et du sexisme dans la presse vidéoludique et les milieux geek, la développeuse française Mar Lard a été harcelée, subissant pendant de longs mois un torrent d’insultes, des menaces de mort et de viol.
C’est en 2014 que ce type de violence misogyne a atteint son apogée, avec l’affaire dite du « Gamergate ». Une développeuse indépendante américaine, Zoë Quinn, se retrouve au cœur d’un ouragan de haine. En cause, un ex-petit ami qui l’accuse via un article de blog d’avoir eu une relation avec un journaliste spécialisé dans les jeux vidéo. Des gamers orchestrent alors une campagne de harcèlement contre Zoë Quinn et de nombreuses personnalités féminines du milieu – parmi lesquelles Anita Sarkeesian et la militante féministe et créatrice de jeux vidéo Brianna Wu –, sous couvert de dénoncer de supposées connivences entre la presse vidéoludique et l’industrie. Il s’agit évidemment d’un prétexte : ce qui déclenche l’affaire, c’est bien que Zoë Quinn est une femme et qu’elle utilise le jeu vidéo pour mettre en scène des personnages et des expériences différentes de celles généralement proposées.
L’une de ses premières œuvres, Depression Quest (2013), qui met le joueur ou la joueuse dans la peau d’une personne dépressive, avait d’ailleurs attiré les foudres de certains gamers quelques mois plus tôt. Développeuses, journalistes ou simples joueuses, toutes deviennent des cibles potentielles, surtout si elles expriment des opinions féministes en ligne. Certaines victimes perdent leur emploi, d’autres doivent déménager face à l’intensité des menaces.
Si l’affaire démarre pendant l’été 2014 – d’abord sur des forums spécialisés, comme Reddit ou 4chan, puis un peu partout sur le web –, elle aura finalement des répercussions pendant plusieurs années. Le Gamergate fera même office de laboratoire pour des techniques de manipulation et de harcèlement en ligne utilisées par l’extrême droite américaine, notamment par des partisan·es de Donald Trump, élu président des États-Unis deux ans plus tard, en 2016.
« On savait déjà que la communauté des gamers était réac et misogyne. Avec le Gamergate, on a réalisé qu’elle était aussi dangereuse », se souvient Erwan Cario, journaliste à Libération, spécialiste des jeux vidéo. Zoë Quinn portera d’abord plainte contre son ex-compagnon pour harcèlement, avant de la retirer en 2016, fatiguée des attaques incessantes et de la mauvaise gestion de cette affaire par la police et la justice.
Les jeux vidéo, un marqueur de virilité
Aux racines de cette violence, on retrouve un phénomène bien particulier : le gatekeeping, soit le contrôle de l’entrée de nouvelles et nouveaux venu·es dans une communauté. Dans le cas des jeux vidéo, il s’exprime notamment au travers de pratiques comme le harcèlement des joueuses sur les réseaux sociaux, ou les remarques sexistes qui pullulent dans les chats écrits et vocaux de jeux en ligne.
« Les jeux vidéo sont une industrie culturelle très jeune, par rapport au cinéma par exemple. Son évolution doit être replacée dans l’histoire de l’informatique, d’où les femmes ont été exclues », explique Esteban Giner, doctorant au Centre de recherche sur les médiations (Crem) de l’université de Lorraine. Au début de leur commercialisation, dans les années 1970, les jeux vidéo étaient considérés comme une pratique non genrée. Assez vite, le marketing a associé leur usage aux garçons, avec des références à des intérêts dits « masculins » : les aventures, la guerre, le sport, etc. « Contrairement à d’autres milieux culturels, les jeux vidéo ont fait l’objet d’une forte construction identitaire. Notamment parce que les gamers étaient la cible d’attaques de la part des milieux conservateurs, religieux… Les jeux vidéo sont alors devenus un marqueur d’appartenance très fort pour certains hommes. »
« Les jeux vidéo sont considérés comme un loisir improductif. Or, on attend plutôt des femmes qu’elles se consacrent à des choses utiles. »
Esteban Giner
Dans ce contexte, toute personne perçue comme différente est traitée avec méfiance, voire violence. Les joueuses sont forcément des intruses. On remet en doute leur passion, on moque leurs talents, on méprise les types de jeux considérés comme « féminins » : ceux pour mobile, les jeux de romance, de simulation dela vie, etc.
« Quand on dit à quelqu’un qu’il joue comme une fille, c’est une insulte. On l’accuse d’être mauvais et de ne pas être marrant », résumait Shira Chess, chercheuse états-unienne à l’université de Géorgie, dans un essai au titre évocateur : Play Like a Feminist 2Shira Chess, Play Like a Feminist, The Mit Press, 2020 (non traduit en français).. Logique, donc, que beaucoup de femmes ne se considèrent pas comme gameuses, alors qu’elles jouent régulièrement aux jeux vidéo. « Les jeux vidéo sont généralement considérés comme un loisir improductif. Or, on attend plutôt des femmes qu’elles se consacrent à des choses utiles », ajoute Esteban Giner.
À peine 22 % de femmes dans Les studios de jeux vidéo
Malgré la pratique encore vivace du gatekeeping, qui continue à influencer la communauté du gaming aujourd’hui, le Gamergate a agi comme un électrochoc. Plusieurs géants du secteur – mais aussi des entreprises plus petites – ont vu leurs dysfonctionnements internes s’étaler dans la presse.
En 2020, Libération et Numerama révèlent plusieurs cas de harcèlement et d’agressions sexuelles au sein d’Ubisoft, fleuron français du jeu vidéo. En 2021, c’est le studio californien Activision Blizzard, créateur du blockbuster Call of Duty, qui est accusé d’avoir institutionnalisé une « culture de fraternité masculine » au détriment de ses employées, de ne pas avoir sanctionné des faits de harcèlement sexuel et d’avoir eu des pratiques discriminatoires, en particulier à l’égard des employées enceintes ou non blanches.
Les initiatives pour plus de diversité dans les jeux comme chez les professionnel·les du secteur se sont multipliées partout dans le monde. C’est ainsi que l’association Women in Games France, un réseau de professionnelles lancé en 2017, ou les collectifs Afrogameuses et Stream’Her militent respectivement pour une meilleure visibilité des femmes afrodescendantes et des streameuses dans le jeu vidéo. « Pour moi, le gros changement, c’est que notre association bénéficie d’une très bonne image dans l’industrie », note Morgane Falaize, présidente de Women in Games France. Les progrès sont particulièrement visibles sur le sujet des représentations dans les jeux vidéo. On retrouve désormais des héroïnes à la tête des intrigues à gros budget, comme dans The Last Of Us II (2020) qui met en scène une jeune femme lesbienne, ou Horizon : Zero Dawn (2017) dont le personnage principal est une guerrière dans un monde postapocalyptique. « On est passés d’une industrie qui refusait de mettre des femmes dans ses jeux, sauf à les sexualiser, à des titres grand public portés par des personnages féminins, explique Erwan Cario. Si l’industrie ose enfin mettre des femmes en avant, c’est aussi parce qu’elle considère que la population des gamers s’est diversifiée, et que davantage de femmes sont impliquées dans la création des jeux. »
Néanmoins, cette révolution inclusive a un revers : le marketing de la diversité. Les studios ont compris que s’engager publiquement pour l’égalité des sexes ou mettre un personnage féminin sur la jaquette d’un jeu vidéo pouvait attirer l’attention des médias. Cela crée parfois une sorte de dissonance avec la réalité des professionnelles et des joueuses, dont la situation ne s’est pas forcément améliorée entretemps.
« “Notre équipe de cinq cents mecs blancs hétéros a embauché temporairement deux consultant·es en diversité pour produire un jeu sur une héroïne noire et lesbienne”, voilà le genre de trucs qu’on applaudit dans notre industrie », tweetait en 2021 Maddy Myers, journaliste pour le site américain de jeux vidéo Polygon, alors que le scandale Activision Blizzard battait son plein. En France, les studios de jeux vidéo comptent en moyenne 22 % de femmes dans leurs effectifs. Un chiffre en hausse, mais qui reste loin de la parité. « Nous ne voulons pas nous associer à des projets que l’on estime être du pinkwashing 3Mot-valise, formé sur le modèle de greenwashing (« écoblanchiment »), qui désigne le fait, pour une institution, un parti politique ou une entreprise, de se donner une image progressiste, engagée pour l’égalité femmes-hommes ou les droits LGBT+.. Et à ce niveau, il y en a qu’on voit venir de très loin », détaille Morgane Falaize, de Women in Games France. « Certaines entreprises considèrent encore que parler féminisme ou harcèlement sexuel, c’est de l’ingérence. »
Une plus grande liberté de ton chez les indépendant·es
S’ajoute à cela le harcèlement que subissent encore aujourd’hui les joueuses, comme des échos tenaces au Gamergate. Twitch, une plateforme appartenant à Amazon sur laquelle on se filme en direct en train de jouer aux jeux vidéo, est un bon exemple. Les femmes y sont en ultra-minorité et subissent des attaques constantes sur leur physique et sur les contenus qu’elles diffusent. Début 2022, dans une enquête sur le cyberharcèlement «4 Cyberviolence et cyberharcèlement : état des lieux d’un phénomène répandu ». Cette étude, réalisée du 2 au 4 novembre 2021 auprès de 1 008 Français·es, avait été commandée par l’association Féministes contre le cyberharcèlement., l’institut de sondage Ipsos pointait du doigt les trois pires plateformes du web en termes d’actes de violence : Twitch, Discord et Steam, trois sites très populaires dans le milieu du gaming.
Certaines professionnelles du jeu vidéo expriment enfin leur frustration d’être sans cesse réduites à leur genre, même lorsqu’il s’agit d’être valorisées. « On me demande souvent ce que ça fait d’être une femme dans les jeux vidéo, et j’ai envie de leur dire : ça fait quoi d’être une femme dans la société ? On devrait avoir passé ce stade », analyse Miryam Houali, cofondatrice du studio indépendant Accidental Queens.
L’entreprise lilloise est connue pour sa série A Normal Lost Phone, dans laquelle le joueur ou la joueuse se retrouve en possession d’un téléphone perdu, qu’il ou elle doit explorer pour comprendre le destin de son ex-propriétaire, abordant avec justesse des sujets comme la transidentité ou les relations abusives. Le secteur des jeux vidéo indépendants, où les développeur·euses disposent traditionnellement d’une plus grande liberté de ton par rapport aux studios mainstream, propose depuis longtemps des scénarios diversifiés.
Parmi les œuvres marquantes de ces dernières années, on trouve Life is Strange (2015), sur la relation tumultueuse de deux anciennes amies, Celeste (2018), avec l’ascension d’une montagne comme métaphore de la santé mentale et de l’acceptation de soi, ou Hades (2020), une réinterprétation de la mythologie grecque sur fond de drague – toutes sexualités confondues – et de traumas familiaux. « C’est frustrant de ne parler que des choses difficiles, alors qu’il y a aussi des progrès qui méritent d’être célébrés. On n’en est plus au stade où l’on veut mettre un pied dans la porte. On est dans ton salon, et on est bien installées ! », s’amuse Diane Landais, une autre cofondatrice d’Accidental Queens. « Je ne pense pas que les jeux vidéo vont changer toute la société, car certains obstacles que l’on rencontre sont systémiques. Mais ils peuvent ouvrir la marche, si on leur laisse le temps. » •