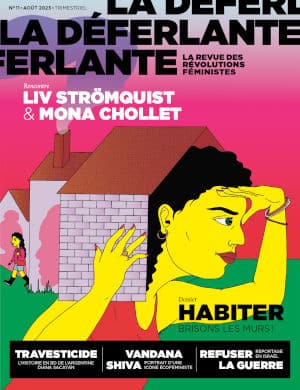« Je viens du sud de la France, de la classe moyenne. Mes parents étaient fonctionnaires. J’étais bonne à l’école. Après une prépa, je me suis retrouvée en école d’ingénieur·es, dans le monde de la bourgeoisie parisienne. Je dormais dans une sorte de cité universitaire. Au bout d’un an, j’ai fait une grosse dépression.
Un jour, un pote m’a donné rendez-vous dans un atelier de vélo autogéré. C’était dans un squat, avec une super ambiance, un peu foutraque. J’avais 24 ans, j’essayais de me reconstruire, je cherchais un local pour une cantine collective.J’avais plutôt dans l’idée de me mettre en coloc’ avec deux amies, mais finalement ça a capoté et j’ai commencé à vivre dans ce squat. J’étais d’abord hébergée, puis habitante (1). Il y avait une douzaine de personnes, c’était comme une famille choisie, on faisait des trucs en bande. Pendant plusieurs semaines, j’ai d’abord dormi dans une cabine de douche avec mes affaires suspendues au-dessus de moi dans des sacs plastiques, puis j’ai bougé de chambre en chambre. C’était un endroit incroyable, avec une verrière, un jardin super. On mettait des cloisons, des mezzanines, c’était fait de bric et de broc.
Au début je n’étais qu’émerveillement pour ce mode de vie. Aux yeux des gens étrangers au milieu du squat, je devenais la meuf bizarre, “l’anarchiste de service”.J’avais beaucoup d’œillères. Un des gros enjeux des squats, c’est le rapport au ménage et à la propreté. En vérité, on y reproduit à mort ce qui se joue à l’extérieur. Tenir les espaces propres, faire les lessives, transmettre les infos, faire les visites du squat, la gestion des stocks de nourriture, c’est souvent les meufs. L’ouverture du squat, les “ouvreurs (2)”, c’est plutôt les mecs. La répartition est carrément archétypale : les travaux massifs pour les mecs (gros œuvre, cloisons, électricité, réparations en tous genres…), mais aussi tout ce qui a trait à la police, à la technique et à ce qui semble risqué. Les baluchons, la bouffe, les choses pratiques, c’est pour les femmes. Tout le monde est indispensable, mais ce sont surtout les hommes qui vont y trouver une valorisation sociale.
Lire aussi : Témoignage de Cristal Chardonnay, drag queen à Lille
Quant aux assemblées générales, ce sont toujours les mêmes qui s’y font entendre, ceux qui ont des grandes gueules. C’est un milieu qui se veut cool, ça vient parfois légitimer la drague ou le harcèlement. J’ai connu des femmes traquées par leurs cohabitants. Et ça aussi, la question des médiations, des conflits interpersonnels, c’est géré par des meufs… Dans mes premiers squats, on ne réfléchissait pas vraiment aux dominations systémiques. Moi je me disais juste : “C’est moins pire qu’ailleurs, ça va.” Je me contentais de tout ça. J’avais pas envie d’incarner la râleuse.
« Dans un squat, on reproduit ce qui se joue à l’extérieur. Tenir les espaces propres, faire les lessives, transmettre les infos, faire les visites du squat, la gestion des stocks de nourriture, c’est souvent les meufs. »
Ensuite j’ai vécu dans un squat d’une cinquantaine de personnes. Là, les meufs étaient plus politisées, il y avait plus de clivages. Les mecs étaient agacés par l’idée de non-mixité. Pour les réunions, OK, mais pour les événements, pas question ! J’ai fini par en partir. Cela dit, un lieu de vie non mixte, c’était pas vraiment un besoin pour moi. J’avais plutôt envie de créer des espaces non mixtes au sein de squats mixtes. J’avais de l’énergie pour ça, pour permettre à des personnes très différentes de cohabiter. C’est un milieu où il faut apprendre à lâcher sur des choses, notamment l’hygiène, l’intimité. Je trouvais un sens politique à tout ça. C’est valorisant de mettre des espaces à disposition des luttes. Je me disais que j’avais déjà suffisamment de privilèges, que je pouvais bien m’asseoir sur un peu de confort.
Mon expérience la plus marquante c’était en 2015, pendant la COP 21, on avait ouvert un bâtiment pour accueillir les activistes, on en hébergeait une centaine. Ma prise de conscience s’est accélérée à ce moment-là, j’ai vraiment perçu la répression dont les militantes et les militants étaient victimes, et leurs capacités d’autoorganisation. Le dernier squat où j’ai vécu faisait, lui, plusieurs milliers de mètres carrés. Là, il y avait des familles, des sans-papiers, des événements non mixtes et/ou queer. Le planning de ménage était mieux respecté, beaucoup de formalisme dans “qui fait quoi”. Donc des conditions d’accueil plus sécurisantes. Depuis deux ans, je ne suis plus dans ce milieu. Je vis désormais dans une ferme collective à la campagne. Le squat, c’est la vie dans l’urgence, l’imprévisible. Et puis, tu revis les mêmes choses plusieurs fois, de façon assez rapprochée. Je n’avais pas envie d’être la vieille conne qui rabâche son expérience, que “c’était mieux avant”. Dans le fond, je suis partie à un moment où je me sentais enfin légitime.»
Le prénom a été modifié.
Propos recueillis par Elsa Gambin, journaliste indépendante, le 10 mars 2023, par téléphone.
(1) Le milieu du squat distingue les personnes «hébergées » dans le squat –il n’est pas prévu qu’elles y restent– de celles qui y «habitent».
(2) Il s’agit, littéralement, d’ouvrir le lieu, puis de le réapprovisionner en eau et/ou en électricité.