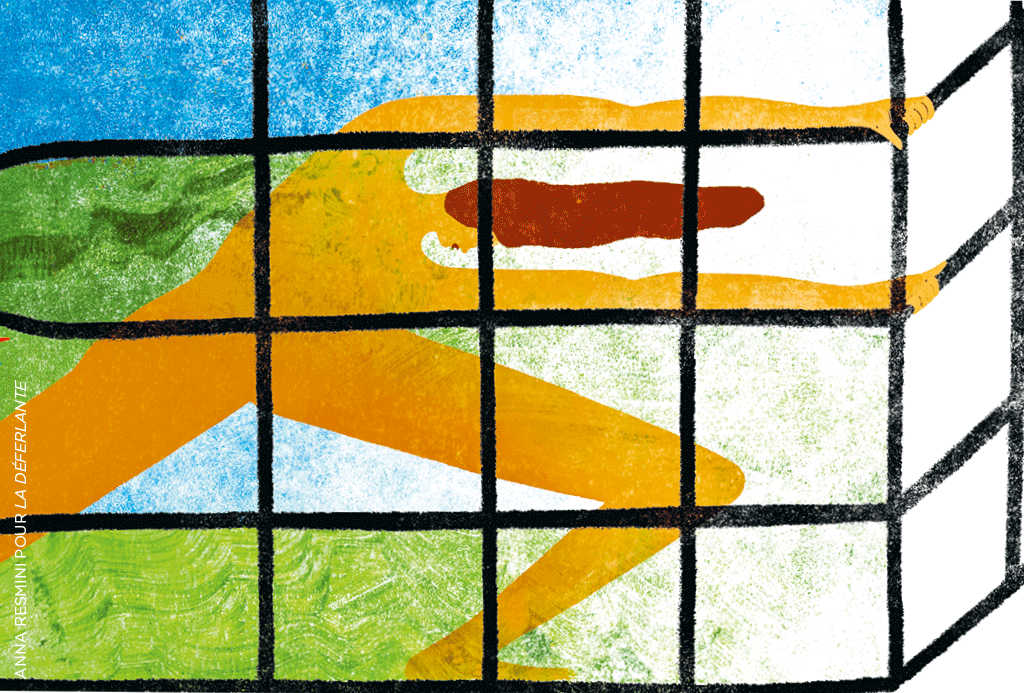C’est d’abord l’histoire d’une femme. Une histoire dans un pays immense, riche de cultures, de ressources et de complexité. Le Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique, compte 250 ethnies différentes.
C’est dans cette dernière région semi-désertique du pays, peuplée par les Haoussas, qu’est née Amina Lawal en 1973. Comme la moitié de la population qui l’entoure, et la quasi-totalité des femmes de son village, Amina Lawal n’apprend ni à lire ni à écrire. À 14 ans, elle est mariée à un homme qu’elle n’a pas choisi. Elle donne naissance à deux enfants avant d’être répudiée en 2001 – elle a 28 ans – pour un motif inconnu.
Suivant la coutume patriarcale en vigueur dans son pays, la procédure est très simple : l’homme se contente de dire à trois reprises qu’elle n’est plus son épouse, et il ne reste à la femme concernée qu’à partir en laissant ses enfants derrière elle. En revanche, si une femme souhaite divorcer, elle ne peut pas répudier son conjoint, même si elle répète mille fois qu’il n’est plus son mari.
Après ce « divorce », comme le qualifieront les médias occidentaux, Amina Lawal retourne chez sa mère. Quelques mois plus tard, elle rencontre sur la route du marché un homme qui lui propose de monter à l’arrière de sa mobylette pour lui éviter de marcher en plein soleil avec ses paquets. Certains articles décriront plus tard cette rencontre de la façon suivante : « Amina Lawal a entamé une liaison extraconjugale. »
Avec la charia, tout bascule
«Ce qui est arrivé à Amina Lawal était en fait très banal », raconte aujourd’hui Marie-Pierre Poulain, une avocate qui a participé à l’équipe mise sur pied par l’association Avocats sans frontières (ASF) pour soutenir sa défense sur place. « Les couples se formaient et se reformaient, on n’en faisait pas toute une histoire. Mais avec l’instauration progressive de la charia dans douze États du Nord à partir de 1999 et les tensions qui grandissaient entre les communautés, tout a basculé. »
En janvier 2002, Amina Lawal est arrêtée dans son village par des membres de la milice islamiste, les hisbas. Dénoncée par son ex-beau-père, elle est accusée de relations sexuelles illicites (zina) pour être tombée enceinte sans être mariée. L’homme à la mobylette, Yahayya Muhammad Kurami, est embarqué aussi. Trois mois plus tard, le procès se tient devant le tribunal islamique de l’État de Katsina.
Interrogé, Yahayya Muhammad Kurami jure sur le Coran qu’il est innocent. Et comme la cour n’a pas pu trouver quatre témoins mâles qui auraient vu le couple forniquer – condition nécessaire pour établir le crime de zina selon la loi malikite (une des quatre écoles du droit musulman sunnite) à laquelle se réfèrent les juges–, il échappe à la sentence, bien content de n’avoir pas fait l’amour en public.
En revanche, Amina Lawal est condamnée le 22 mars 2002 à la lapidation pour adultère, sa grossesse tenant lieu de preuve. On la laissera, par bonté d’âme, accoucher et allaiter son enfant avant l’exécution de la peine, reportée au plus tard en janvier 2004, quand le bébé aura atteint l’âge de 18 mois. Amina Lawal n’a pas pu bénéficier, lors de ce procès expéditif, des conseils d’un avocat, et encore moins d’une avocate. Le 19 août, alors qu’elle comparaît avec sa petite fille de neuf jours, prénommée Wasila (« qui cherche Dieu » en arabe), la peine est confirmée en appel.
Délire médiatique
Amina Lawal n’est pas la première à connaître cette sentence. On compte au moment de son procès une cinquantaine de condamnations du même type. Si aucune peine de lapidation n’a été exécutée, plusieurs hommes et femmes ont subi des flagellations, et même des amputations – y compris des mineur·e·s. Amnesty International, mais aussi des ONG de défense des droits des femmes nigérianes, comme Baobab ou Wrapa (Women’s Rights Advancement and Protection Alternative), alertent l’opinion internationale. Les réseaux sociaux n’existent pas encore –Facebook ne voit le jour qu’en 2004, Twitter en 2006–, mais l’information tourne déjà en boucle sur Internet grâce aux blogs et aux listes de diffusion par courriel. La machine médiatique peut s’emballer.
L’écrivaine et politologue Sarah Eltantawi se souvient parfaitement du moment où elle a appris la condamnation à mort d’Amina Lawal. Elle se trouvait en pleine réunion à Washington et son téléphone n’arrêtait pas de sonner. Des journalistes du monde entier voulaient connaître la position de l’association de musulmans pour les droits civiques pour laquelle elle travaillait. Au cours d’un échange rapide, les personnalités d’obédiences musulmanes diverses présentes autour de la table tombent d’accord sur trois points : aucun verset du Coran ne prescrit la lapidation ; ce genre de choses n’arrive qu’en Afrique, et la façon dont cette histoire est présentée relève du « western gaze ».
Sur le modèle du « male gaze » (concept désignant le regard masculin ou la vision androcentrée, né en 1975 sous la plume de la critique de cinéma américaine Laura Mulvey), le « western gaze » relève d’un point de vue occidental surplombant, niant aux personnes ou aux peuples concernés la capacité à exprimer leur point de vue à partir de leurs propres expériences et savoirs.
« Bien sûr, cette analyse était un peu courte, c’est pourquoi j’ai fini par écrire un livre sur le sujet », explique Sarah Eltantawi, qui enseigne aujourd’hui l’islam contemporain au département de théologie de l’université Fordham à New York. « Mais quelques mois à peine après le 11-Septembre, alors que les États-Unis étaient intervenus en Afghanistan et qu’on discutait de la possibilité d’une guerre en Irak avec une campagne mensongère sur les armes de destruction massive, ce délire médiatique autour d’une femme dont, par ailleurs, on ne savait rien nous paraissait relever d’une propagande grossière. »
Près de vingt ans plus tard, l’autrice féministe afropéenne Axelle Jah Njiké se souvient aussi du malaise qu’elle a ressenti en entendant parler de l’affaire Amina Lawal en France. La productrice qui créera le podcast « Me, My Sex and I » sur l’intimité des femmes noires (2018), puis La fille sur le canapé, sur les violences sexuelles dans les communautés noires (Nouvelles Écoutes, 2020), et enfin la série documentaire Je suis noire et je n’aime pas Beyoncé, diffusée en juin 2021 sur France Culture, est alors au début de sa prise de conscience féministe.
« Je sentais bien qu’il y avait une certaine hypocrisie dans l’indignation médiatique, mais l’image de cette femme avec son bébé dans les bras m’a poussée à signer la pétition immédiatement, et quand elle a été acquittée deux ans plus tard, je me souviens de ma joie immense. C’était comme si je connaissais la meuf, comme si c’était personnel. Quand on voyait des photos d’elle, il y avait un côté Vierge à l’enfant, et pour les personnes de culture évangélique comme moi, la phrase qui résonnait était “Que celui qui n’a jamais péché lui jette la première pierre” de Jésus, en défense de la femme adultère. Après coup, je me suis trouvée un peu ridicule, mais la dimension spirituelle, profondément symbolique m’avait touchée. »
Face aux patriarcats
Qu’elle soit le fruit du hasard ou d’une mise en scène (et probablement un peu des deux), l’image percute en effet nos imaginaires, évoquant ce que l’écrivaine Françoise d’Eaubonne appelait « le sexocide des sorcières ». Et les féministes occidentales ne sont pas les seules à se mobiliser : partout dans le monde, y compris en Afrique, des manifestations sont organisées pour demander son acquittement.
En France, l’engagement en faveur d’Amina Lawal paraît relever de l’évidence. Une amie féministe résume le point de vue qui domine alors : « On s’était battu·e·s contre les intégristes catholiques de la Trêve de Dieu et leurs commandos anti-IVG, on se battrait contre les intégristes musulmans qui prétendent contrôler le corps des femmes. »
Le débat sur le voile, qui commence à monter en arrière-plan, s’inscrit dans ce cadre que l’on perçoit alors à l’aune de la guerre civile sanglante en Algérie – une guerre opposant l’armée nationale et divers groupes islamistes, qui a commencé en 1991 et qui est seulement en train de se terminer, après une décennie d’horreurs. À Femmes solidaires (l’association féministe historiquement liée au Parti communiste), notamment, plusieurs féministes algériennes témoignent de ce qu’elles ont vécu et reçoivent l’affaire Amina Lawal comme une illustration de cette montée intégriste qui a fait des ravages dans leur vie ou parmi leurs proches.
De son côté, l’écrivaine Sarah Eltantawi ne cache pas la difficulté qu’elle a alors à garder le cap face aux positions patriarcales qui s’opposent dans le contexte états-unien encore fortement ébranlé par les attentats du 11-Septembre : « Si j’étais d’accord avec les leaders musulmans quand ils dénonçaient le capitalisme, si je partageais leurs vues sur le colonialisme, la corruption des élites et l’impérialisme culturel, je ne pouvais pas les suivre quand ils affirmaient au détour de la conversation que les femmes étaient inférieures aux hommes et que leur rôle était de rester à la maison. Mais avec les attaques permanentes que l’on subissait, c’était difficile de faire entendre une voix musulmane et féministe ! »
Philanthropie de l’urgence
Pour la politologue décoloniale Françoise Vergès, la médiatisation de ces urgences vitales entrave précisément le temps nécessaire à la réflexion, empêche de penser des solutions pour créer des ponts, des solidarités transcontinentales entre femmes. « Oui, il y a partout des masculinités meurtrières, qu’il faut combattre sans complaisance. Mais ce qui me frappe, c’est à quel point cette histoire est encadrée par une vision occidentale de l’urgence humanitaire, avec cette pression pour agir, sauver une personne, désigner des ennemis. On est dans l’émotionnel, et il est facile de sombrer dans le “white saviorism” [connu en français comme « complexe du sauveur blanc », pour désigner les personnes qui mettent en scène leur engagement humanitaire pour améliorer leur image tout en se donnant bonne conscience – ndlr], plutôt que d’observer et de plonger dans les complexités… Une philanthropie corporate s’est imposée, on le voit avec certaines marques de vêtements par exemple, dont la production s’appuie sur l’exploitation de femmes du Sud global mais qui communique sur leurs bonnes actions pour des associations de femmes, ce qui dès lors justifierait leur capitalisme, du “corporate washing” en quelque sorte. Cette injonction à l’urgence, qui n’est pas sans lien avec une réalité, tue toute analyse. On est baladées d’un truc à l’autre, et à la fin on ne s’attaque pas aux structures. Plutôt que de participer à cette mascarade, on devrait plutôt projeter la lumière sur les vrais visages des impérialismes. »
N’empêche : au printemps 2002, quand j’entends parler d’Amina Lawal, je n’ai pas cette force d’âme et je me demande seulement ce que je peux faire pour « sauver Amina ». Avec Agnès Boussuge, alors rédactrice en chef de Clara Magazine, la revue de Femmes solidaires, à laquelle je contribue occasionnellement, nous envisageons d’apporter un soutien direct à la défense.
J’ai pris contact avec l’association Baobab qui m’a parlé des menaces pesant aussi sur l’avocate d’Amina Lawal, Hauwa Ibrahim. L’avocate Catherine Mabille, qui est intervenue dans plusieurs procès de viol et de mutilations sexuelles pour Femmes solidaires, propose de lui apporter un appui au nom d’Avocats sans frontières. Femmes solidaires, Amnesty International, l’association Ensemble contre la peine de mort et Reporters sans frontières s’associent au projet, et Catherine Mabille part au Nigeria au printemps 2003 en « mission exploratoire ». « On voulait savoir pourquoi elle était tellement isolée, se souvient-elle. On s’est vite aperçus, avec l’avocat québécois Pierre Brun qui m’accompagnait, que Hauwa Ibrahim en savait dix fois plus que nous, et qu’il fallait d’abord l’écouter pour pouvoir lui apporter un soutien logistique et moral. »
L’avocate d’Amina Lawal, Hauwa Ibrahim, également musulmane de culture haoussa, a grandi dans une famille modeste et, à l’époque, exerce le droit depuis plus de dix ans. En 2002, elle a 34 ans ; mariée avec un Italien et mère de deux petits garçons, elle vit à Abuja, la capitale nigériane, et héberge alors Amina Lawal. Elle subit des menaces constantes. Tous les autres avocats refusent de s’engager dans cette affaire qui pourrait leur coûter la vie, plusieurs avocats et journalistes mêlés de près ou de loin à l’affaire ayant été la cible d’intégristes. « Nous avons commencé à travailler sur des bases professionnelles, raconte Catherine Mabille. Quelle était la meilleure stratégie pour défendre Amina Lawal ? Son idée était de faire jurisprudence. Dans son cabinet, elle avait déjà une cinquantaine de cas similaires. Si elle réussissait à développer un principe de défense convaincant, on pouvait éviter de nouvelles condamnations. »
Cette approche pragmatique va permettre d’échapper à un contexte géopolitique miné pour se recentrer sur des valeurs communes : égalité devant la loi, droit à un procès équitable, droits de la défense, respect de la procédure… qui seront au cœur des plaidoiries. Hauwa Ibrahim entend s’appuyer sur les conventions internationales relatives aux droits humains signées par le Nigeria, mais aussi sur le droit musulman qui contient, assure-t-elle, des dispositions permettant d’appliquer une justice équitable. Après un voyage à Paris en octobre 2002, elle décide de se rendre au Liban pour rencontrer des juristes spécialisés dans la tradition malikite. Je la retrouve à Beyrouth pour consulter de grands professeurs de droit musulman, avec l’aide précieuse de l’avocate libanaise Maryam Abdallah.
Le mythe de l’enfant endormi
Je découvre auprès d’elles la théorie de l’enfant endormi : ce mythe berbère raconte qu’un enfant dont le père est absent au cours de la gestation peut être « endormi » pour se réveiller des mois, voire des années plus tard. Cette théorie avait notamment cours chez les peuples semi-nomades, où les hommes pouvaient partir durant de longues périodes pour des transhumances ou des caravanes commerciales, et où elle permettait à chaque protagoniste de s’en sortir sans perdre la face, dans l’intérêt de l’enfant et de la communauté. Ce mythe est redevenu d’actualité plus récemment avec l’émigration économique, quand les maris partaient pour de longues années. Il est en tout cas intégré depuis longtemps au droit musulman pour permettre une issue non violente à des naissances illégitimes : dans la tradition malikite, on considère qu’une naissance peut survenir jusqu’à sept ans après le départ du mari.
Alors que nous sommes en train de discuter des implications possibles de cet étonnant argument juridique, la mobilisation internationale entre en ébullition. La star du talk-show américain, Oprah Winfrey, a produit une émission intitulée « Pouvons-nous sauver Amina Lawal ? », et des millions de lettres de protestation affluent dans les ambassades nigérianes, demandant au président de la République, Olusegun Obasanjo, de gracier Amina Lawal et de supprimer les tribunaux appliquant la charia. Obasanjo, qui fait alors campagne pour sa réélection et ne peut se permettre de se mettre le nord du pays à dos, louvoie en assurant qu’Amina Lawal ne sera pas exécutée.
C’est alors, en décembre 2002, que la situation se tend brutalement : le concours Miss Monde, remporté en 2001 par la Nigériane Agbani Darego, doit se dérouler au Nigeria, mais plusieurs candidates appellent au boycott en soutien à Amina Lawal. Un journaliste nigérian a le malheur d’écrire que le prophète Muhammad aurait eu plaisir à choisir une épouse parmi les Miss. L’article est aussitôt monté en épingle par les islamistes, qui le jugent blasphématoire, et des émeutes éclatent dans tout le pays entre musulmans et chrétiens, entraînant en quelques jours 200 morts et plus de 1 000 blessés. Les organisateurs du concours font machine arrière, et il se déroule finalement en décembre 2002 à Londres, ce qu’un reportage diffusé sur France 2 qualifie de « défaite de la tolérance et de la beauté ».
Il faudra attendre le 25 septembre 2003, après de multiples reports d’audience, pour qu’Amina Lawal soit enfin acquittée. Hauwa Ibrahim n’a pas plaidé. C’est son confrère Aliyu Musa Yawuri qui s’est exprimé devant la cour, car il n’était pas permis à une femme de le faire, même si c’était elle qui avait rédigé le mémoire de défense. Les arguments retenus en faveur de l’acquittement ne furent finalement pas ceux de l’enfant endormi, mais plusieurs vices de procédure : la pleine adoption de la charia dans l’État de Katsina après la survenue de la grossesse et l’impossibilité de l’appliquer rétroactivement ; l’arrestation de l’accusée par une milice, au lieu de la police régulière, et la façon dont ses aveux avaient été recueillis.
Bâtir une alternative aux violences
Ce qui est arrivé ensuite appartient à l’histoire. En 2003, l’affaire Amina Lawal avait eu un tel retentissement que Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’intérieur, a consacré plusieurs minutes à débattre de la lapidation avec Tariq Ramadan dans l’émission « 100 minutes pour convaincre ». Il reprocha notamment à l’islamologue, alors très populaire, d’avoir demandé « un moratoire », et non la disparition de cette pratique. La France est alors en plein débat sur le voile – la loi interdisant les signes religieux à l’école sera adoptée en 2004–, et la façon dont se déroule la discussion s’appuie souvent sur ces cas extrêmes, supposés représenter l’islam.
Hauwa Ibrahim a obtenu en 2005 le prix Sakharov pour la liberté de l’esprit, décerné par le Parlement européen. Il a été partagé cette année-là avec les Dames en blanc (des activistes cubaines engagées pour la défense des dissident·e·s emprisonné·e·s dans leur pays), mais aussi avec l’ONG Reporters sans frontières, alors dirigée par Robert Ménard – qui se rapprochera quelques années plus tard de l’extrême droite et sera élu en 2014 maire de Béziers avec le soutien du Front national.
Le virage à l’extrême droite de plusieurs des soutiens de l’affaire Amina Lawal – par exemple un certain nombre de militant·e·s laïques du média en ligne Respublica qui, autour de Pierre Cassen, ont fondé le site Riposte laïque – fait probablement partie des conséquences prévisibles de ce cadre occidental que la journaliste canadienne Naomi Klein dénoncera en 2007 dans son essai La Stratégie du choc (Actes Sud, 2008) : exploiter la peur de l’autre pour exercer sur les peuples une domination sans partage, au profit des 1 % les plus riches de la planète – et d’ailleurs aussi aux dépens de ladite planète.
Les défenseurs et défenseuses d’Amina Lawal ont constamment cherché à bâtir une alternative aux violences qui se développaient encore au Nigeria – rappelons que le groupe salafiste Boko Haram y a vu le jour en 2002. Soucieuse de faire profiter les juristes nigérians de son expérience en la matière, Hauwa Ibrahim a publié en 2013 un manuel en anglais (traduction du titre : Pratiquer la loi devant les cours charia, sept stratégies pour obtenir justice) alors qu’elle était devenue professeure invitée à l’université Harvard, aux États-Unis. Elle continue de se rendre régulièrement au Nigeria. Elle est notamment intervenue dans le Nord pour tenter de faire libérer les 276 écolières kidnappées par Boko Haram en 2014. C’est aussi pour contrebalancer l’influence de cette organisation terroriste sur les jeunes qu’elle a lancé en 2018 le réseau Mothers Without Borders (Mères sans frontières), afin de développer, internationalement, une culture de la paix à partir du vécu des femmes et de leur expertise de terrain.
À la suite au procès Amina Lawal, Avocats sans frontières a mis en œuvre plusieurs projets en collaboration avec la Nigerian Bar Association, la Commission nationale des droits humains et le soutien financier de l’Union européenne. « Une approche au long cours qui a permis de développer une culture nouvelle combinant plusieurs traditions juridiques pour faire reculer la peine de mort, la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants, en particulier au profit des femmes et des personnes les plus pauvres, qui ont enfin eu accès à un dispositif d’aide juridique légale », explique François Cantier, président honoraire d’ASF France.
Amina Lawal s’est remariée et a eu d’autres enfants. Hauwa Ibrahim a adopté Wasila, qui est aujourd’hui mariée et mère de deux petits garçons. Aucune personne n’a plus été condamnée à mort par lapidation au Nigeria depuis 18 ans. Et c’est une écrivaine nigériane, Chimamanda Ngozi Adichie, qui a permis de redonner un souffle inédit au féminisme avec son essai Nous sommes tous des féministes (Gallimard, 2015), dont des extraits ont été samplés par la chanteuse afro-américaine Beyoncé. Comme le dit Françoise Vergès : « Rien n’est jamais simple, rien n’est jamais écrit. Le puzzle n’en finit jamais de se recomposer. » J’en conclus personnellement que tout est toujours possible. Y compris le meilleur.