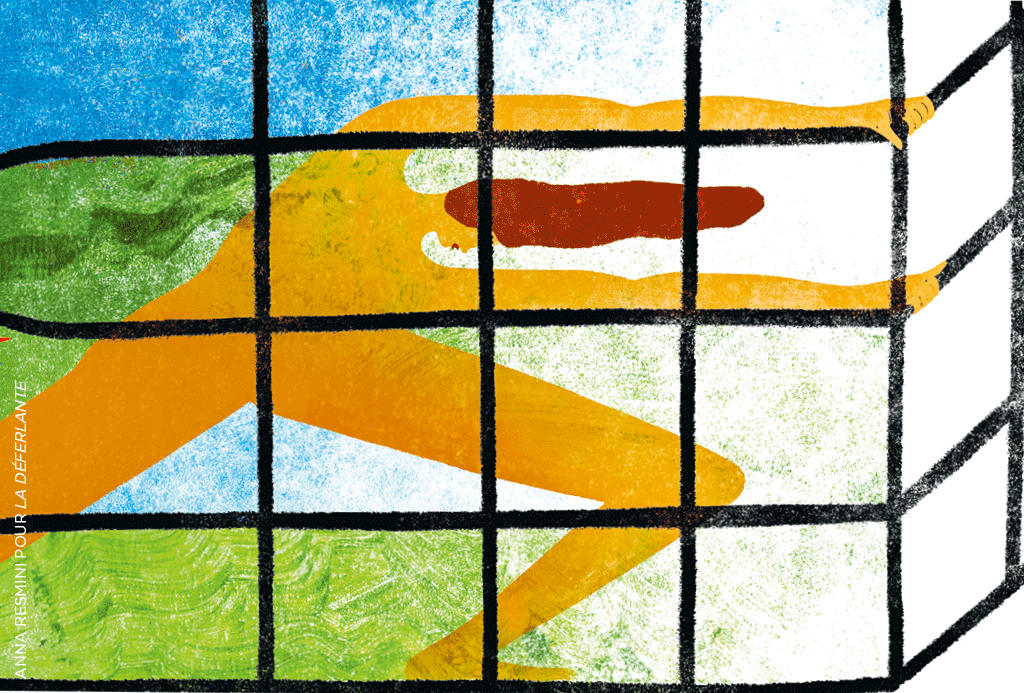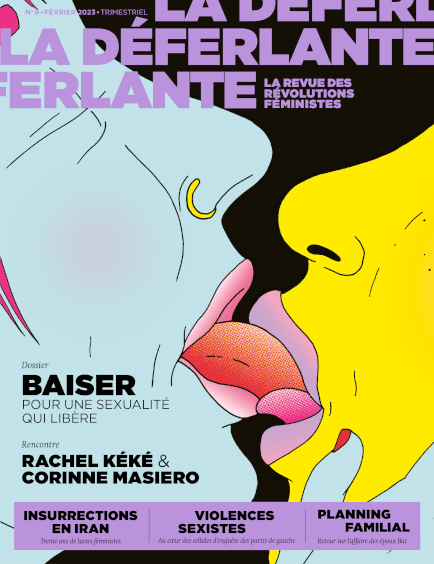Avant d’entrer dans la chambre, les visiteur·euses doivent retirer leurs chaussures. Dans ce centre d’hébergement du xixe arrondissement de Paris, Laura (le prénom a été modifié) a soigné la décoration et optimisé l’espace de 12 mètres carrés dont elle dispose.
Au nom des « femmes comme elles », tombées aux mains des mêmes trafiquants, Laura raconte son parcours. Elle est née à Paramaribo, la capitale du Suriname. Son père était agriculteur. Sa mère faisait bouillir la marmite. Elle a 18 ans lorsque, par amour, elle traverse le fleuve Maroni marquant la frontière avec la Guyane française (voir la carte page 129). Les années passent, les hommes aussi, violents pour certains. Les enfants naissent les uns après les autres, deux filles, deux fils. Les pères encaissent les aides de l’État tandis que Laura cultive son lopin de terre, vend des légumes le long de la nationale à Cayenne, fabrique sa maisonnette en agglo. Pilier de sa famille, comme beaucoup de femmes de sa communauté – les Bushinengués, descendant·es d’esclaves –, elle veut rester positive. « Mais en 2015, tout s’est écroulé » : sa petite dernière, Rosalinda, est tuée par une voiture. Pendant qu’elle s’enfonce dans la dépression, le père détale. C’est alors qu’un homme lui parle du transport de cocaïne : « Un trajet et tu mets ta famille à l’abri. »
De Cayenne, elle prend la route jusqu’à Saint-Laurent-du-Maroni, traverse le fleuve, reprend la route jusqu’à un village près de Paramaribo. Elle est reçue par un « obiaman », un homme médecine, qui pendant une semaine lui fait faire des ablutions traditionnelles censées la protéger des contrôles douaniers. Des soins payés par le cartel. De retour à Cayenne, on lui scotche de petits sachets de drogue sur le corps. Avant de prendre l’avion pour la première fois de sa vie, elle négocie de pouvoir déposer 60 euros à sa fille aînée, qui ne se doute de rien.
Malgré la méfiance des douaniers à l’aéroport de Cayenne, qui inspectent ses bagages de fond en comble, c’est à Orly qu’une palpation révèle le pot aux roses. Puis, « tout est allé très vite » : des douanes de l’aéroport, Laura est déférée à l’hôpital pour un examen radiologique, puis au tribunal de Créteil (Val-de-Marne). « Je n’ai vu mon avocate que quelques minutes, je n’ai pas eu le temps de tout dire. » Elle se souvient des mots cinglants du juge en comparution immédiate : « Vous n’avez pas pensé à vos enfants. » « Quand je me suis retrouvée en cellule, la première chose que j’ai faite, c’était de leur demander pardon », se remémore-t-elle avec émotion. La suite est une belle leçon de résilience. Pendant son incarcération, Laura aiguise son français, notamment grâce à ses codétenues et ses gardiennes. Elle est encore en prison lorsqu’elle trouve un emploi et obtient l’autorisation de parler à ses enfants, et enfin celle de terminer sa peine au Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) parisien où nous la rencontrons, fière et prête à imaginer des jours meilleurs.
Un « dernier recours » plus par nécessité que par choix
Entre 2005 et 2010, les Pays-Bas ont tenté de fermer progressivement la route de la poudre blanche du Suriname, plateforme mondiale du trafic de cocaïne. Depuis, les cartels se sont tournés vers la Guyane française. Selon les services des douanes, sur chaque vol de Cayenne à Orly, entre vingt et trente passager·es sont des « mules » transportant de la cocaïne. Une tâche dont les trafiquants chargent volontiers les femmes. Ne représentant que 3,8 % de la population carcérale globale, les femmes sont statistiquement beaucoup moins sujettes à la criminalité que les hommes. La maison d’arrêt des femmes de Fresnes, où sont enfermées en moyenne 150 détenues, est occupée à plus de 60 % par des transporteuses de drogue. Même chose dans les centres d’hébergement, tels que celui du xixe arrondissement de Paris. La directrice, Valérie Caulliez, reçoit des femmes venues de Guyane, comme Laura, et condamnées pour les mêmes faits. Ses pensionnaires subissent selon elle la manipulation de cartels à l’organisation bien huilée et très informés des politiques douanières. « Au départ ils avaient pris de jeunes hommes vulnérables, puis des femmes enceintes… Ils touchent aux populations qui n’ont pas grand-chose à attendre de la société et de l’État, et profitent d’une situation économique proche du désert. »
Chargé de mener des entretiens auprès de personnes incarcérées pour trafic de stupéfiants, le SPIP (1) du Val-de-Marne relève que « les motivations avancées sont celles des recours à des alternatives leur permettant de subvenir à leurs propres besoins fondamentaux et/ou à ceux de leur famille. En effet, elles font généralement état de dettes (amendes, créances…) qu’elles n’arrivent pas à honorer. Ces conditions de vie très précaires sont renforcées par d’autres facteurs fragilisant l’équilibre économique des familles (chômage, invalidité, handicap, naissance, décès…). Cet acte est souvent vécu comme un “dernier recours” plus par nécessité que par choix. »
Pourtant, cette stratégie du « dernier recours » est sanctionnée par des peines d’une grande sévérité, qui, selon les avocat·es des accusées, ne tiennent pas compte de la situation socio-économique de la Guyane. Beaucoup rapportent leur sentiment d’impuissance lors des comparutions immédiates à la 12e chambre du tribunal de Créteil : une impression que les peines sont toujours les mêmes, quelles que soient les circonstances. En 2021, Me Laura Témin a gagné le concours des plaidoiries pour les droits humains du mémorial de Caen en alertant sur cette situation. L’avocate a été choquée par la réponse judiciaire apportée à son premier dossier, alors qu’elle était commise d’office à Créteil. La date est restée gravée : 18 septembre 2019. Sa cliente, mère de deux enfants de 7 et 8 ans, assistante comptable, s’occupant de sa mère atteinte d’un cancer, a transporté depuis la Guyane un kilo de cocaïne. Sous le coup d’un avis d’expulsion de son logement, elle avait accepté les 4 000 euros proposés par un trafiquant. « Elle cherchait du travail depuis des mois. Cette somme, elle l’a considérée comme une bouée de sauvetage », rapporte l’avocate. À l’audience, Laura Témin a fourni aux juges des documents pour appuyer sa sollicitation d’un aménagement de peine : une adresse fixe à Cayenne et la preuve d’un travail. Mais après quinze minutes d’audience, la condamnation est tombée : un an de prison ferme, à purger à Fresnes. « Il existe un système de gradation des peines, alors pourquoi n’a‑t-elle pas bénéficié, comme c’est le cas en principe pour les primodélinquants, d’une peine de sursis ou d’un aménagement de peine, tel que le bracelet électronique ou la semi-liberté ? », s’interroge l’avocate. Bien que le code de procédure pénale oblige en principe les magistrat·es à prendre en compte les éléments de la personnalité des prévenu·es pour statuer, des avocat·es dénoncent un système souterrain « forfaitaire » mis en place au tribunal de Créteil : un kilo transporté = un an ferme. Or, « les peines forfaitaires ne reflètent pas la différence entre celles qui ont été forcées, celles qui ont agi par désespoir, et d’autres qui auraient des intentions criminelles », déplore Me Témin.
« Au tribunal, Elles font l’objet de représentations misogynes et sont condamnées en tant que “mules”, mais aussi pour avoir failli dans leur rôle de mère. »
Manon Réguier-Petit Sociologue
Privées du « droit au respect de la vie privée et familiale »
L’avocat Gabriel Old garde, quant à lui, en travers de la gorge le sort d’une transporteuse qu’il a défendue : une femme de 20 ans, née à Saint-Laurent-du-Maroni, mère de trois enfants. C’était en janvier 2021, toujours au tribunal de Créteil. Elle avait été arrêtée une première fois en 2018 à Orly avec 8 grammes de cocaïne. Elle expliquait devoir rembourser une dette de 700 euros. Interpellée à nouveau en 2020 avec 860 grammes de cocaïne avalés sous forme d’ovules, sa dette s’élevait alors à 7 000 euros. « Ils ont menacé de me tuer. C’est par peur pour ma vie et celle de mes enfants que j’ai pris cette décision. […] Je ne recommencerai pas », relate la prévenue dans le compte rendu d’audience (2). Dénonçant un « système mafieux », Me Old avait fait valoir l’intérêt d’une peine aménageable de cinq mois ferme, en produisant une lettre du compagnon de sa cliente s’engageant à ramener les enfants auprès d’elle et une attestation d’hébergement en métropole. Le tribunal en a décidé autrement : trois ans ferme. « Ça fait partie des audiences qui me restent en travers de la gorge », résume l’avocat, qui n’a pas fait appel pour éviter une peine encore plus lourde à sa cliente.
Laura Témin suppose qu’avec ces condamnations, les juges se donnent pour mission de « dissuader les potentiels transporteurs et de lutter efficacement contre ce fléau ». Mais selon elle, c’est au gouvernement, et non aux juges, de se soucier d’être efficace (3). L’avocate voit également dans l’emprisonnement de ces femmes à 7 000 kilomètres de chez elles une violation des droits humains et du « droit au respect de la vie privée et familiale ». « Les enfants se retrouvent sans mère et sans parloir, rappelle-t-elle. Il y a une rupture absolue de lien entre les familles. Et l’enfer ne s’arrête pas à Fresnes : quand elles rentrent, elles doivent payer une dette aux trafiquants. »
Bien que le code de procédure pénale oblige en principe les magistrat·es à prendre en compte les éléments de personnalité des prévenu·es pour statuer, des avocat·es dénoncent un système souterrain « forfaitaire » mis en place au tribunal de Créteil : un kilo transporté = un an ferme.
Femmes, mères, guyanaises : la triple peine
En Guyane, depuis son bureau d’où il nous parle en visio, Samuel Finielz, procureur de la République de Cayenne, décrit une politique pénale différente de celle de Créteil. La stratégie répressive a changé autour de 2017–2018 : en dessous de 2 kilos de drogue transportés, les peines de prison ferme sont devenues de moins en moins fréquentes, au profit de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), le plaider-coupable français. Une « procédure simplifiée » est favorisée en alternative aux poursuites pour « éviter toute embolisation de la chaîne judiciaire ». Mais la démarche répond aussi à une problématique sociale, selon le procureur : « Les femmes que je vois – de 20 à 30 % des 500 personnes arrêtées chaque année pour transport de cocaïne entre la Guyane et la métropole – sont en situation de précarité. Elles ont des enfants qui ne sont pas toujours reconnus par les pères… Face à des trafiquants chevronnés, elles peuvent se laisser convaincre assez facilement de transporter de la cocaïne. » Malgré nos demandes répétées, il a été impossible d’interroger le parquet de Créteil sur la mise en place d’un dispositif similaire.
La sociologue Manon Réguier-Petit a travaillé sur le terrain pendant de longs mois. Au téléphone, elle confirme que les femmes guyanaises « cumulent » les difficultés : loin d’être une circonstance appelant à la clémence, leur statut de mère est, aux yeux des juges de la France hexagonale, trop souvent perçu comme une circonstance aggravante. « Au tribunal, elles font l’objet de représentations misogynes et sont condamnées en tant que “mules”, mais aussi pour avoir failli dans leur rôle de mère en “mettant en danger des enfants” pendant le transport ou en faisant peser sur eux le risque de placement. Ce jugement-là n’est jamais porté sur les hommes ».
Quand elle a foulé le sol de Guyane en 2017, la chercheuse était envoyée par l’Injep, l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire, pour effectuer une évaluation d’un dispositif de prévention en milieu scolaire à destination des jeunes de l’Ouest guyanais « tenté·es par ce phénomène ». « Il y a dans la façon d’aborder la situation dite “des mules”, beaucoup de mauvaises représentations, constate-t-elle. Le discours dominant parmi les acteurs et actrices institutionnel·les, y compris la justice, c’est qu’il s’agit d’un phénomène touchant des personnes faibles psychologiquement, attirées par l’argent facile, qui veulent acheter des scooters ou des lunettes. Or rien n’est facile, dans cet argent. » En lieu et place d’une évaluation du dispositif, Manon Réguier-Petit a finalement coécrit en 2018 un rapport intitulé « Le défi de la prévention du phénomène des mules en Guyane ».
La sociologue a mis le nez dans ce qu’elle appelle une « économie hostile pour les femmes », en particulier les femmes touchées par de très profondes inégalités ethnoraciales propres au territoire de la Guyane française. « Si on caricature, la société est pyramidale. Il y a les Blanc·hes, les métropolitain·es, les créoles, les Amérindien·nes et les Bushinengué·es. À Fresnes, on trouve une majorité de femmes bushinenguées parmi les transporteuses incarcérées, parce qu’elles sont davantage candidates que les autres, car davantage précarisées, et discriminées pour leur couleur de peau. » La sociologue insiste sur le terme « candidate » et non pas « cible » car elle a vite compris, une fois sur place et en l’entendant de la bouche des lycéennes, que le transport de cocaïne est la seule issue vécue comme « respectable » pour ces femmes. Les marchés du travail légal et informel étant saturés, ne reste que l’illégalité : la cocaïne ou la prostitution. « Chez les Bushinengués, il n’y a que peu ou pas d’accès à la contraception et une forte proportion de monoparentalité. La norme, c’est que la mère élève ses enfants, sans demander de pension alimentaire. Ces femmes ne sont pas jugées socialement si elles font des allers-retours, alors que celles qui se prostituent rencontrent l’exclusion ». Manon Réguier-Petit a en outre constaté que les intermédiaires des cartels ne sont pas des hommes lourdement armés, mais des mères, des oncles, des amis de la famille. Elle s’est donc trouvée dans une posture délicate : « Aller dans les lycées en tant que Blanche, en disant simplement aux lycéen·nes de ne pas faire de trafic de cocaïne, c’était être en plein décalage. »
C’est ce décalage qui, selon elle, rend la fermeté de la justice et sa politique du chiffre d’autant plus condamnables. « Il n’y a pas de moyens alloués pour prévenir le passage à l’acte ; ils ne sont consacrés qu’à la répression. » Un constat que partage Valérie Caulliez, la directrice du centre d’hébergement parisien de Laura, pour qui on ne peut pas comprendre la problématique des personnes transporteuses sans aller en Guyane. « S’il n’y a pas de volonté politique, si l’on ne développe pas de perspectives économiques pour les jeunes et si aucun travail n’est fait avec le Suriname, vous aurez beau sensibiliser les familles, ce sera peine perdue », affirme-t-elle.
Avec les économies qu’elle a réunies, Laura s’est offert un fer à repasser pour que son uniforme de travail soit toujours impeccable. Elle fait des ménages tout en préparant un CAP de cuisine. Quand elle se prend à rêver, elle s’imagine cheffe dans un restaurant. Sur le pas de la porte du foyer, c’est le feu de l’indépendance qui semble l’habiter : « J’ai appris que je n’ai plus besoin des hommes et de leur argent. Je suis bien toute seule. Mon nouveau mari, c’est mon travail. » •
1. Les SPIP, Services pénitentiaires d’insertion et de probation, ont pour mission principale la prévention de la récidive. Ils assurent un accompagnement personnalisé des personnes privées de liberté.
2. Compte-rendu d’audience du site Actu-Juridique.
3. Sollicité, le ministère de la Justice n’a pas donné suite à notre demande d’entretien
La Guyane, l’un des départements français les plus pauvres
Le PIB par habitant·e de la Guyane est inférieur de moitié à celui de la France hexagonale, avec un taux de pauvreté de 51 % d’après l’Insee. 43 % des jeunes Guyanais·es ne sont ni en emploi ni en formation. Le trafic par voie aérienne entre la Guyane et Paris représente entre 15 et 20 % des entrées de cocaïne sur le territoire hexagonal selon un rapport sénatorial de 2020. Ancienne colonie, la Guyane a été un lieu de déportation pour les condamnés aux travaux forcés de 1852 à 1946. Aujourd’hui département français, elle est située sur le continent sud-américain, à l’est du Suriname et au nord du Brésil.