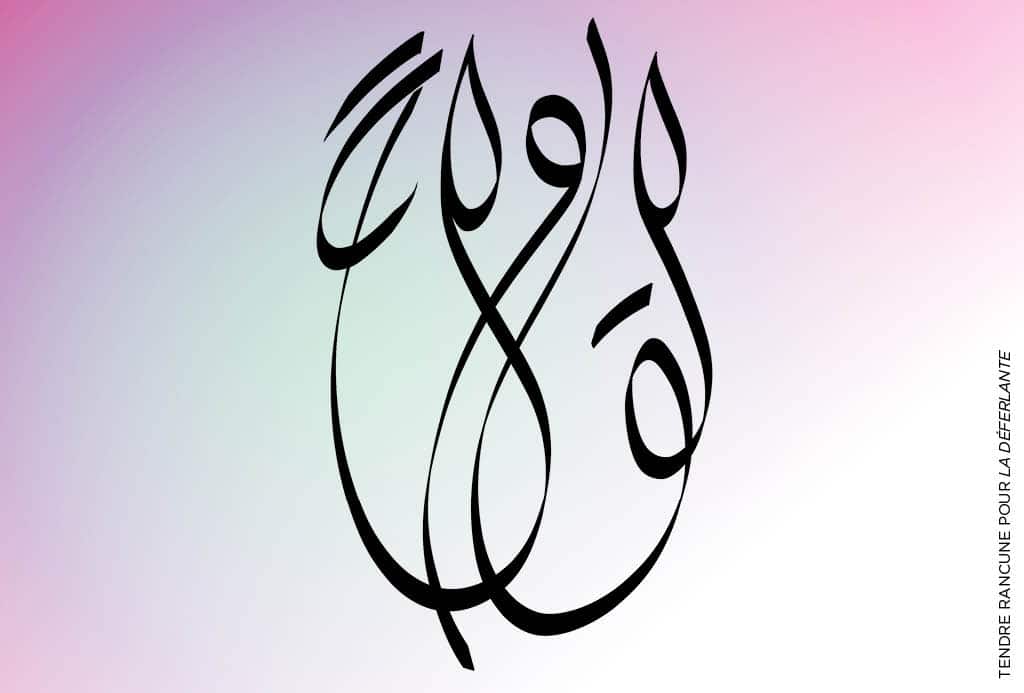« Le tabou le plus tenace de la télévision. » C’est ainsi que la journaliste états-unienne Kate Aurthur parlait de l’avortement, il y a presque vingt ans, dans les colonnes du New York Times. Plus encore que l’homosexualité, les transidentités et les questions raciales, l’interruption volontaire de grossesse (IVG) continue de crisper l’industrie du cinéma et de la télévision.
Supposées refléter la libération des mœurs et l’évolution de la société, les productions doivent composer avec des studios frileux, éviter de faire fuir les annonceurs ou de s’aliéner une partie du public. Aux États-Unis, « ce pays fédéral, structuré par des visions très religieuses et des courants politiques fortement conservateurs, l’avortement fait effectivement partie des sujets extrêmement sensibles qui perdurent, constate Hélène Breda, maîtresse de conférence en sciences de l’information et de la communication, spécialiste des représentations de genre dans les médias. En France, depuis le vote de la loi Veil autorisant l’IVG en 1975, on se sent moins en danger, car l’avortement est considéré comme un acquis social. »
Tout cela explique sans doute pourquoi rares sont les films français contemporains qui s’emparent de ce thème. Lorsqu’ils le font, l’action se déroule dans le passé : retour vers le XVIIIe siècle pour l’IVG artisanale et sororale de Sophie, la servante du Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma (2019), ou au début des années 1960 pour L’Événement (2021), le film d’Audrey Diwan adapté du roman d’Annie Ernaux, qui raconte le douloureux parcours d’une étudiante enceinte qui ne souhaite pas le rester. En 2022, c’est Annie Colère de Blandine Lenoir qui nous faisait (re)découvrir le combat des militantes du Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception (Mlac), fondé en 1973 et dissous deux ans plus tard, après le vote de la loi Veil.
Lire aussi : Que reste-t-il du Mlac ?
Pédagogie et divertissement
Les séries françaises sont résolument plus modernes : en 2020, Plus belle la vie diffusait trois épisodes sur la grossesse non désirée d’Émilie, jeune vingtenaire en couple qui décide rapidement d’avorter, malgré l’insistance et le chantage de son petit ami. Soutenue par sa famille et son amie médecin, qui la rassure sur la banalité de l’acte – à raison, puisqu’en France, 243 000 IVG ont été enregistrées en 2022 (lire notre infographie) et qu’une femme sur deux avortera au cours de sa vie –, Émilie se sent soulagée par sa décision. Deux ans plus tard, c’est une IVG médicamenteuse, soit la méthode la plus courante (78 % des IVG), que met en scène la série de France 3. Même traitement pédagogique, déstigmatisant et réaliste, pour l’IVG de la jeune Anaïs dans la série de TF1 Ici tout commence (2022), très regardée par les 15–24 ans. « Ces séries sont les héritières des soaps états-uniens, les premiers à aborder l’IVG, et ce dès les années 1960, analyse Hélène Breda. C’est un genre qui repose sur les rebondissements – et les grossesses imprévues sont un classique – ainsi que sur la dimension edutainment, cette pédagogie mêlée au divertissement, où l’on aborde les questions sociales de manière didactique et grand public. » Depuis, les réalisatrices Fanny Herrero (Drôle) et Iris Brey (Split) ont, elles, normalisé l’IVG de trentenaires déjà mères ou projetant de le devenir.
De l’autre côté de l’Atlantique, Hollywood, le plus gros pourvoyeur de fictions diffusées dans le monde, progresse indéniablement sur la représentation de l’avortement, mais continue de tendre au public un miroir déformant. Depuis longtemps, les séries états-uniennes usent des mêmes ficelles scénaristiques pour éviter d’aborder la question de l’avortement lorsque surgit une grossesse « surprise » : celle de Gaby (Desperate Housewives) est interrompue quand elle chute dans l’escalier, Rachel (Glee) ou Jessa (Girls), victimes d’un faux positif, ne sont finalement pas enceintes, et certaines héroïnes subissent un arrêt spontané de grossesse, retournement classique pour se dérober au sujet (comme Lisa, dans la saison 2 de And Just Like That, qui s’était pourtant résignée à ne pas avorter).
Autre subterfuge que l’on rencontre aussi dans les séries françaises : la volte-face incompréhensible de femmes qui n’ont jamais voulu devenir mères (Miranda dans Sex and the City, Laure dans Engrenages), ou déjà comblées (voire épuisées) par la maternité. Dans Desperate Housewives, Lynette, déjà mère de quatre enfants, se retrouve enceinte de jumeaux à 40 ans passés, alors que son mari a repris ses études. Elle penche du côté de l’IVG, mais se ravise après que son amie Susan lui assure qu’un enfant est un « cadeau » – en réalité, c’est la chaîne ABC qui avait interdit au créateur de la série de faire avorter un personnage…
Autre moyen de contourner le sujet tout en sanctuarisant la maternité – et qui concerne surtout les adolescentes : les grossesses sont menées à terme et les bébés confiés en adoption. Julie (dans Desperate Housewives, encore) hésite à recourir à cette solution, que choisissent Quinn (Glee), mais aussi Juno, du film éponyme (2007), qui renonce à l’IVG lorsqu’une camarade antiavortement manifestant devant la clinique lui crie que son fœtus a déjà des ongles.
Restent les films où l’avortement n’est même pas envisagé, malgré un pitch qui confine à l’absurde. En cloque, mode d’emploi (2007) nous montre une brillante régisseuse, qui vient de décrocher le job de ses rêves, se mettre en couple avec un glandeur immature et obsédé sexuel dont elle tombe enceinte après un coup d’un soir.
À l’inverse, dans la comédie romantique états-unienne Obvious Child (2014), l’héroïne, enceinte elle aussi d’un one night stand, avorte le jour de la Saint-Valentin. C’est le sujet du film, mais la réalisatrice Gillian Robespierre parvient à déstigmatiser l’avortement, encore perçu – et souvent représenté – comme un traumatisme ou un dilemme moral éprouvant, utilisé comme ressort dramatique pour provoquer des tensions entre les personnages ou faire enchaîner disputes et crises de larmes à des héroïnes honteuses.
La pop culture, outil de prévention
De plus en plus de séries dédramatisent la procédure, comme Euphoria, ou bien Shrill. « Je ne peux pas courir, je me suis fait avorter hier », lance avec désinvolture Mimi-Rose à son copain, Adam, dans Girls. Lindsay, de la série You’re the Worst, parle de son « avovo » entre deux orgies de tartes. Car oui, avorter peut être une décision facile à prendre et qui soulage.
Loin de faire de nous des consommateur·ices passives, la pop culture modèle nos imaginaires. C’est un puissant outil de prévention qui peut améliorer nos connaissances tout en nous déculpabilisant. Dans la série BoJack Horseman, diffusée sur Netflix, une jeune patiente raconte que la chanson pro-IVG de sa pop star préférée lui a donné la force de se rendre dans une clinique. Sur la même plateforme, l’épisode de Sex Education où Maeve avorte démystifie et normalise l’IVG. Aux côtés d’autres femmes présentes à la clinique pour le même motif, elle croise une patiente excentrique qui n’en est pas à son premier avortement : « J’ai trois gamins et je me sens beaucoup plus coupable envers ceux que j’ai qu’envers ceux que j’ai renoncé à avoir. »
D’après « Abortion Onscreen », un programme de recherche de l’université de Californie à San Francisco, le nombre de films et séries qui traitent de l’avortement augmente chaque année. Un sondage Gallup réalisé en mai 2023 révèle par ailleurs que 85 % de la population aux États-Unis est favorable à l’IVG.
Mais bien que la pop culture puisse être un instrument de résistance efficace, elle n’est pas une baguette magique : son influence s’arrête aux portes du pouvoir. Depuis une douzaine d’années, les droits reproductifs régressent aux États-Unis, et en 2022 la Cour suprême a invalidé l’arrêt Roe v. Wade, qui protégeait depuis 1973 le droit à l’avortement à l’échelle nationale. Depuis, 21 États ont interdit ou restreint fortement les conditions d’accès à l’avortement.
Le road trip des droits reproductifs
Les films et séries qui s’emparent du sujet ont donc désormais une résonance particulière : réalisateur·ices et scénaristes s’adaptent au contexte hostile, en racontant les nouveaux obstacles qui se dressent sur la route de celles et ceux qui voudraient interrompre leur grossesse. C’est la naissance d’un nouveau sous-genre qui risque de devenir tristement incontournable : le road trip des droits reproductifs.
Dans la comédie Unpregnant (2020), deux meilleures amies doivent parcourir 1 500 kilomètres pour se rendre dans un État qui autorise les mineures à avorter sans le consentement des parents. De son côté, après avoir été piégée par une « clinique » anti-IVG, l’héroïne de Never Rarely Sometimes Always (2020) doit aller jusqu’à New York pour trouver une antenne du Planned Parenthood (l’équivalent états-unien du Planning familial). Plan B (2021) raconte la course contre la montre de Sunny, à qui un pharmacien oppose sa « clause de conscience » pour lui refuser la pilule du lendemain, et qui n’a d’autre choix que de filer au centre qui pratique des avortements le plus proche, à trois heures de route.
La question posée dans les films états-uniens n’est plus : « Va-t-elle décider d’avorter ? », mais plutôt : « Va-t-elle réussir ? »
Ces films n’imaginent pas un futur dystopique à la Handmaid’s Tale, où l’avortement serait partout interdit et criminalisé, mais choisissent le pragmatisme en montrant les conséquences de lois fédérales de plus en plus restrictives. La question n’est plus : « Va-t-elle décider d’avorter ? », mais plutôt : « Va-t-elle réussir ? ».
Pour Hélène Breda, tous ces récits modernes autour de l’IVG sont à la croisée des évolutions de l’industrie et de la société : « On constate à la fois l’émergence d’un nouveau système de production de fictions via les plateformes, l’avènement d’Internet et des réseaux sociaux (qui permettent de faire circuler des discours féministes relayés ensuite par les médias traditionnels), et enfin, l’ère #MeToo, où les ados grandissent avec un référentiel forcément différent. »
Les représentations progressent un peu, mais les clichés persistent beaucoup, notamment sur l’identité des personnes concernées. Dans la réalité, le profil type de l’États-unienne qui avorte est une femme noire, âgée de 25 à 29 ans, déjà mère et vivant seule sous le seuil de pauvreté. Elle avorte généralement par médicament. Pourtant, dans les fictions made in USA en 2022, la majorité des personnes qui avortent étaient des femmes blanches, issues de la classe moyenne ou supérieure, n’avaient pas d’enfant, et 6 % seulement recouraient à la pilule abortive.
La réalisatrice, productrice et scénariste états-unienne Shonda Rhimes fut pionnière en faisant avorter deux de ses héroïnes non blanches : Cristina Yang (Grey’s Anatomy, 2011), chirurgienne surdouée et carriériste, d’origine sud-coréenne, qui n’a jamais eu de désir d’enfant, puis Olivia Pope (Scandal, 2015), femme noire experte en relations publiques, qu’on voit allongée dans une clinique sur fond de chants de Noël. Quelques années plus tard, c’est la série Dear White People qui met en scène l’avortement d’une autre femme noire, Coco, étudiante narcissique et ambitieuse issue d’un milieu populaire, qui finit par refuser de répéter l’histoire familiale en sacrifiant ses études et ses rêves sur l’autel de la maternité.
En 1987, un film culte s’était déjà intéressé à l’IVG du point de vue de la classe : Dirty Dancing. Loin d’être une bluette apolitique, l’histoire du film, qui se déroule en 1963, repose entièrement sur l’avortement – clandestin – de Penny, danseuse précaire et partenaire de Johnny, que l’héroïne Bébé (issue de la bourgeoisie) vient remplacer. Un choix délibéré que la scénariste Eleanor Bergstein expliquait dans un article de Vice Magazine, en 2017 : « Si vous abordez un sujet politique dans votre film, vous avez intérêt à l’incorporer à l’histoire, sinon le jour viendra où on vous demandera de le supprimer. » À l’époque, poursuit-elle, « tout le monde m’a demandé pourquoi j’avais écrit un film qui se passait en 1963 avec un avortement clandestin, alors que l’arrêt Roe vs Wade était passé depuis. J’ai répondu que l’on n’aurait peut-être pas toujours la loi de notre côté. »
Lire aussi : Filmer l’avortement