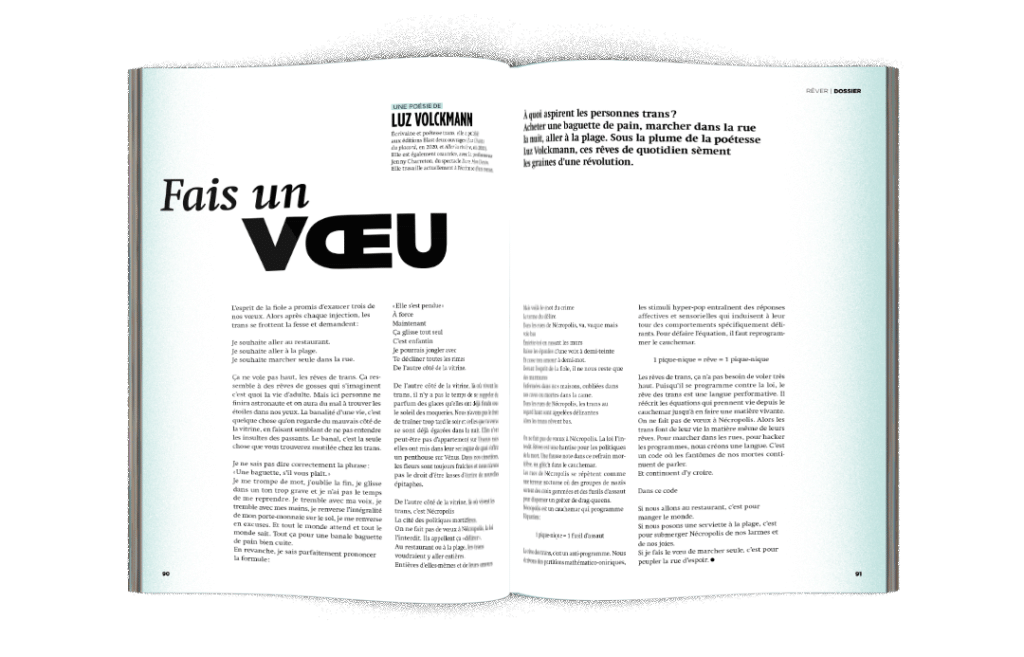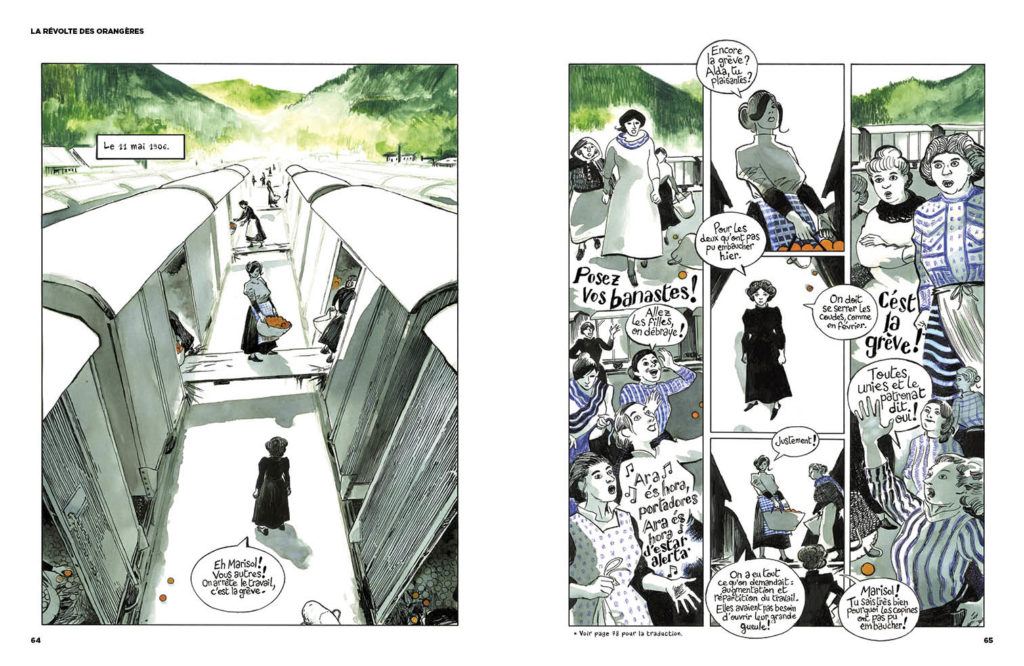L’encre gluante, d’un noir de jais, tranche avec la lame argentée de la spatule. On dirait du goudron. Belkis Ayón l’étale sur une matrice, qu’elle place ensuite entre deux grandes feuilles blanches.
Direction l’impressionnante presse mécanique qui trône dans son atelier et dont elle actionne la manivelle. Dans cette vidéo tournée à La Havane en 1998 (1), la plasticienne dévoile le processus de la collagraphie, une technique qui tient à la fois du collage – la matrice est composée de différents matériaux texturés : carton, toile, corde… – et de la gravure. De la presse mécanique sort une planche en noir, blanc et nuances de gris aux reliefs saisissants. Belkis Ayón, 31 ans sur ces images, est alors « au sommet d’une brillante carrière », explique Sylvie Mégevand, spécialiste d’iconographie cubaine, professeure émérite à l’université Toulouse-Jean-Jaurès [elle est aussi la mère de l’autrice de ces lignes]. « À Cuba, elle expose, enseigne, assure la curation d’expositions… »
La plasticienne, qui a grandi à La Havane dans une famille noire de la classe moyenne, est née en 1967, année hautement symbolique. En octobre est assassiné Ernesto Che Guevara, figure charismatique de la révolution qui a libéré Cuba du joug états-unien en 1959. Sur l’impulsion de Fidel Castro, son ex-compagnon de lutte devenu líder máximo, l’île entre alors dans une phase de soviétisation, c’est-à-dire de dépendance économique et politique à l’URSS (lire l’encadré en fin d’article). Ce qui n’empêche pas Cuba de cultiver ses spécificités, en particulier sur le plan culturel.
À peine trentenaire, Belkis Ayón obtient la vice-présidence de l’association des artistes plasticiens de l’Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (l’Uneac), qui regroupe auteur·ices, musicien·nes, plasticien·nes ou encore sculpteur·ices validé·es par le régime. Belkis Ayón, artiste officielle ? Michèle Guicharnaud-Tollis, professeure émérite de littérature et civilisation latino-américaines à l’université de Pau et des pays de l’Adour, contextualise : « À son arrivée au pouvoir en 1959, Fidel Castro a voulu alphabétiser les masses puis, très vite, promouvoir l’art, qui devait servir exclusivement la cause révolutionnaire. »
La plasticienne a directement bénéficié de cette politique en étant formée à la prestigieuse Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro, à La Havane, puis à l’Instituto Superior de Arte, créé en 1976 par le gouvernement. « La politique de propagande stimulait alors les arts graphiques et notamment celui de l’affiche, idéal pour reproduire à l’infini images et slogans », souligne Sylvie Mégevand, qui y voit un lien indéniable avec le choix de Belkis Ayón d’embrasser la collagraphie. Grâce à cette technique, alors que ses études sont à peine achevées, la jeune femme connaît un succès certain, avançant au pas du régime… en apparence.
Société secrète et messages cachés
« Propuesta a los Veinte Años » (Proposition à 20 ans), la première exposition importante de Belkis Ayón, se tient à La Havane en 1988. La plasticienne y présente de grandes planches ornées de mystérieuses silhouettes sans visage mais dotées d’immenses yeux scrutateurs. « Belkis Ayón donne corps aux personnages vénérés par l’Abakuá, une société secrète cubaine strictement réservée aux hommes hétérosexuels », explique Sylvie Mégevand en se référant à cette fraternité initiatique, également appelée Ñañiguismo, établie à Cuba dès 1836. « Le culte, fondé sur une tradition uniquement orale et musicale à base de tambours, est pratiqué à Cuba par les caïds des quartiers populaires, descendants des esclaves originaires du Calabar, dans le sud-est du Nigeria et à l’ouest du Cameroun actuels. »
Dans une interview de 1993, Belkis Ayón explique avoir découvert l’Abakuá durant ses études, en procédant à des recherches sur les religions afro-cubaines dans des ouvrages anthropologiques. « L’Abakuá est son thème quasi exclusif, ses livres de chevet y sont consacrés. On peut faire l’hypothèse d’une profonde quête de ses racines », analyse Sylvie Mégevand, qui y voit une importante transgression, dans une société qui refuse d’aborder le sujet des identités en dehors des classes sociales. « La révolution prétend avoir réglé toutes les inégalités, détaille Mélanie Moreau-Lebert, spécialiste de Cuba, maîtresse de conférences en civilisation hispano-américaine à l’université Bordeaux-Montaigne. Mais dans les faits, elles persistent, et Belkis Ayón, femme et noire, vit forcément à l’intersection du machisme et du racisme. On peut penser qu’elle utilise l’Abakuá, qui exclut et invisibilise les femmes et les homosexuels, comme miroir de la société cubaine. » L’artiste s’identifie d’ailleurs à l’unique personnage féminin du culte, la princesse Sikán, assassinée, selon la légende, par la communauté pour en avoir dévoilé le secret. Dans un texte de 1998, Belkis Ayón écrit : « Je me considère comme Sikán, une observatrice, une intermédiaire et une révélatrice. Sikán est une transgresseuse, et comme je la vois, je me vois. »
Lors d’une conférence en Allemagne en 2023, la critique d’art et curatrice Cristina Vives, amie de la plasticienne, explique que l’Abakuá, en tant que terrain artistique vierge, « lui a donné une liberté certaine […] pour exprimer les conflits de son temps », à l’époque où la moindre critique vaut censure et répression. Jamais, dans la décennie qui suivra cette première exposition, Belkis Ayón ne laissera filtrer de messages directement politiques. Au contraire, elle déclare « ne pas être féministe », tout en multipliant les représentations d’une Sikán dominante, et dit explorer le mythe abakuá pour « tendre vers l’universel », plutôt que pour défendre une perspective afro-descendante. Là encore, « une dichotomie typiquement cubaine entre le discours et la réalité », analyse Mélanie Moreau-Lebert.
Belkis Ayón en 7 dates
1967
Naissance de Belkis Ayón Manso à La Havane, à Cuba.
1986
Elle devient élève de l’Instituto Superior de Arte à La Havane, où elle enseignera par la suite.
1992
Ses expositions à l’étranger se multiplient : Brésil, États-Unis, Allemagne, Espagne, Pays-Bas…
1998
Elle devient vice-présidente de l’Asociación de Artistas Plásticos, au sein de l’Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac).
1999
Belkis Ayón se suicide avec le revolver de son père.
2016
L’exposition itinérante « Nkame » est présentée à Los Angeles. Suivront New York, Houston, Chicago…
2021
Première rétrospective européenne au musée Reina Sofía de Madrid, avec près de 50 collagraphies exposées.
À partir de 1991, alors que Belkis Ayón multiplie les expositions à Cuba, l’île s’enlise dans la récession. Le bloc de l’Est, seul allié d’une nation isolée politiquement et soumise à l’embargo états-unien, s’effondre. Tout vient à manquer, même chez les mieux loti·es : nourriture, médicaments, essence, vêtements… Fidel Castro décrète la « période spéciale en temps de paix », une crise économique si grave qu’on pourrait croire le pays en guerre. « Le besoin de création s’en est trouvé démultiplié », explique Michèle Guicharnaud-Tollis. D’abord, pour survivre : les habitant·es de l’île ont recours au « resolver », l’art de la débrouille à la cubaine, et au « riquimbili », le bricolage d’objets de récupération pour rendre le quotidien plus supportable. « Les artistes ont aussi davantage écrit, produit, comme si la pénurie de matériel avait créé un enrichissement intellectuel, note l’universitaire. Certain·es se sont mis·es à utiliser des petits objets, de la terre, des choses très simples pour créer leurs œuvres. »
Celles de Belkis Ayón, au contraire, sont de plus en plus imposantes, au point que certaines se muent en installations en trois dimensions, tandis qu’elles deviennent fragiles en raison de la baisse de qualité des matières premières. Ce qui ne les empêche pas de voyager. « Le marché de l’art cubain, comme tout le reste, périclite, poursuit Sylvie Mégevand. Cuba se tourne donc vers le marché international, ses biennales et ses mécènes, non sans difficultés du fait du blocus imposé par les États-Unis. »
Entre 1992 et 1997, les œuvres de la plasticienne sont exposées en Allemagne, aux États-Unis ou en Corée du Sud. Certaines sont acquises par le MoMa, à New York, ou le prestigieux Ludwig Forum für Internationale Kunst d’Aix-la-Chapelle. « La collagraphie est une technique originale ; les œuvres de Belkis sont d’une taille et d’une qualité plastique (détails, textures…) qui les rendent particulièrement remarquables aux yeux du public international, sans parler de leur thème qui aiguise sa curiosité. Il y voit sans doute aussi une concrétisation de l’arte povera (2), le retour attendu à un geste plus simple, plus direct », souligne la chercheuse.
Et pour cause : la condition des artistes cubain·es n’en finit pas de se détériorer. Après les vagues d’émigration postrévolution pour raisons politiques, c’est la misère que l’on fuit. « Pour figurer le sentiment d’enfermement qui les conduit à l’exil, les auteur·ices cubain·es ont souvent employé l’image d’un labyrinthe circulaire, d’une spirale sans fin », note Michèle Guicharnaud-Tollis, tandis que Sylvie Mégevand souligne la forme des dernières œuvres de Belkis Ayón. En 1998, elle réalise deux tondi, des formats ronds : My Vernicle o ¿tu amor me condena? (Mon vernis ou ton amour me condamne-t-il ?), qui représente une silhouette aux yeux exorbités sur fond de puzzle, et Déjame salir (Laisse-moi sortir), dont le personnage repousse le cadre de ses paumes tendues vers le public, tandis que des flammes semblent le dévorer.
(Re)découvrir Belkis Ayón
Lorsqu’elle se suicide le 11 septembre 1999, l’artiste ne laisse ni lettre, ni indices autres que ceux que l’on croit trouver a posteriori dans ses collagraphies. Il faut ensuite cinq ans à ses proches, en collaboration avec les instances officielles, pour créer la Belkis Ayón Estate (l’Estate de Belkis Ayón en espagnol), une fondation dont le but est de « promouvoir, préserver et restaurer son œuvre » – en particulier, les fragiles matrices dispersées à travers le monde. Un travail assuré par sa sœur, Katia Ayón, disparue en 2019, son amie Cristina Vives, son beau-frère, Ernesto Leyva, et, désormais, sa nièce, Yadira Leyva Ayón. En tout, dix-sept années s’écoulent entre la mort de l’artiste et les premiers grands événements internationaux commémoratifs hors de l’île, « où l’on présente volontiers Belkis Ayón comme une “découverte”, malgré la reconnaissance dont elle bénéficiait de son vivant, en particulier en Amérique latine », pointe Sylvie Mégevand.
À partir de 2016, la rétrospective itinérante « Nkame » (« Salutations » dans la communauté abakuá) parcourt les États-Unis, symbole de la détente des relations sous Barack Obama, avant que de nouvelles sanctions trumpiennes, toujours en vigueur, ne s’abattent sur Cuba (lire l’encadré ci-dessous). En Europe, c’est le musée Reina Sofía de Madrid qui accueille la rétrospective « Colografías » en 2021.
La Belkis Ayón Estate est par ailleurs très active dans sa communication : site Internet fourni, posts Instagram accompagnés des hashtags #colografía et #ArteCubano… L’accès à Internet, qui se démocratise à Cuba, est à double tranchant pour le régime : il peut servir à promouvoir la culture insulaire autant qu’à propager la contestation. « Sous la présidence de Miguel Díaz-Canel, au pouvoir depuis 2018, les règles se sont à nouveau durcies : plus possible de créer sans validation du projet par le ministère de la Culture, explique Mélanie Moreau-Lebert. La contestation, portée par des artistes et des personnes LGBT+, et baptisée “Movimiento San Isidro”, gêne beaucoup les autorités du fait de la viralité de certaines de ses actions. »
Dans ce contexte, Belkis Ayón devient un symbole politique, elle qui est restée à Cuba, quand tant d’autres fuyaient vers Miami, New York ou Madrid, et qui n’a jamais frontalement critiqué le régime. « Au-delà d’un effort mémoriel sincère, il y a aujourd’hui une volonté des autorités cubaines de faire de Belkis Ayón un modèle dans ce contexte de résistance, analyse Sylvie Mégevand. Si, en Occident, on la voit volontiers comme une figure créatrice puissante qui coche toutes les cases de l’intersectionnalité, à Cuba, on en parle comme d’un exemple de créativité, de travail et d’abnégation pour la jeunesse. » Une source d’inspiration toute relative pour le peuple : depuis 2022, 533 000 personnes se sont exilées pour les États-Unis, soit près de 5 % de la population cubaine. Prodige des institutions, transgresseuse masquée ou martyre qui ne dit pas son nom, c’est depuis une île désenchantée que rayonne désormais Belkis Ayón.
Cuba, vie et mort des utopies
C’est en 1902 que l’île caribéenne, ex-colonie espagnole, obtient l’indépendance. Mais l’influence économique et politique des États-Unis ne cesse de croître, en même temps que les inégalités. L’été 1953 signe le début de la révolution avec, à sa tête, Fidel Castro. Six ans plus tard, elle vient à bout de la dictature de Fulgencio Batista, à la solde des États-Unis. Fidel Castro devient le tout-puissant leader de la République de Cuba.
C’est d’abord la censure et la répression qui poussent à l’exil, de façon illégale et souvent périlleuse, une partie de la population, à commencer par des intellectuel·les, des artistes et des homosexuel·les. En 1991, l’effondrement de l’URSS entraîne une crise économique dont l’île, par ailleurs asphyxiée par l’embargo états-unien mis en place en 1962, ne se relèvera pas. En août 1994, plus de 30 000 Cubain·es tentent de gagner la Floride, à seulement 144 kilomètres au nord, à bord de radeaux de fortune. En 2016, Fidel Castro meurt à 90 ans. Son frère, Raúl, assure la relève jusqu’à ses 89 ans, puis passe la main à son disciple, Miguel Díaz-Canel, en 2018. Au durcissement idéologique qu’il impose s’ajoutent les 190 nouvelles sanctions contre Cuba prises durant la mandature de Donald Trump : les croisières touristiques états-uniennes sont de nouveau interdites, les transferts d’argent des exilé·es à leurs proches resté·es sur l’île fortement limités. En janvier 2021, quelques jours avant la fin de son mandat, le président républicain, farouchement anticommuniste, remet même l’île sur la liste des pays soutenant le terrorisme. Il faut attendre mars 2024 pour que le secrétaire d’État Antony Blinken l’en retire. Présenté comme une main tendue de l’administration Biden à l’égard de Cuba, le geste a en fait suscité l’ire des nations caribéennes, pour qui cette décision est un leurre visant à détourner l’attention des sanctions économiques et commerciales qui, elles, sont encore bien d’actualité, et continuent à asphyxier le pays.
(1) Ce très court documentaire est visible sur YouTube sous le titre “Belkis Ayón. A Documentary Video Work in Progress”, sur la page du Fowler Museum at UCLA.
(2) Mouvement né en Italie, l’arte povera (art pauvre) revendique une approche épurée de la création plastique : l’œuvre créée se caractérise par la sobriété des moyens, à l’inverse de la sophistication du pop art et de la société consumériste que celui-ci célèbre.