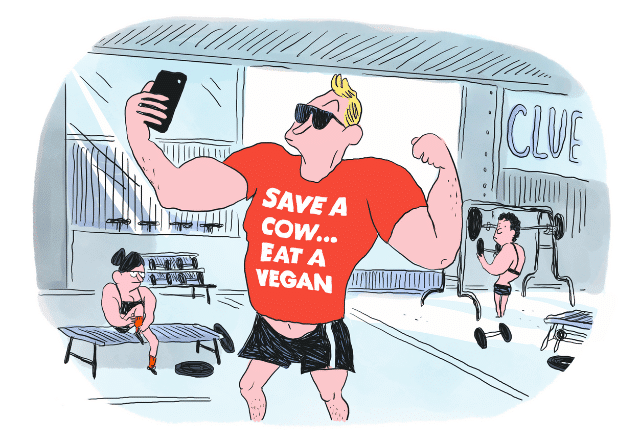Dans le hall de la maison de l’écologie populaire Verdragon à Bagnolet en Seine-Saint-Denis, Bintou Dembélé improvise un petit salon pour discuter. Sourire solaire, bonnet bleu sur la tête, elle s’installe face à nous, jambes croisées : « J’ai investi ce lieu en résidence à l’invitation de Fatima Ouassak¹ en juin, ça permet de garder un lien avec les habitants. Ça me rappelle mes débuts dans le hip-hop en MJC [Maison des Jeunes et de la Culture]», explique-t-elle. Du haut de ses 47 ans, cette femme affable à la parole réfléchie et généreuse est l’une des figures les plus importantes de la danse en France.
Battles hip-hop, scènes de danse contemporaine, clips de stars de la chanson ou Opéra de Paris, Bintou Dembélé a investi une multitude d’espaces aux antipodes, tout en façonnant une pensée politique liée à la colonisation dans des spectacles où résonnent gestes, voix et musique. Pionnière du hip-hop ? Chorégraphe contemporaine ? Artiste militante ? Bintou Dembélé refuse de se laisser enfermer dans une définition. Toujours en mouvement, cette artiste traverse plusieurs mondes sans jamais se fixer, esquivant les stéréotypes qu’on voudrait lui coller. Elle revendique une identité mouvante et s’efforce de faire bouger les structures existantes. Une manière peut-être de chercher sa place, ou plutôt d’en inventer une, quand elle n’est pas évidente à trouver, en France, pour une femme artiste noire et queer de banlieue issue de la culture hip-hop.
Le hip-hop comme refuge
Gamine pas bavarde, walkman vissé sur la tête, elle rencontre la communauté hip-hop à dix ans à peine et esquisse ses premiers pas de danse à la MJC : « La danse était mon mode de socialisation et d’expression corporelle. Au fond, ce qui me plaisait, c’était d’avoir cette liberté de m’approprier une façon d’être et de pouvoir communiquer avec les autres », se rappelle-t-elle. Pour celle qui a grandi à Brétigny-sur-Orge, avec des parents d’origine sénégalaise et quatre frères et sœurs, s’immerger dans la culture hip-hop a permis de « faire communauté et refuge » dans un environnement qu’elle décrit marqué par des tensions avec les skinheads. De groupe en groupe, souvent accompagnée de son frère Ibrahim (lui aussi danseur), elle rejoint Aktuel Force en 1993, où elle affine sa pratique du break, un style connu pour ses figures acrobatiques au sol. En 1994, elle danse la house et le new style avec Mission Impossible. Puis elle monte Ykanji, dont l’un des membres, Bruce, est désormais le célèbre leader de la compétition et de l’école Juste Debout, fer de lance du hip-hop en France.
Malgré ce parcours, exister en tant que femme dans un environnement majoritairement masculin est une gageure, commente Naïma M., une sœur de danse, avec qui elle avait fondé le crew de femmes Lady Side en 1999 : « On était peu de filles dans le milieu. On nous identifiait souvent comme “la sœur de” ou “l’élève de”. On a eu ce besoin de créer quelque chose entre nous, pour partager ce vécu de femme de parents immigrés. Et de représenter l’esprit féminin dans la culture et la danse hip-hop, c’était une grande fierté », se souvient cette danseuse passionnée de 49 ans.
Danser à la recherche d’une identité
Pour Bintou Dembélé, qui se dit « mi-homme mi-femme, ni homme ni femme », cet investissement dans la culture hip-hop ouvre des questionnements non seulement sur son genre, mais de manière plus générale sur son identité. Peu après une blessure qui l’empêche de danser, elle prend conscience de la violence que les figures de break imposent à son corps : « C’était proche de l’autodestruction, je ne pouvais pas continuer de cette manière ça si je voulais continuer à danser. Au-delà, je me suis demandé ce qui me faisait danser comme ça. Pourquoi nous imposons-nous tant de violence ? Je me suis rendu compte que ce hip-hop-là m’empêchait d’évoluer et j’ai cherché le sens de cette façon d’être. C’est passé par une recherche d’africanité, d’intimité et de prise d’espace », explique-t-elle.
Celle qui avait déjà côtoyé les scènes contemporaines, notamment avec la compagnie Kafig du chorégraphe Mourad Merzouki, y débarque à nouveau en montant la structure Rualité en 2002. Prenant pour point de départ son expérience dans le hip-hop, elle enquête sur la façon dont notre inconscient collectif est imprégné d’un passé esclavagiste et colonial. Elle procède en faisant des liens entre les époques, et fait ainsi jaillir les non-dits du colonialisme, comme dans Z.H en 2013, où elle fait référence aux zoos humains².
« J’avais besoin de me retrouver et de me construire seule. C’était comme un passage à la mort
et une renaissance. »
Bintou Dembélé
Elle décide alors de prendre son indépendance par rapport à la communauté hip-hop. Ce tournant professionnel coïncide aussi avec son installation dans un appartement parisien. Elle quitte ainsi les familles qu’elle s’était choisies à travers la pratique de cette danse : « En tant qu’artiste, j’avais besoin de me retrouver et de me construire seule. C’était comme un passage à la mort et une renaissance. J’ai beaucoup appréhendé ce moment. »
Pour autant, la chorégraphe ne rompt pas totalement avec ses premières amours, vers lesquelles elle s’autorise à revenir régulièrement. Mais surtout, elle s’interroge sur sa propre démarche. Cette recherche de sens l’amène à croiser plusieurs universitaires. En 2013, elle rencontre Isabelle Launay, enseignante-chercheuse au département danse de l’université Paris 8 à Saint-Denis, avec qui elle amorce une collaboration. « Bintou est une artiste chercheuse et c’est à l’endroit de la réflexion et de la recherche que l’on s’est trouvées. Elle avait un désir d’histoire et de construction de nouveaux récits, moi un désir de déconstruction et d’ouverture du champ historique », raconte cette historienne de la danse. Leurs échanges l’ont amenée à repenser les contours de l’histoire du hip-hop en France, souvent réduits à une influence états-unienne, et à affiner les récits établis par la recherche jusqu’ici.
Lors du colloque où Isabelle Launay et Bintou Dembélé se sont vues pour la première fois, la question de la place a tout de suite été abordée. « Je lui ai demandé pourquoi elle refusait de se définir comme artiste ou chorégraphe du champ contemporain, pourquoi elle ne se sentait pas à l’aise avec cette étiquette. Et j’ai bien compris ses raisons : le champ du contemporain n’a pas octroyé une juste place à toutes les danses qui venaient de la rue et des périphéries », détaille la chercheuse.
Le marronnage, pour se recréer des espaces de liberté
« Son parcours est diversifié et loin d’être homogène. Elle traverse le milieu du hip-hop, des danses de rue, de l’art contemporain, de la musique… », ajoute Isabelle Launay. Si Bintou Dembélé refuse la qualification de chorégraphe, c’est qu’elle définit plutôt sa pratique comme une alliance de danse, de voix et de musique, en accord avec la culture hip-hop dont elle est issue et qui ne fait pas de différence entre danse, graffiti, DJing³ et rap : « Quand je me suis professionnalisée, m’appeler compagnie et dire que je faisais de la création chorégraphique ne me convenait pas. Je me suis demandé pourquoi. Pour moi, c’est clair que c’est l’institutionnalisation, la professionnalisation et le déplacement de l’underground sur les scènes qui ont dissous la relation avec toutes ces disciplines », poursuit Bintou Dembélé. À défaut d’enfermer sa démarche artistique dans une étiquette unique, elle revendique, en référence aux communautés libres constituées par les esclavisé·es⁴, le terme de « marronnage⁵ ». Une manière d’être au monde, en lien avec l’histoire coloniale qui continue d’habiter les êtres et de façonner les identités, et une ruse pour « se recréer des espaces de liberté ».
Pour Mame-Fatou Niang, maîtresse de conférences en littérature française et francophone à l’université Carnegie Mellon en Pennsylvanie, la rencontre avec Bintou Dembélé marque un tournant dans les recherches qu’elle a menées pour réaliser le documentaire Mariannes noires, sorti en 2016. Cette spécialiste de la question noire, de l’antiracisme et de l’universalisme français voit dans la démarche de l’artiste une manière de perturber les cadres qu’imposerait une identité française immuable : « Le cadre républicain français est connu pour être assez strict. La Constitution dit que la République est une et indivisible. À travers l’idée du marronnage, Bintou Dembélé vient perturber cette conception. Elle change en permanence. Plutôt que d’entrer dans les cadres préétablis en les laissant intacts, elle les traverse et en fait bouger les lignes. » Et l’amie de l’artiste d’ajouter : « En tant que Françaises afro-descendantes, dans un pays où il règne un tabou sur la colonisation, il y a quelque chose d’indicible qui fait qu’on ne sera jamais vraiment d’ici. Alors il faut se définir toutes seules. »
La scène comme moyen de recréer un rituel
S’il y a un lieu où Bintou Dembélé a imprimé sa marque, c’est l’Opéra de Paris. Avec le metteur en scène Clément Cogitore, elle a secoué la massive institution française en proposant une adaptation explosive de l’opéra-ballet Les Indes galantes, créé en 1735 par le compositeur baroque Jean-Philippe Rameau. D’abord à travers une vidéo (en 2017), puis un spectacle (en 2019), elle a réécrit ce blockbuster baroque avec trente danseur·euses de krump⁶, de voguing⁷ et de hip-hop, actualisant au passage la partition musicale : « Je me suis aussi emparée du livret pour tordre le récit problématique de cette pièce, qui était initialement créée pour célébrer les comptoirs coloniaux », rappelle-t-elle. Elle garde un bon souvenir de cette aventure au cours de laquelle elle parvient à décrocher un contrat pour les danseuses et danseurs qui ne disposaient pas du statut d’intermittent·e.
« J’avais en tête de former un cercle qui inclue tout le monde. Je voulais que les spectateurs soient comme les témoins d’un rituel. »
Bintou Dembélé
Cet événement a connu une résonance médiatique fulgurante : l’institution conservatrice de la danse classique ouvrait pour la première fois ses portes à une femme noire chorégraphe. Mais pour Bintou Dembélé, les enjeux étaient autres : « J’avais en tête de former un cercle qui inclue tout le monde. Je voulais que les spectateurs soient comme les témoins d’un rituel », détaille-t-elle. Par « rituel », la chorégraphe entend « un rite de passage sacré », une pratique qui, au fil des déplacements de population contraints, de l’esclavage et des vagues de migration, aurait été disloquée, catégorisée, appropriée et vidée de son sens.
Questionner les stéréotypes plus que les dénoncer
Michel Onomo, dit « Meech », faisait partie du casting des Indes Galantes. Deux ans plus tard, il danse pour Bintou Dembélé dans Rite de passage – Solo II. Ce concept de « rituel » résonne fort pour cet enfant du hip-hop, star des battles, chorégraphe et formateur qui s’est intéressé à la danse aux États-Unis et dans plusieurs pays d’Afrique. Ensemble, il et elle se replongent dans des manières de danser qui leur sont chères, éprouvées lors de leurs débuts hip-hop : « Le rituel a été présent dès l’écriture du spectacle, où l’on passait l’un devant l’autre, comme un entraînement à l’ancienne. On a réinventé notre manière d’écrire ! » raconte le danseur, ému. Il décrit une relation horizontale rare avec celle qu’il considère autant comme sa chorégraphe que comme sa grande sœur.
Car si elle n’hésite pas à tordre les institutions et les manières de penser, à questionner les stéréotypes plutôt que de se contenter de les dénoncer, Bintou Dembélé ne cesse de sceller des alliances et de transmettre des savoirs. À la maison Verdragon, on pourra bientôt se plonger dans les archives de sa période hip-hop, qu’elle a rassemblées à côté d’ouvrages donnés par le Musée national de l’histoire de l’immigration et par le Centre national de la danse. Une manière de confier à d’autres cet héritage, tout en continuant de tracer son propre chemin. •
1. Voir sa bio en ouverture du débat dans lequel elle intervient, page 114.
2. Dans cette pièce pour six danseur·euses, Bintou Dembélé explore la curiosité et le voyeurisme que suscitait la figure du « sauvage » lors des expositions universelles du xxe siècle, et comment cet héritage résonne encore dans les représentations actuelles.
3. Le DJing peut se définir comme l’art de sélectionner et de diffuser de la musique sur des platines lors d’événements publics.
4. Nous empruntons ce terme à Bintou Dembélé qu’elle préfère à celui d’« esclave ».
5. À l’époque coloniale, les marron·nes désignaient les personnes esclavisées qui fuyaient les plantations pour établir de nouvelles communautés, souvent dans des forêts situées à proximité. Le marronnage qualifie une forme de résistance et d’émancipation collective.
6. Lire l’encadré page 88.
7. Autre danse urbaine, le voguing a vu le jour aux États-Unis dans les années 1970, au sein des communautés LGBT+ racisées. Il s’inspire des poses des mannequins sur les podiums. Voir le portfolio page 100.