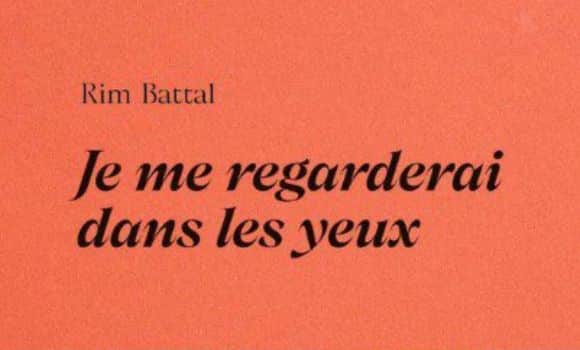Ce n’est pas la première fois que vous vous rencontrez : vous vous connaissez depuis longtemps.
ALICE ZENITER Camélia est une artiste que j’ai l’impression d’avoir vue grandir.
Elle peut s’emparer de n’importe quelle chanson et la rendre tellement vibrante qu’on a le sentiment que c’est la chanson qui nous a accompagné·e toute notre vie, ou celle qui nous manquait jusqu’ici. Et politiquement, je l’ai vue se déployer très tôt. J’admire énormément la manière dont elle a pris sa place en restant toujours debout, toujours droite.Vous-même avez été précoce avec un premier roman, Deux moins un égal zéro, publié à l’âge de 16 ans.
ALICE ZENITER J’ai commencé jeune ma carrière d’autrice, mais en ce qui concerne les questions politiques, j’ai été beaucoup moins exposée que Camélia dans les médias. Il faut déjà avoir atteint un certain stade de célébrité dans le champ littéraire pour être invité·e à réagir sur un sujet d’actualité.
N’est-ce pas en train de changer ? Diaty Diallo, dont le premier roman, Deux secondes d’air qui brûle (Seuil, 2022), raconte l’embrasement d’une cité suite à des violences policières, a expliqué avoir été très sollicitée par les médias après la mort de Nahel (1).
CAMÉLIA JORDANA C’est vrai qu’aujourd’hui, il y a une telle radicalisation dans le traitement médiatique des personnes racisées, qu’à la seconde même où l’une d’entre elles bénéficie d’une notoriété, on lui demande tout de suite d’avoir une parole publique, de se positionner. C’était déjà le cas au début de ma carrière, mais je pense que c’est devenu plus violent désormais. J’avais 17 ans quand, pour la promo de mon premier album post-« Nouvelle Star », je me suis retrouvée à « On n’est pas couché », l’émission de Laurent Ruquier, aux côtés notamment d’Éric Naulleau, Éric Zemmour, Jean-François Copé, Jean-Marie Bigard et Luc Besson ! Une part de moi sentait le bain de tension dans lequel j’arrivais, et en même temps j’avais une forme d’inconscience.
ALICE ZENITER Si on ne m’a pas autant sollicitée sur certaines questions, c’est aussi parce que j’ai un white passing (2) de malade. Personne ne pensait que j’étais franco-algérienne ! En 2010, dans Jusque dans nos bras (3), je mettais en scène une jeune femme, Alice, issue de l’immigration et qui fait un mariage blanc avec son meilleur ami malien. Mais à l’époque, contrairement à toi, Camélia, on ne m’a pas demandé de me positionner, de dire ce que je pensais du port du voile. Jusqu’à l’âge de 27, 28 ans, je me suis protégée, et c’est avec L’Art de perdre (4) que j’ai fait mon outing en tant que fille d’immigré·es. Ne plus pouvoir choisir qui sait que tu es à demi-bougnoule et qui ne le sait pas, c’est une chose dont j’ai mesuré les effets assez tard dans la vie. Sur le moment, l’évocation de cette identité m’a permis de faire entendre qu’une partie des mien·nes n’existait pas en littérature, et que je voulais pouvoir créer des récits de référence pour les femmes comme moi, pour les enfants issus de l’immigration, qui avaient grandi sans représentations dans les livres de leur père, de leur mère, de leurs oncles et tantes. Mais à partir de là, j’ai aussi commencé à avoir des retours très désagréables, surtout de la part de vieux messieurs blancs qui me disaient que j’étais un peu radicale dans ma condamnation, puisque j’étais moi-même la preuve des bienfaits de
la colonisation…
CAMÉLIA JORDANA Tu crachais dans la soupe, quoi !
ALICE ZENITER Finalement, cet outing a accéléré ma compréhension politique de l’ampleur systémique du racisme. J’ai commencé à expérimenter des choses que je ne connaissais que de manière très théorique. Mais L’Art de perdre, c’est aussi le moment où beaucoup de gens m’ont dit qu’à travers ce roman, ils avaient compris que ce qu’ils croyaient être des traits propres à eux ou à leurs familles, c’était en fait une angoisse partagée par l’ensemble des immigré·es, ou une pression subie par nombre d’enfants de la deuxième génération.
Est-ce pour cela, Camélia Jordana, que vous avez dit un jour que L’Art de perdre avait été « un grand cadeau » ?
CAMÉLIA JORDANA En plus de la grâce avec laquelle Alice a écrit, inventé, pensé, construit ce roman, elle est la seule à être parvenue à combler ce que j’appelle un endroit de vide.
« Il ne nous reste que notre gueule. Cette gueule qui fait que tu n’es pas admis·e, que tu n’es pas accepté·e, que tu déranges, que tu es microagressé·e quotidiennement, c’est tout ce que t’as. »
Camélia Jordana
Est-ce que l’histoire de votre grand-père, référent local du Front de libération nationale pendant la guerre d’Algérie, faisait l’objet d’un tabou dans votre famille ?
CAMÉLIA JORDANA Pas tout à fait, car même si on ne parlait absolument pas de ce passé, mon grand-père était une figure de référence, chez nous autant que dans la communauté musulmane du sud de la France. Mais quand j’évoque ce vide comblé par L’Art de perdre, c’est qu’avec ce grand-père, la barrière de la langue m’empêchait d’échanger plus de trois mots. Je fais partie de la première génération qui a subi cette rupture linguistique qui casse les liens. Je trouve que le plus dur, au quotidien, ce n’est pas forcément le fait de ne pas se sentir chez soi quand on est là-bas, ni de ne pas se sentir reçu comme chez soi quand on est ici. Le plus douloureux, c’est d’être déraciné·e jusque dans la langue, de ne pas pouvoir entrer en relation avec les siens. C’est ça, l’endroit de vide. Et comme il n’y avait pas d’échange possible, il n’y avait même pas, avant que je découvre L’Art de perdre, de curiosité de ma part par rapport à cet endroit de mon identité. Ce silence-là, il est hérité d’une injonction coloniale qui a consisté à interdire aux gens de parler leur langue, de s’appeler par leur nom, qui a invisibilisé jusqu’aux noms des rues. Pour le dépasser, pour s’autoriser à interroger cette histoire coloniale, il faut avoir la volonté d’entamer un travail de déconstruction.

CAMÉLIA JORDANA Il y a la question de la complicité, du partage au quotidien, mais aussi le fait que le seul lien à nos racines passe par ces gens-là, avec lesquels on ne sait pas parler. C’est-à-dire qu’il ne nous reste que notre gueule. Cette gueule qui fait que tu n’es pas admis·e, que tu n’es pas accepté·e, que tu déranges, que tu es microagressé·e quotidiennement, c’est tout ce que t’as. Et encore. Moi, ça fait deux ans qu’officiellement je porte mes cheveux frisés, et un an que je ne veux plus les raidir, sauf pour le travail. Ça m’a pris presque trente ans, toute une vie, pour en arriver là ! C’est névrotique, ce rapport à notre féminité et à notre beauté qui passe par le white washing (5) total de nos physiques. Donc, il n’y a pas seulement la disparition de notre langue et l’invisibilisation des héroïnes et des héros de notre culture : ça va jusqu’à nos gueules. C’est une forme de négation totale. Et on a beau tout faire pour « s’intégrer » – même si là, on parle carrément d’assimilation –, ça ne change rien.
« Je ne choisis pas de faire de politique : je suis un être politique parce que je suis une femme et que je suis racisée. »
Camélia Jordana
On se trouve au palais de la Porte-Dorée, qui a servi autrefois la propagande coloniale française (lire l’encadré p. 20). Comment appréhender la violence mémorielle que dégage ce lieu ?
ALICE ZENITER Cette violence-là, il faut qu’elle soit montrée et vue, car c’est une réponse à la proposition de loi sur les bienfaits de la colonisation (6). Ce musée devrait être beaucoup plus visité, car il dit la vérité des expéditions coloniales : les êtres humains colonisés y sont représentés n’importe comment, et les matières premières qui ont été pillées et exploitées sont partout. Ça raconte clairement que ce n’est pas pour l’idéal des Lumières que la France a mené une telle entreprise.
CAMÉLIA JORDANA C’est assez déstabilisant de constater le déficit de prise de conscience, de connaissance et de transmission concernant la colonisation. Je me demande comment réussir à mener mon travail intime de mémoire, quand je vois à quel point le travail collectif sur ces sujets se fait à reculons.

CAMÉLIA JORDANA Oui, tout le temps. Je pense que j’ai toujours été intransigeante, mais au fil du temps, ma vigilance s’est accrue : quand je participe à un projet, par exemple cinématographique, je suis très attentive aux questions de représentation, je pointe certaines choses en donnant des références et en essayant de transmettre, justement. Ce travail de pédagogie est obligatoire. C’est comme faire un shooting photo avec mon afro – même si, pour celui que j’ai fait ce matin avant de venir ici, j’ai dû accepter de me lisser les cheveux, à mon grand regret !
ALICE ZENITER Moi aussi, j’ai changé des choses dans la pratique de mon métier, notamment depuis L’Art de perdre. Je ne referai pas de livre qui ne passe pas le test de Bechdel (7). Je ne referai pas de livre en étant complètement imprégnée de l’idée qu’un grand roman, ça comprend un homme blanc conquérant, et donc que mes héros doivent y ressembler. Ou que ce n’est pas possible de créer un personnage de loseur sympathique qui soit une femme, qu’on va forcément lui en vouloir. Je ne referai plus de roman où tout le monde est blanc.
Lire aussi : Alison Bechdel : Gouine Power
« Ne plus pouvoir choisir qui sait que tu es à demi-bougnoule et qui ne le sait pas, c’est une chose dont j’ai mesuré les effets assez tard dans
la vie. »
Alice Zeniter
Camélia Jordana, dans vos chansons, vous évoquez les violences policières, vous parlez de féminisme. On vous a aussi entendue sur la réforme des retraites. Revendiquez-vous l’étiquette d’« artiste engagée » ?
CAMÉLIA JORDANA Je ne choisis pas de faire de politique : je suis un être politique parce que je suis une femme et que je suis racisée. Que je le veuille ou non, ça impacte mon art. Je ne comprends pas l’art désengagé. Je respecte le choix de certain·es de ne pas questionner, dans leurs créations, leur rapport au monde, mais moi, j’en suis incapable, car c’est la seule manière que j’ai d’y survivre.
ALICE ZENITER Je suis moins tolérante que toi. Plus ça va, plus je me dis que l’art apolitique n’existe pas. Il y a une posture qui me paraît être un acquiescement au monde tel qu’il est. C’est une manière de dire : « Les inégalités telles qu’elles sont me conviennent, je voudrais juste pouvoir en profiter. »
L’une et l’autre, vous êtes adoubées par vos pairs, par la critique et par le public. Est-ce que cette légitimité facilite vos prises de parole ?
CAMÉLIA JORDANA C’est vraiment sur le fil. Je bénéficie d’assez de lumière pour pouvoir prendre la parole sur certains sujets. En revanche, si j’ai acquis cette reconnaissance, c’est parce que j’ai parfaitement endossé le costume qui permet de prendre une telle place. Et prendre la parole me coûte extrêmement cher. Quand en 2020, chez Ruquier à nouveau, au milieu d’une foule de sujets politiques, j’ai parlé des violences policières, ça a fait une énorme polémique (8). Je venais de sortir un album, et j’ai perdu des programmations télé et radio, des interviews, des concerts… Les présentateur·ices qui me recevaient étaient cyberharcelé·es par la fachosphère. Donc, j’ai beau avoir fait tout ce qu’il fallait pour entrer dans ce système, quand je parle depuis ma place de femme racisée, on me le fait payer.
ALICE ZENITER L’ampleur de ce qu’on prend dans la gueule quand on s’exprime sur ces sujets-là est liée, d’une certaine manière, au fait qu’« on n’a pas signé pour ça ». Je suis une autrice étudiée au bac. Je représente l’entrée dans le patrimoine, donc à un moment donné, ça m’assied. Mais ça fait deux fois que je refuse une interview dans la matinale de France Inter, parce qu’en prenant la parole sur des sujets de société dans un format qui ne me convient pas, je risque de me faire défoncer sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas aller m’exposer comme ça. Je veux bien qu’on me défonce quand je parle du racisme, comme je continuerai de toute façon à le faire, mais laissez-moi le faire dans une forme dont je sois fière.

Avez-vous craint d’être instrumentalisées ?
ALICE ZENITER Quand j’ai publié mes deux premiers romans, à 16 et 23 ans, bon nombre d’articles disaient que j’étais « un exemple parfait d’intégration ». Pendant un temps, je me suis sentie valorisée par ça. Mais j’ai toujours trouvé très dur de tenir une espèce de double discours : évidemment qu’une trajectoire sociale comme la mienne est possible, puisque je suis là. Mais ça amène mes interlocuteurs blancs et bourgeois à se sentir très à l’aise, à croire que leur système fonctionne, qu’il est accueillant.
CAMÉLIA JORDANA Et que les autres ne font pas assez d’efforts !
ALICE ZENITER Dans le système de représentation de l’immigration en France, j’ai clairement gagné la partie, je fais partie des gens qui ont fait un double-six. Mais à côté de ça, la violence est telle, l’étouffement est si permanent, que même avec un double-six, moi, je dis que ça n’en vaut pas la peine. Arrêtez de vous sentir à l’aise avec le fait que quelques-un·es d’entre nous parviennent à tirer un double-six !
CAMÉLIA JORDANA Le système est aussi convaincu que notre double-six nous immunise contre les micro-agressions. Mais je vous donne un petit exemple, une histoire qui m’est arrivée récemment. Ma chienne a été blessée par un sanglier. Je débarque à la clinique, accompagnée par un ami marocain. La dame de l’accueil s’approche, je pense qu’elle m’a reconnue, et tout ce qu’elle trouve à dire pour rassurer ma chienne, c’est : « Il était méchant, ce cochon, c’est sûr qu’il n’était pas halal ! » Tu imagines le trajet dans sa tête ?! C’est quand même énorme : elle a vu « sanglier », elle a vu « arabe », et donc elle a fait le lien avec « cochon », « musulman », et donc « halal »… Le tout en une fraction de seconde, de la part d’une personne qui n’était même pas mal intentionnée ! Voilà comment on est renvoyé à la gueule qu’on a. Alors aujourd’hui, je refuse d’être prise comme exemple. Même si à un moment, j’étais fière d’avoir ce rôle, je crois. C’est le même principe que le patriarcat : quand on t’a seriné que la seule chose qui compte, c’est d’être belle et choisie par les hommes, devenir un trophée est une grande fierté. Être racisée, c’est pareil : quand tu as coché toutes les cases de l’assimilation pour t’intégrer, tu es hyper heureuse, à 18 ans, de parler de ta bibliothèque sur France Culture.
ALICE ZENITER Avant, j’avais toujours l’impression de jongler avec trop d’assiettes à la fois. Il y a ce sentiment de responsabilité, mais tu veux aussi montrer que tu n’as pas changé d’équipe ; que tu as beau avoir passé tous les stades de la validation, tu ne te réveilleras jamais un matin sans être une femme et sans être arabe. Cela dit, je trouve aussi que l’attention bienveillante de certains
médias aide à faire passer certaines choses.
Est-ce qu’attirer et conserver la sympathie du public, quand on est une femme racisée, ça nécessite d’en faire plus, de sourire davantage ?
ALICE ZENITER Les gens m’ont vue grandir, comme Camélia. Tu les sens à deux doigts de te pincer les joues en te disant que tu es mignonne. Pendant un temps, ça m’a énervée, mais maintenant je me dis que, stratégiquement, ça m’aide, car je peux tenir un certain nombre de discours qui autrement me rangeraient dans la catégorie hystérique, méchante ou radicalisée. Donc tout en souriant et en parlant gentiment, je peux dire : « Le système est raciste » ! Et c’est là que réside ma marge de manœuvre, c’est là que je tente d’emporter la conviction.
« Tu as beau avoir passé tous les stades de la validation, tu ne te réveilleras jamais un matin sans être une femme et sans être arabe. »
Alice Zeniter
CAMÉLIA JORDANA Malheureusement, si pour avancer dans le système en question, une femme blanche doit sourire, être belle à regarder et un peu mystérieuse, nous, on doit redoubler de sympathie, car chez nous, femmes racisées, le mystère fait peur. Il faut montrer qu’il n’y a pas de danger, pas de vice, se présenter comme la personne la plus aimable et la plus arrangeante, plus encore que n’importe quelle femme socialisée de cette manière depuis l’enfance.
Alice, vous n’avez donc pas opté pour la « parade virile » des artistes masculins, une formule empruntée à la romancière Julia Kerninon, que vous mentionnez dans Toute une moitié du monde ?
ALICE ZENITER Clairement, mon éducation m’a permis d’adopter les codes plutôt masculins qui ne sont pas donnés spontanément aux femmes, et qui permettent d’entrer dans une grande école : une parole argumentée et construite, une certaine capacité à bluffer… Et je pense que j’ai déjà écrasé des gens par la parole. En revanche, j’ai caché la puissance de mon corps, alors que j’ai été très sportive ! Un grand nombre d’écrivains hommes parlent du sport qu’ils pratiquent dans leurs livres ; mais dans les miens, je n’évoque jamais mon rapport à la nage, activité que j’ai pratiquée dix, douze heures par semaine pendant des années. On entend souvent des femmes dire qu’elles se font passer pour plus bêtes qu’elles ne sont afin de laisser les hommes briller. Moi, j’ai longtemps fait ça avec ma puissance musculaire, que je commence tout juste à me réapproprier.
Alice Zeniter, la fille aux cent histoires
Autrice, à 37 ans, d’une œuvre déjà foisonnante, Alice Zeniter aime mettre ses personnages aux prises avec la grande Histoire, qu’elle ait pour cadre
la Hongrie communiste (Sombre Dimanche, Albin Michel, 2013), l’Algérie luttant pour son indépendance (L’Art de perdre, Flammarion, 2017), ou la révolte des Gilets jaunes (Comme un empire dans un empire, Flammarion, 2020). L’écrivaine mène aussi une réflexion au long cours sur les pouvoirs de la fiction : les personnages de Juste avant l’oubli (Flammarion, 2015) sont ainsi hantés par la figure fantomatique d’un écrivain disparu de manière mystérieuse, et dans Je suis une fille sans histoire, un seule-en-scène créé en pleine pandémie de Covid-19, elle décortique, avec humour
et pédagogie, la façon dont on fabrique des histoires. Un questionnement qui l’amène à expérimenter tous les formats créatifs possibles : la traduction (I love Dick, de Chris Kraus, Flammarion, 2016), le cinéma (avec la coréalisation du long-métrage Avant l’effondrement, en 2023), le théâtre, au sein de sa compagnie L’Entente cordiale, ou encore le dessin animé sur lequel elle travaille actuellement.
Camélia Jordana, comment négociez-vous avec ce corps que vos métiers d’actrice et de chanteuse imposent de montrer ?
CAMÉLIA JORDANA Je suis arrivée à un minimum syndical avec lequel je suis OK. Je dois valider mon image au quotidien, ce qui est à la fois un cadeau et un fardeau. Donc ma solution, c’est le contrôle : je suis ma propre productrice. Clips, visuels, photos de cover d’albums, absolument tout est produit et réalisé par moi, avec des chef·fes de projet sur chacun de ces postes. C’est en étant dans ce contrôle que j’arrive petit à petit à lâcher prise, par exemple en gardant dans un clip un plan que je trouve beau, même si moi j’y apparais sous un angle qui ne correspond pas aux codes de la féminité sexy et attirante.
Ce qui frappe, chez l’une et l’autre, c’est une forme de solidité, d’affirmation de soi construite au fil des ans. Mais une chose demeure floue. Depuis le début de l’entretien, pour qualifier cette identité que vous partagez, vous naviguez entre différents mots : arabe, franco-algérienne, racisée, fille d’immigré·es…
ALICE ZENITER Oui, c’est sûr, c’est le bordel…
CAMÉLIA JORDANA Le vrai mot, c’est « berbère ». Mais à partir du moment où la France colonise l’Afrique du Nord, où vivent différentes tribus berbères, ça devient des « Arabes »…
ALICE ZENITER Moi, j’aime bien utiliser le terme « arabe » pour signer une solidarité. De la même manière, mais pas du tout dans les mêmes lieux, j’utilise le terme « bougnoule ». C’est une façon de dire : « De toute façon, c’est ça qu’on est pour eux », de tordre le bras à la première insulte raciste que j’ai prise dans la gueule. En revanche, comme dans toutes les situations où tu retournes le stigmate, quand quelqu’un, qui ne fait pas partie de cette communauté d’entraide et de mémoire, dit « les Arabes » pour parler de gens qui ne le sont pas, là, je corrige.

On manque aussi d’un mot pour parler de ce qui se joue à l’intersection entre sexisme et racisme anti-Arabes, un équivalent au terme « misogynoir » inventé par les afroféministes états-uniennes.
ALICE ZENITER J’ai l’impression qu’en termes de littérature scientifique ou de production d’outils sur les questions de racisme, on a beaucoup pris aux États-Unis – où le travail était clairement plus avancé – et à d’autres féministes noires, comme la romancière nigériane Chimamanda Ngozi Adichie. Sauf qu’aux États-Unis, à la différence de « Noir » ou « Hispanique », « Arabe » n’est pas une catégorie administrative…
CAMÉLIA JORDANA Dans les castings internationaux, j’ai le choix entre « European », « Latina » ou « Middle East »… Il n’y a jamais le nom de ma tête !
ALICE ZENITER On est obligées de transformer certains concepts pour parler de notre cas. La cinéaste et autrice afroféministe Amandine Gay est l’une des personnes dont les réflexions me nourrissent le plus aujourd’hui, mais c’est une penseuse de la condition des femmes noires. J’ai aussi en tête l’écrivaine Maryse Condé, qui a écrit dans des conditions matérielles extrêmement difficiles et qui a refusé d’appliquer les normes de la littérature blanche pour être validée par ses pairs. Mais je ne connais pas de femme issue de nos communautés qui jouerait un rôle équivalent. La plupart des autrices algériennes qui ont été éditées en France ont vu l’un de leurs livres vendu comme un coup éditorial, mais le reste de leurs publications n’a pas suivi : Assia Djebar, présentée comme « la Sagan musulmane », est entrée à l’Académie française, mais elle n’est pas étudiée en France ! Quand on publie un roman et qu’on a de la visibilité, on a l’impression d’être la première, alors que celles qui ont fait le taf avant ont simplement été invisibilisées. C’est pour réparer ça qu’avec la romancière Faïza Guène on travaille sur une forme de lecture musicale autour de ces écrivaines que j’ai découvertes très tard : Assia Djebar, Maïssa Bey, Leïla Sebbar, Tassadit Imache… Leur effacement est très violent, mais c’est parce qu’il n’y a pas eu de chaîne de transmission pour qu’on puisse grandir avec ces autrices-là. Je trouve ça hyper important qu’on puisse connaître, reconnaître et remercier celles qui ont écrit avant nous des récits qui nous ressemblent.
CAMÉLIA JORDANA En ce qui me concerne, depuis quelque temps, je réfléchis à employer le terme « afropéenne ». J’ai eu le déclic à New York, dans un taxi conduit par un Afro-Américain d’origine éthiopienne. Il m’a demandé d’où je venais, et quand je lui ai répondu que j’étais française mais que mes ancêtres étaient algériens, il m’a répondu : « Ah, donc tu es afro-européenne ! ». Et là, je me suis dit… oui. En fait, oui. Comme L’Art de perdre a comblé un vide, ce terme d’afro-européenne vient, pour l’instant, désigner un endroit qui n’est pas dit, ni même pensé par nos dirigeant·es.
ALICE ZENITER Ce que j’aime avec ces termes, « afro-européenne » ou « afro-descendante », c’est aussi qu’ils nous permettent de concevoir l’Algérie dans son rapport au continent africain, dans sa place au sein des mouvements panafricain, tiers-mondiste, non-aligné…
CAMÉLIA JORDANA Mais oui ! J’ai vu récemment un documentaire sur les Black Panthers, qui se réfugiaient à Alger pour fuir le harcèlement du FBI !
ALICE ZENITER C’est exactement ce que raconte l’historien Sylvain Pattieu dans Panthères et pirates (9). Ce genre d’ouvrage, comme les termes « afro-européenne » ou « afro-descendante », ça élargit encore la communauté à laquelle je pense quand j’utilise le mot « arabe ». Quand on n’évoque l’Algérie que dans son face-à-face avec la France, on pense à une histoire de la colonisation et de la très lente décolonisation, mais on oublie le reste, qui est fascinant !
Camélia Jordana,une voix qui s’affirme
En 2014, Camélia Jordana évoque déjà sa « gueule » dans la chanson éponyme tirée de son deuxième album, Dans la peau : « Y a des fois où j’me sens seule / Y a des fois où j’ai peur de ma gueule / Ma gueule d’étranger / Ma gueule qui sait pas où aller… » Un disque sensuel, plus exigeant et pointu que son premier opus, Camélia Jordana, sorti en 2010 et écoulé à plus de 100 000 exemplaires. En 2018, elle va encore un cran plus loin : dans l’album Lost, la chanteuse et actrice désormais césarisée mêle anglais, français et arabe pour dénoncer la colonisation (Empire), le racisme et les violences policières ; Freddie Gray rend hommage à cet Africain-Américain mort en 2015 après son arrestation violente par des policiers à Baltimore, et Dhaouw (lumière, en arabe) évoque le massacre du 17 octobre 1961, commis par la police française lors d’une manifestation pacifique d’Algérien·nes dénonçant le couvre-feu qu’on leur imposait. En 2021, Camélia Jordana produit seule son double album Facile x Fragile, éclectique, toujours combatif et plus ouvertement féministe : « Mesdames, les femmes, prenons les armes / Il est temps, usons de nos larmes / Aucun besoin de faire couler le sang / Comme eux seuls savent le faire. »
Est-ce que les livres, les mots, en changeant les représentations, peuvent contribuer à changer le réel ?
ALICE ZENITER Je pars du principe que les univers fictifs que l’on se construit à travers une somme de films, de séries, de livres… ont une réalité, puisqu’ils ont des effets. Évidemment, chacun·e n’ayant pas fréquenté exactement les mêmes œuvres, on n’a pas le même pays de fiction dans la tête. Mais dans cet univers fictif, je veux mener un combat de justice sociale. Oui, la révolution passe par des questions de représentation : c’est un mouvement continu entre le dedans et le dehors, et il n’y a aucune raison d’abandonner cet univers fictif à l’ordre qu’ont établi les dominants depuis des siècles.
CAMÉLIA JORDANA Dans mon travail aussi, la justice sociale est centrale, presque malgré moi. Ça passe par la chanson et les films, dans lesquels j’incarne certains parcours de femmes, mais également dans les projets que j’ai en cours : l’écriture d’un roman, d’un essai et d’un film. La réalité vient forcément percuter tout ça. Pour qu’une société soit en bonne santé, c’est nécessaire d’être perpétuellement en mouvement.
ALICE ZENITER C’est ce qui fait que je ne supporte pas les positions des boomers. Je trouve ça génial de pouvoir se dire que tel truc que j’ai toujours accepté, tout à coup, me pose problème. Ça signifie que je vais devoir me défaire de certaines choses que j’ai aimées et effectuer un travail sur moi-même ! J’aime l’idée qu’on travaille tout le temps. Sinon ça ne m’intéresse pas, sinon c’est affreux de vieillir. •
Le palais de la Porte-Dorée
C’est la photographe Lynn S.K., chargée de réaliser les photographies de la rencontre, qui a suggéré qu’elle ait lieu au palais de la Porte-Dorée. Construit pour l’Exposition coloniale internationale de 1931, il se voulait une célébration de l’entreprise impérialiste menée par la France au-delà des mers. Ses fresques mettent en scène une vision stéréotypée des populations colonisées, les pièces les plus précieuses de son mobilier sont fabriquées avec des matières premières prélevées dans ces territoires dominés. Les évolutions muséographiques du palais sont emblématiques des difficultés françaises à affronter le fait colonial : le bâtiment a abrité le Musée des Colonies (en 1931), le Musée de la France d’outre-mer (à partir de 1935), le Musée des Arts africains et océaniens (à partir de 1960)… Il est aujourd’hui officiellement le Musée de l’Histoire de l’immigration. « Ses fresques, son objet initial en font un espace potentiellement rude à visiter pour les personnes non blanches, explique Lynn S.K., elle-même franco-algérienne. Mais il m’a semblé essentiel que nous puissions y réunir plusieurs femmes dont les ancêtres ont probablement été oppressé·es, tué·es ou déporté·es au nom de la prétendue mission “civilisatrice” que la France disait mener dans les colonies. »
Entretien réalisé par Nora Bouazzouni, journaliste indépendante, le 4 septembre 2023, au Musée national de l’Histoire de l’immigration.
1. Le 27 juin 2023, Nahel M., 17 ans, est tué par un policier. Un témoin filme la scène, qui fait le tour des réseaux sociaux. Des révoltes éclatent dans plus de 500 communes, suivies d’une répression particulièrement intense.
2. Le white passing est la possibilité, chez une personne racisée, de « passer » pour une personne blanche, et d’être, de ce fait, moins exposée au racisme.
3. Albin Michel, 2010.
4. L’Art de perdre, best-seller couronné par de nombreux prix littéraires, raconte l’histoire d’une famille franco-algérienne sur trois générations, marquée par l’expérience de la guerre, de l’exil et des tiraillements identitaires.
5. Historiquement, le white whashing (blanchiment) consistait à faire jouer par des acteur·ices blanc·hes des personnages qui ne l’étaient pas. Cela désigne aujourd’hui l’hégémonie des standards esthétiques blancs dans les arts et la mode.
6. Le 23 février 2005 était adoptée une loi prévoyant que « les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord ». Vivement contesté, cet alinéa de la loi fut abrogé par décret l’année suivante.
7. Inventé par la dessinatrice Alison Bechdel, ce test quantifie la place des femmes dans une production culturelle à travers trois critères : y a‑t-il au moins deux femmes dans cette œuvre ? Discutent-elle entre elles ? Discutent-elles d’autre chose que d’un homme ? (Lire l’entretien avec Alison Bechdel dans La Déferlante n° 8, novembre 2022).
8. Le 23 mai 2020, dans l’émission de télévision « On n’est pas couché », Camélia Jordana a évoqué la peur qu’elle éprouvait quand elle croisait des policiers. Ces propos lui ont valu, entre autres, une réaction indignée du ministre de l’Intérieur d’alors, Christophe Castaner, ainsi que de certains syndicats de police.
9. Panthères et pirates (La Découverte, 2022) raconte le parcours, au début des années 1970, de deux militant·es des Black Panthers, Melvin et Jean McNair, qui détournent un avion pour le forcer à atterrir à Alger, alors ville-phare du tiers-mondisme.