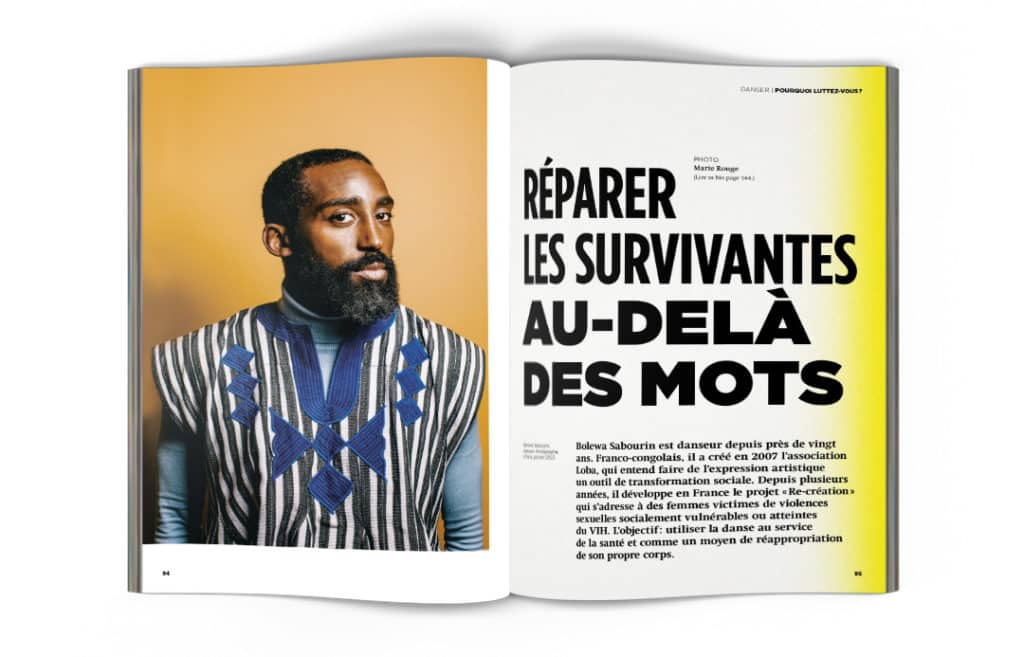D es enfants qui s’échangent un ballon en forme de cœur, une bouée remplie de doudous, une pile d’albums jeunesse et des Kapla en pagaille. À première vue, tout indique un lieu dévolu à la petite enfance. À quelques détails près. Sur les murs, une affiche du documentaire d’Amandine Gay Ouvrir la voix en côtoie une autre annonçant un bal queer. Ce samedi 4 juin,
C’est tout le principe de La Bulle, acronyme « capillotracté » de « Bienvenue, unissons nos luttes par l’accueil d’enfants ». Depuis plus de trois ans, ce collectif rennais se déplace au gré des invitations pour garder bénévolement les enfants durant des temps militants (réunions, manifestations, festivals…).
« L’idée est née au début de 2019, à la suite de la projection-discussion du film Le Sel de la Terre 1Film américain
de Herbert J. Biberman (1954), considéré comme l’un des premiers longs métrages à promouvoir le féminisme social
et politique », retrace Martin 2Les personnes que nous avons rencontrées n’ont pas souhaité donner leur nom
de famille., 25 ans, l’un des fondateur·ices de ce collectif. Dans une mine du Nouveau-Mexique, les travailleurs d’origine mexicaine bataillent pour obtenir les mêmes droits que les travailleurs blancs. Se pose la question de la place des femmes dans la lutte.
En effet, la loi Taft-Hartley3Loi états-unienne de 1947 qui restreint les activités des syndicats et limite le droit de grève. interdisant aux mineurs de poursuivre le mouvement, les femmes avaient pris leur place, et eux gardaient les enfants. De quoi, plus de soixante-dix ans après, inspirer des Rennais·es convaincu·es que la question de la garde d’enfants est une autre façon de lutter et ne concerne pas que les femmes et les parents.
« Je ne me sens pas d’être responsable d’un enfant, mais j’ai la volonté de construire des choses avec eux. L’éducation collective, la coparentalité m’intéressent. »
Sam, bénévole à La Bulle
Ce 4 juin d’ailleurs, trois bénévoles sur quatre sont des hommes non parents. Crête fluo, débardeur et short assortis, Sam, 31 ans, évoque son non-désir d’enfant en gardant un œil sur le match de foot improvisé par Camille, 9 ans, et son frère Augustin, 6 ans, dans le parc qui jouxte Iskis : « Je ne me sens pas d’être responsable d’un enfant, mais j’ai la volonté de construire des choses avec eux. L’éducation collective, la coparentalité m’intéressent. Et La Bulle est un bon moyen de discuter d’éducation avec l’entourage des enfants. »
Une bibliothèque jeunesse queer féministe mobile
Pour ce faire, La Bulle peut compter sur un outil : la Bibliothèque jeunesse queer féministe mobile (@BiblioJQF sur Facebook) qui la suit partout ou presque depuis leur rencontre au festival féministo-punk Very Bad Mother à Concarneau (Finistère). Créée « un peu par nécessité » en 2020 par Alec et Sacha, deux papas trans, et leurs deux filles, cette bibliothèque compte quelque 250 titres, en français et en langues étrangères.
Leur point commun : des histoires avec des personnages et des situations familiales plus représentatives de la société. « La littérature, c’est la première représentation qu’on a du monde, assure Alec, prof de français. Et je n’ai pas envie que mes enfants pensent que tout le monde est blanc, hétéro, valide… »
Autre source d’inspiration : certains collectifs à l’étranger, comme la Conspiration intergalactique des collectifs d’accueils d’enfants aux États-Unis et au Canada. Créée en 2010, elle fédère une petite dizaine de collectifs nord-
américains, qui partagent en ligne leur travail depuis 2013. La Bulle y pioche aussi bien des idées d’activités que des ressources pédagogiques pour aborder certains thèmes comme les violences policières.
Avant de rejoindre le collectif il y a un an et demi, Joachim, 30 ans, n’avait jamais entendu parler des garderies autogérées. Il cherchait à intégrer « un collectif qui vient en soutien à des luttes », et l’initiative a résonné avec son histoire. « Je me souviens que c’était galère pour ma mère, isolée, de me faire garder, [quand j’étais] petit », témoigne « Monsieur Bobo », qui doit son surnom à son activité parallèle de secouriste. « Elle s’organisait avec les mamans du quartier, mais j’ai l’impression que les choses n’ont pas tellement évolué. »
Face à lui, Candice, nouvelle recrue de La Bulle, hoche la tête. À 38 ans, elle élève seule sa fille de 4 ans et demi, avec qui elle est venue s’installer dans la métropole l’an dernier. Cette ex-accompagnante d’élèves en situation de handicap a démissionné pour préparer un concours de professeure des écoles et élever sa fille. « Quand tu arrives dans une nouvelle région, loin de la famille, tu n’as pas vraiment de relais. Si j’appelle quelqu’un·e, c’est que je galère, confie-t-elle. Ça n’est pas pour prendre du temps pour moi et encore moins pour aller manifester. »
Pourtant, la néo-Rennaise a des choses à revendiquer : « Depuis que je suis mère, j’ai encore plus envie de gueuler pour que ça bouge. » Au sujet des violences sexistes et sexuelles, du climat, des situations familiales difficiles… « Être mère isolée, c’est ultra violent, on n’existe pas. Pourtant, les familles monoparentales, c’est une famille sur quatre. » Son premier contact avec La Bulle a eu lieu en mars lors de Big Up !, un week-end féministe et antiraciste. « J’ai laissé ma petite, ça m’a permis de souffler, de discuter sans être interrompue et sans me presser parce qu’elle s’ennuie. » Ce jour-là, Candice a renoué « avec un truc » lui paraissant « remonter à loin » : la vie militante.
La difficulté d’allier maternité et militantisme n’est pas nouvelle. La marge de manœuvre a toujours été réduite pour les femmes : ne pas avoir d’enfants ou attendre qu’ils ou elles grandissent. « Les personnalités [féminines] les plus connues des mouvements sociaux du xixe siècle sont des veuves ou des célibataires sans enfant, note Mathilde Larrère, historienne spécialiste des mouvements révolutionnaires et du maintien de l’ordre en France au xixe siècle. Jusqu’aux années 1920, il fallait l’autorisation du mari pour entrer en politique ou dans un syndicat. »
À cette époque, la question de la garde d’enfants est même un argument contre l’engagement des femmes. « Comme on a considéré pendant longtemps que les femmes n’avaient rien à faire en politique et que leur fonction sociale était de s’occuper des enfants, les organisations politiques ne pensaient pas à la question de la garde des enfants et ne l’organisaient pas, empêchant de facto les femmes de faire concrètement de la politique. » L’autrice de Rage against the machisme (Éditions du Détour, 2020) illustre son propos avec des gravures du caricaturiste Honoré Daumier datées de 1848. « Elles montrent des femmes qui vont au club pour discuter politique et des gamins, soit gardés par le mari, représenté commeun homme dévirilisé, soit en train de se noyer ou de s’ébouillanter… » Elle poursuit : « Les deux fonctions semblaient incompatibles dans l’esprit des hommes, et elles le restent dans les faits, après l’entrée des femmes en politique, à cause de la difficulté de faire garder les minots à l’heure des réunions ! »
Avoir des enfants et militer : Une lutte dans la lutte
Aujourd’hui encore, pour les parents de jeunes enfants, surtout les mères, ce n’est pas évident de participer aux luttes. Bien souvent, leur engagement ne tient qu’à l’implication de l’entourage. Bastien, agent d’entretien de 36 ans et père de Camille et d’Augustin, résume sa situation d’avant de connaître La Bulle. « Je suis au NPA et ma compagne au PCF. Jusqu’ici, lorsqu’on voulait militer tous les deux le week-end, la famille prenait le relais, car on n’a pas les moyens de payer quelqu’un·e. Ça impliquait d’aller à Saint-Malo la veille pour déposer les enfants à mes parents, puis de partir avant la fin de la manif pour les récupérer. » Autre option pour le couple, régulièrement sollicité en semaine : « Un·e qui milite, un·e qui garde les enfants. »
Mais pour celles et ceux qui ne bénéficient pas de ces solidarités et qui n’envisagent pas de renoncer à leur engagement, la question des enfants devient une lutte dans la lutte. « J’élève mes filles en solo depuis leurs 3 ans et je n’ai jamais voulu mettre un frein au militantisme malgré la situation », expose Méli, mère de jumelles de 15 ans. Toutes trois ont découvert La Bulle l’été dernier, lors du festival Very Bad Mother. « J’avais déjà vu ça sur la Zad. Ça a permis à mes filles, capables de se gérer, d’avoir un lieu pour se faire des ami·es, et à moi d’être totalement dans l’organisation du festival. »
Le tout sans se sentir redevable ni en position de demandeuse. « Quand elles étaient petites, je faisais du forcing pour que les réunions se fassent chez moi ou le dimanche après-midi, parce que c’était plus tranquille », relate la militante « anarcha-féministe ».
« Plusieurs fois, y compris dans des milieux féministes, je me suis entendu dire : “Tu militeras quand tes filles seront plus grandes.” »
Les demandes de Méli n’ont pas toujours été bien accueillies au sein des divers collectifs par lesquels elle est passée. « J’ai dû faire le tri entre ceux qui les acceptaient et les autres. Et plusieurs fois, y compris dans des milieux féministes, je me suis entendu dire : “Tu militeras quand tes filles seront plus grandes.” »
Mathilde Larrère n’est pas étonnée : « C’est propre à la France, où l’on se heurte encore à une vision sacrificielle de la vie politique. Comme si c’était une dimension qui nécessitait qu’on sacrifie sa vie privée. » Pour l’historienne, cette vision est une conséquence de « la construction de la vie politique française autour de la théorie des sphères séparées », qui consiste à associer la sphère publique aux hommes et la sphère privée aux femmes. Cela expliquerait que, pendant longtemps, la question de la garde des enfants ne se soit posée qu’aux mères.
Mais ces dernières années, les choses évoluent. Face à la montée des violences policières lors des manifestations, l’accueil d’enfants de militant·es ne répond plus seulement à une problématique logistique, mais aussi à un enjeu de sécurité. « Maintenant, j’hésite à emmener les enfants, témoigne Bastien, qui avait pris l’habitude de défiler avec eux le 8‑Mars, le 1er-Mai et à la Pride. La dernière fois que j’ai emmené mon grand en manif, c’était en soutien aux enseignant·es. Heureusement que j’avais pris son masque de ski pour le protéger. J’avais la gorge qui brûlait à cause des lacrymos alors que c’était à peine le début de la manif… »
Méli, qui a pourtant « un gros passé de manifestations », ne prend plus le risque d’emmener ses filles comme avant : « Les manifs déclarées, elles les ont faites avec moi dès bébés, en poussette. J’ai toujours été très vigilante. Je ne me retrouvais jamais seule avec elles et on se mettait d’accord avec les copains pour qu’on puisse toujours les sortir du cortège si ça chauffait. » Ces précautions ne suffisent plus. « Je ne les emmène ni à Nantes ni à Rennes. Les dernières que j’ai faites là-bas, j’en suis rentrée traumatisée. Alors La Bulle, c’est plus que nécessaire. »
Dans ce contexte, rien de surprenant à ce que les collectifs de gardes d’enfants se soient structurés et rendus visibles sur les réseaux sociaux en France au même moment. Soit peu après le début du mouvement des Gilets jaunes, en octobre 2018. En 2019, des garderies autogérées ont ainsi ouvert dans plusieurs villes : La Bulle à Rennes, Les Nounous jaunes à Lyon et Les Garderies populaires en pays nantais. La Bulle semble être le seul collectif à avoir survécu au Covid, mais les besoins sont toujours là.
« On est sollicité·es sur plein de mobilisations, témoigne Martin. Parfois à l’autre bout de la France. On ne peut pas répondre à toutes les demandes. » Après les Rencontres nationales féministes qui ont eu lieu à Rennes à la fin de janvier 2022, le collectif a lancé un appel en ligne pour que d’autres prennent le relais, ailleurs. En incitant à cadrer les actions pour les pérenniser : « Des groupes un peu plus formels permettent plus de visibilité et ça facilite l’accès aux parents ou aux non-parents. »
En Île-de-France, une Bulle a vu le jour au printemps. Ces initiatives locales militantes pourraient-elles être l’occasion de faire évoluer les politiques publiques de gardes d’enfants ? À Rennes, Priscilla Zamord, élue écologiste et co-secrétaire nationale du syndicat Front de mères, le croit : « Vu les enjeux actuels, lutter est une question de survie. Et un des axes du contrat de Ville dans les quartiers populaires, c’est d’encourager l’auto-organisation des citoyen·nes. C’est bien, mais si on veut vraiment les soutenir jusqu’au bout, il faut des solutions de garde. » Ce qui nécessiterait de repenser les modes de garde publics, certes variés, mais tous organisés autour du travail rémunéré. Et donc de reconnaître tout aussi légitimes d’autres activités – militer, s’amuser… –, voire le répit parental. •