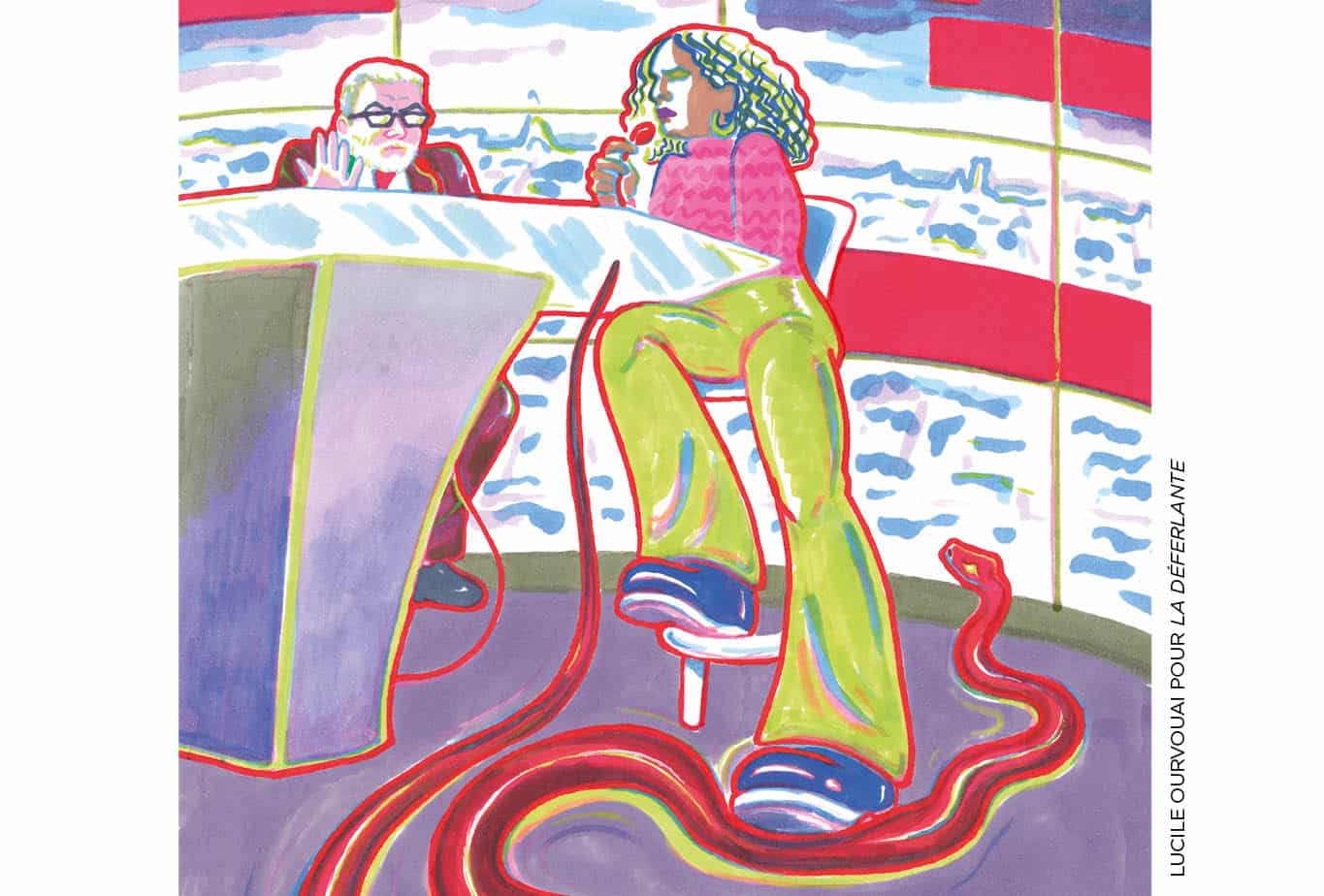Maboula Soumahoro est maîtresse de conférences à l’université de Tours, spécialiste en études états-uniennes, africaines-américaines et de la diaspora noire africaine. Elle est l’autrice, entre autres, du Triangle et l’Hexagone : réflexions sur une identité noire, (La Découverte, 2020).
Pauline Perrenot est coanimatrice de l’observatoire des médias Action-Critique-Médias (Acrimed), journaliste notamment pour Le Monde diplomatique, et autrice des Médias contre la gauche (Agone, 2023).
Sihame Assbague est journaliste et militante antiraciste, ancienne porte-parole du collectif Stop le contrôle au faciès. Elle a notamment écrit dans la Revue du crieur.
Quelles sont les responsabilités des médias face à la poussée de l’extrême droite ?
PAULINE PERRENOT Le rôle des médias dans la banalisation des idées conservatrices et racistes est immense.
On le voit à travers la centralité des préoccupations historiques de l’extrême droite dans l’agenda journalistique : l’insécurité, l’islam, l’immigration. Les cadrages de l’extrême droite sur ces questions sont désormais normalisés, en particulier dans l’audiovisuel et dans une large partie de la presse hebdomadaire. Entre CNews, Europe 1, le Journal du dimanche (JDD) ou l’émission de Cyril Hanouna sur C8, on assiste à la consolidation d’un pôle frontalement réactionnaire. Tous sous la coupe du milliardaire Vincent Bolloré, ces médias sont légitimés par le gouvernement et la classe politique. Ils ont une influence sur le reste de la sphère médiatique, ainsi qu’un rôle dans la circulation et l’amplification d’emballements réactionnaires. Mais à Acrimed [Action-Critique-Médias], on estime qu’il n’y a pas d’étanchéité entre les médias d’extrême droite et le reste du paysage médiatique. Par exemple, le sociologue Abdellali Hajjat (1) a montré qu’au cours des années 2000 et 2010 nombre de journalistes et chroniqueur·euses de Valeurs actuelles étaient régulièrement invité·es sur différentes chaînes généralistes de l’audiovisuel.
« On assiste à la consolidation d’un pôle de médias frontalement réactionnaires, sous la coupe du milliardaire Vincent Bolloré, légitimés par la classe politique. »
Pauline Perrenot
SIHAME ASSBAGUE On a tendance à taper facilement sur un racisme médiatique ouvertement assumé, tout en occultant le caractère structurel du racisme dans le champ médiatique. On se focalise beaucoup – et à juste titre – sur des médias qui propagent clairement des idées d’extrême droite, mais en même temps, en lisant de grands quotidiens tout à fait respectés et en regardant des émissions d’information du service public, on retrouve parfois exactement les mêmes débats. On fait une différence entre l’expression outrancière du racisme et son expression un peu plus distinguée. Mais dans les deux cas, cela reste l’expression d’une certaine hiérarchisation des individus. À partir du moment où le racisme structure la société, ses modes de pensée et ses représentations, il n’est pas étonnant de le retrouver sous des formes différentes, dans un grand nombre de productions culturelles et médiatiques.
MABOULA SOUMAHORO L’extrême-droitisation, c’est un mouvement de fond, qui s’accélère peut-être ces dernières années, mais qui était déjà en marche depuis plusieurs décennies. Il y a toujours eu des journalistes qui ont essayé de bien faire, de produire un travail sourcé. Mais quel poids ont-ils face à la puissance des médias qui font le plus d’audience, ou sont le plus respectés, et qui vont prendre toute la place ? Quel poids face aux chaînes d’information en continu, qui doivent produire sans arrêt et à tout prix ? Nous sommes dans des structures capitalistes, qui ont pour objectif principal de faire du profit, mais aussi de maîtriser la diffusion et de créer des conglomérats. Des médias indépendants et des journalistes essaient de faire leur travail, même s’ils et elles sont silencié·es et moins puissant·es structurellement.
Au sein des rédactions, où se concentre le pouvoir éditorial ?
PAULINE PERRENOT Ce sont les chefferies médiatiques – sociologiquement solidaires des intérêts des classes dirigeantes – qui décident des sujets. Et plus généralement, une poignée de commentateur·ices, éditorialistes et intervieweur·euses captent la parole et s’expriment dans plusieurs médias. Quant à la frange intermédiaire de cette profession, les sociologues observent qu’elle est en voie d’embourgeoisement (2). Les professionnel·les au bas de l’échelle subissent pour leur part une précarisation croissante et une dégradation de leurs conditions de travail. Dans de telles conditions matérielles, comment peut-on prendre du recul, du temps pour l’analyse ? Comment simplement s’extraire du rythme médiatique effréné, du mimétisme et du matraquage ?
SIHAME ASSBAGUE Malgré tout, je constate que sur les quinze dernières années, il y a eu des évolutions, par exemple au niveau du traitement médiatique des violences policières. C’est d’abord dû à la progression des luttes, mais aussi grâce aux réseaux sociaux. Il y a ce que produisent les médias et il y a tout ce qui existe par ailleurs sur Internet, qui permet de faire entendre nos voix. Cela existait avant, évidemment, mais il y a désormais une démocratisation de l’accès à ce savoir-là. Le renouveau des luttes depuis le combat du comité Adama, puis Black Lives Matter (3) a très certainement permis une meilleure prise en compte de ces enjeux par certains médias.
Le fait qu’il y ait plus de journalistes non blanc·hes, c’est également le fruit des luttes : ce ne sont pas les médias – y compris les médias de gauche – qui se sont levés un matin en se disant qu’ils allaient recruter des Noir·es et des Arabes. C’est parce qu’il y a des luttes qui accompagnent cette avancée, qui l’imposent. Il y a donc une évolution, mais elle a ses limites. Un exemple, qui me semble assez frappant, c’est la question de la déracialisation (4). Aujourd’hui en France, les personnes qui sont principalement visées par la police et la justice, ce sont les hommes non blancs et pauvres. C’est un point crucial, et pourtant cela n’apparaît quasiment nulle part. C’est une forme d’invisibilisation : on déracialise les victimes dont on nous raconte les histoires. On ne sait jamais qui elles sont. Pourtant, quand on parle des États-Unis, on dira « un homme noir a été tué par un policier blanc ». En France, on dira « un homme a été tué par la police ». Faire apparaître le groupe racial des victimes est primordial, parce que cela permet de relier les éléments entre eux. Cela témoigne d’une impossibilité de considérer les personnes non blanches, en particulier les hommes, en tant que victimes.
MABOULA SOUMAHORO On ne veut pas parler de la race, mais on en parle tout le temps de manière détournée : on ne nomme pas les choses directement, mais c’est ce qu’on sous-entend quand on donne les nom et prénom, les lieux de naissance ou les lieux où se sont passés les faits. Ces données là sont très racialisées. Quand on parle de l’islam en France, on parle des Arabes, on ne parle pas des Sénégalais·es ou des Malien·nes. Et quand on parle de quelqu’un qui a commis un crime en précisant qu’il est né à Fort-de-France, on renvoie inévitablement à sa racialisation. On assiste ainsi à un double mouvement d’invisibilisation et d’énonciation permanente et subtile. Il y a une sorte de langage codé, sans dire directement de qui on parle. Il suffira, pour se dédouaner, de dire que « l’islam n’est pas une race », que la banlieue « n’est pas raciale », que ce qu’on appelle les « outre-mer » ne désigne pas des lieux d’exclusion et de marginalisation qui renvoient directement à l’histoire coloniale esclavagiste. Et pourtant c’est ce qu’on dit de manière détournée.
Avec la manière dont sont cadrés les débats, avez-vous le sentiment de pouvoir dérouler votre pensée quand vous intervenez sur des plateaux ?
MABOULA SOUMAHORO Notre présence dans les médias mainstream est nécessairement biaisée et piégeuse. Quand tu y vas, en tant que personne racisée portant une parole féministe ou antiraciste, tu es seule, et c’est ça l’exercice. Tu seras toujours en minorité d’opinion, mais ils ont pourtant besoin de ta présence, parce qu’ils veulent se donner l’air d’être ouvert·es. Si tu tiens bon, avec une forme de dignité, il y a un buzz ou un clash presque assuré. C’est ça qui va faire des vues. C’est comme si nous étions sur une scène de théâtre, où chacun·e est casté·e dans un rôle. Et toi, tu es dans le rôle de la personne qu’on va s’amuser à faire semblant d’écouter aujourd’hui. L’exercice est d’essayer de dérouler ta pensée alors que rien n’est fait pour. Il suffit d’analyser les images pour voir combien de fois on te coupe la parole. Est-ce que tu peux finir une phrase ou non ? Est-ce qu’on te donne la parole et à quelle fréquence par rapport aux autres invité·es ? L’exercice est d’essayer de dire quelque chose malgré ces conditions défavorables. Il y a quelque chose de profondément pervers dans le fait de t’inviter sans te donner l’occasion de parler. Au fond, on ne veut pas que tu sois là. Mais ton corps, lui, est présent, et ce n’est pas parce que tu es invitée que tu es accueillie. Cela se voit dans la façon dont on s’adresse à toi, au défi de tous les codes habituels d’interaction : la façon dont on te présente, ou même la façon dont on prononce ton nom.
Une forte concentration des médias et très peu de contrôle
En France, une dizaine d’hommes d’affaires détiennent la grande majorité des groupes de presse privés. C’est le cas par exemple de la famille Bouygues (groupe TF1), de Patrick Drahi (BFMTV, RMC, Libération), de Xavier Niel (Le Monde, Télérama) ou encore de Bernard Arnault (Les Échos, Le Parisien, Radio classique). Mais c’est surtout le cas du milliardaire Vincent Bolloré qui soulève des inquiétudes, notamment depuis sa reprise du groupe Canal+ en 2015, la mue d’i‑Télé en CNews deux ans plus tard, avant sa prise de contrôle sur le groupe Lagardère, ou encore son rachat du groupe d’édition Hachette. Selon la Fédération internationale des journalistes (FIJ), cette situation « est une menace envers la liberté de la presse, léguant un pouvoir excessif à des individus, des gouvernements ou des personnalités politiques ». Elle renforce chaque année davantage le niveau de défiance du public vis-à-vis des médias.
Si, depuis 1986, les entreprises de presse sont soumises à une régulation visant à garantir la liberté des médias, les décisions de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) sont souvent perçues comme trop peu contraignantes. En février 2024, le Conseil d’État, saisi par Reporters sans frontières, a donné six mois à l’Arcom pour revoir ses modalités de contrôle de l’indépendance de l’information pour CNews. Il s’agit de veiller à ce que l’Arcom contrôle le pluralisme des idées en prenant en compte les chroniqueur·euses, animateur·ices et invité·es, et plus uniquement le temps de parole des personnalités politiques.
SIHAME ASSBAGUE Les interviews de Rima Hassan [juriste d’origine palestinienne et candidate La France insoumise aux européennes] sont pour moi assez emblématiques de tout ce non-accueil. Elles me donnent l’impression d’assister à une garde à vue. Il y a un dispositif particulier de contrôle réservé aux figures d’opposition. C’est particulièrement vrai pour les personnes non blanches et les classes populaires. Récemment, j’ai été convoquée à une audition pour apologie du terrorisme sur la base d’un tweet [de soutien à la Palestine]. Et quand Rima Hassan a été interviewée sur le plateau de France Info (5), ça ressemblait exactement à ma convocation devant la police. On aurait pu mettre le policier à la place du journaliste, on était dans le même dispositif, avec les mêmes questions, les mêmes intonations. Dans ce type de situation, l’interviewée est accusée d’emblée. Elle n’est pas invitée pour participer au débat, mais pour y répondre de gré ou de force, selon des règles écrites à l’avance. Comme le résume le sociologue Harold Garfinkel (6), ce type d’interviews ressemble à des « cérémonies publiques de dégradation », qui sont faites pour remettre une personne à sa place. On la soumet à un interrogatoire et on ne lui laisse aucun espace.
PAULINE PERRENOT Les interrogatoires médiatiques contre la gauche politique, sociale, syndicale, etc., sont ordinaires. Mais les travers sont vraiment exacerbés dans le cas de Rima Hassan, et la manifestation du racisme est évidente. La violence symbolique est extrême contre tout discours s’écartant un peu du récit dominant qui a été cadré à la suite des attaques du Hamas le 7 octobre et de la guerre menée par Israël sur la bande de Gaza7. Ces interviews sont une matérialisation de la suspicion à l’égard de ce type d’invité·es, d’une présomption de mensonge et d’ambiguïté. Et cela concerne aussi les actrices et acteurs locaux : très peu de personnes résidant à Gaza ont été interviewées. Des informations et des récits qui viennent de Gaza, il y en a énormément sur les réseaux sociaux et dans les médias indépendants qui ont fait remonter des témoignages. Mais la faiblesse de l’utilisation de ce matériau par les médias dominants est criante. Et pour le moment, on ne voit aucune remise en question de ces pratiques par les têtes d’affiche. Ils et elles continuent de faire semblant de ne pas comprendre le déséquilibre structurel des « débats ». C’est un processus de long terme, avec des décennies de marginalisation, voire d’invisibilisation du travail de chercheur·euses qui pourraient apporter une contradiction étayée au prêt-à-penser sécuritaire, autoritaire dans les médias.
MABOULA SOUMAHORO On observe aussi des récits complètement décontextualisés. On a par exemple l’impression que l’histoire du « conflit israélo-palestinien » a débuté le 7 octobre, en laissant complètement de côté des décennies de tensions et de tragédies. La mise en place de l’État d’Israël a une histoire. Si l’on commence le récit au 7 octobre, c’est vraiment une mainmise sur la chronologie. C’est une forme de négationnisme qui propose une chronologie arrangeante, complètement erronée et qui ancre les événements dans un présent sans histoire, sans racines, sans précédents. C’est un accaparement puissant.
« Il y a quelque chose de profondément pervers dans le fait de nous inviter sans nous donner l’occasion de parler. »
Maboula Soumahoro
Qu’est-ce que cela coûte d’intervenir dans les médias ? Et ce coût est-il encore plus fort pour les femmes ?
MABOULA SOUMAHORO Chaque apparition dans l’espace public mainstream est une exposition qui a des conséquences. Ces apparitions sont la seule forme de militantisme que je revendique. Quand tu arrives dans cet espace-là, c’est littéralement une guerre qui est menée à travers ton corps. Si tu n’endosses pas le rôle de la minorité reconnaissante, tu es harcelée et ce sont des tombereaux d’insultes, d’emails, de lettres, de caricatures racistes qui circulent sur les réseaux sociaux et inondent même ton adresse personnelle. C’est très réel. Et il y a un désengagement des médias sur cette question : ils ont déjà bénéficié de ta présence, qui leur sert pour se présenter au monde comme des institutions ouvertes au débat. Mais pour toi, les conséquences sont immenses et pérennes : des vidéos vont circuler pendant des années, l’origine d’une petite phrase va être perdue et la séquence va devenir un mème.
On va toujours la ressortir pour te disqualifier.
Tout est décontextualisé. On va te dire que c’était en 2020 alors que c’était en 2016, que c’était à Paris alors que c’était à Lyon. J’ai déjà porté plainte, à plusieurs reprises. Chaque fois que des gens se sont mobilisés contre moi, c’était lié à mon statut de maîtresse de conférences. Les gens ne se remettent pas de ce statut, parce que, selon eux, je ne devrais pas enseigner à l’université. Ce qui dérange, c’est ton non-conformisme. Ce n’est pas seulement ta personne, c’est ce que tu représentes. Ils se disent : « C’est qui cette négresse ? » Et cette représentation, cette symbolisation sont dans ton corps. Avec ce statut, tu n’as pas le droit d’être contestataire.
SIHAME ASSBAGUE Ces attaques visent toutes les paroles minoritaires, qui présentent d’une manière ou d’une autre une infraction à l’ordre établi. Mais il y a des violences qui concernent spécifiquement les femmes, notamment beaucoup de commentaires sur le physique, avec énormément d’insultes et de remarques sexistes sur le corps. C’est une violence supplémentaire, à laquelle on ne peut pas échapper. Si ta séquence devient virale et tombe entre de mauvaises mains, même en intervenant dans un petit média indépendant, cela débouchera sur une campagne de harcèlement. Et quand on reçoit des centaines ou des milliers de messages privés, ou qu’ils sont envoyés à ton employeur·euse, on peut vite perdre pied. Il vaut mieux être entourée, s’assurer d’avoir un cadre collectif sur lequel s’appuyer quand ça arrive.
PAULINE PERRENOT Le collectif, c’est une bonne manière de se prémunir contre ces effets, mais il est très difficile de donner à voir une parole collective dans la plupart des médias, qui imposent souvent une certaine individualisation de la parole. Il faudrait qu’ils réfléchissent à comment davantage faire exister les collectifs. Si les médias ne sont pas responsables des vagues de harcèlement qui peuvent avoir lieu sur les réseaux sociaux, ils ne documentent pas suffisamment ce phénomène.

Le 13 juin 2024, deux semaines avant le premier tour des élections législatives, sur le plateau de Touche pas à mon poste sur C8, Cyril Hanouna appelle en direct Jordan Bardella pour organiser un rapprochement avec Sarah Knafo (Reconquête !). Touche pas à mon poste ! / D.R.
Dans ce contexte, comment fait-on pour rendre visibles les enjeux féministes et antiracistes ? Faut-il investir d’autres espaces ?
MABOULA SOUMAHORO La réponse, c’est la lutte et l’investissement de tous les espaces possibles selon nos orientations. Celles et ceux qui veulent manifester manifestent, celles et ceux qui peuvent faire grève le font. Celles et ceux qui veulent aller dans les espaces mainstream y vont pour les travailler de l’intérieur. Je ne pense pas qu’il n’y ait qu’une seule position à adopter. Nous devons continuer à lutter en ayant une conscience, une histoire des luttes politiques en tête, car on s’inscrit dans un continuum. Il y a toujours eu des espaces alternatifs, des espaces autogérés ou gérés par des collectifs. On continue à se battre, on trouve un lieu, ou bien on l’invente, on le maintient, mais en se souvenant qu’il y a eu d’autres exemples avant nous.
PAULINE PERRENOT Si on est un syndicat, un parti, la désertion totale des médias qui ont une forte audience n’est évidemment pas une option. Il faut en effet avoir conscience de la longue histoire des luttes, mais aussi politiser notre rapport aux médias. Un certain nombre d’acteur·ices à gauche continuent d’y entretenir un rapport dépolitisé, alors que c’est un terrain de lutte au sein duquel il est possible d’imposer des conditions. La question de la nécessité d’avoir des commentateur·ices « de gauche » se pose souvent. Mais elle est vaine s’ils ou elles ne servent que de cautions, si on ne maîtrise pas ce qui est à l’agenda ou la composition des plateaux, bref, si on n’a pas la clé des dispositifs. Il y a sans doute plus à gagner en renforçant le soutien aux médias indépendants, en créant nos propres espaces. Sans avoir non plus un discours naïf sur les médias indépendants : ils ne sont pas nécessairement étanches aux systèmes de domination, ni aux pratiques journalistiques problématiques, mais ils incarnent le visage du pluralisme. Nous avons besoin de reportages, d’enquêtes, d’angles nouveaux et de place pour les universitaires. Tout cela ne doit pas nous faire perdre de vue la nécessité de formuler des propositions de transformation radicale des médias existants. Ces espaces dominants sont encore très lus et écoutés, beaucoup plus que de nombreux petits médias. Il n’y a aucune raison de ne pas revendiquer leur réappropriation démocratique. La gauche devrait s’en emparer pour ce qu’elle est : une question politique de premier plan. Il en va du droit d’informer et d’être informé·e.
SIHAME ASSBAGUE On aurait pu se dire qu’avec l’émergence d’Internet et de tous les cadres alternatifs (les réseaux sociaux, YouTube, Twitch, etc.), la télévision allait rapidement perdre de son influence. Mais en réalité, elle est partout. Sur les plateformes en ligne, ce sont souvent les extraits télévisuels qui marchent le mieux en matière d’audience. Personne ne peut faire abstraction de ce qui y est dit. Il faut prendre en compte le monde tel qu’il est. Dans l’inconscient collectif, les personnes qui passent à la télévision conservent une forme de crédibilité, et ce, malgré toutes les critiques qui peuvent exister sur ce qu’on y voit. Se défaire de ce pouvoir va prendre du temps. Difficile donc de passer à côté de ce terrain de lutte que sont les plateaux télé. Tout dépend de la raison pour laquelle on y va en tant qu’intervenant·e, du cadre de notre intervention, et de notre degré de préparation.
« Il est encore possible d’investir certains espaces médiatiques dominants. Il faut y aller en conscience, avec des stratégies et des objectifs. »
Sihame Assbague
Je crois qu’il est encore possible d’investir certains espaces médiatiques dominants. Il faut y aller en conscience politique de ce qui s’y joue, avec des stratégies et des objectifs.
Il y a peu de temps, on m’a proposé d’intervenir sur « Touche pas à mon poste » (C8) face à Éric Zemmour. On m’a dit : « Si vous ne venez pas, la chaise restera vide. » Je leur ai répondu : « Qu’elle reste vide. » Une des nécessités absolues, c’est de refuser d’y aller si cet argument-là est mobilisé. C’est avec ça qu’ils réussissent à faire venir les gens. Certains se disent : « Si je n’y vais pas, qui va nous défendre face à Zemmour ? C’est le sort de ma communauté qui est en jeu. » Ce n’est pas un bon argument. On a nos propres médias, nos réseaux sociaux. Il y a un bouillonnement de production culturelle, médiatique, de réflexions, d’espaces. Il faut les renforcer, il faut les multiplier, leur donner de la force. Et je pense que c’est aussi important de continuer la critique des médias. Il faut participer à visibiliser la fabrique de l’information et de ce qu’elle produit sur la société. •
Entretien réalisé en visioconférence le 30 avril 2024 par Sarah Bos. Article édité par Diane Milelli.
(1) Abdellali Hajjat, « L’emprise de Valeurs actuelles », Carnet de recherche Racismes (blog), 2020.
2. Jean-Baptiste Comby et Benjamin Ferron, « La subordination du journalisme au pouvoir économique », revue Savoir/Agir, no 46, 2018 (accessible sur le site d’Acrimed).
3. Adama Traoré a été tué par des gendarmes le 19 juillet 2016 dans le Val‑d’Oise. Depuis, le comité Vérité et Justice pour Adama (lire la rencontre avec Assa Traoré) se mobilise pour faire reconnaître ce crime.
Aux États-Unis, les manifestations consécutives à la mort de George Floyd lors d’une interpellation le 25 mai 2020 ont réactivé le mot d’ordre « Black Lives Matter ».
4. Les processus de racialisation ou de déracialisation renvoient aux assignations raciales construites à travers l’histoire, héritées notamment du passé colonial français.
5. Interview de Rima Hassan au JT de 19/20 de France Info le 29 avril 2024, à la veille de sa convocation au commissariat dans le cadre d’une enquête pour apologie du terrorisme.
6. Harold Garfinkel, « Conditions of successful degradation cérémonies », American Journal of Sociology, no 5, 1956.
7. Lire le n°49 de la revue Médiacritiques intitulé « Israël-Palestine : le naufrage du débat public », janvier-mars 2024