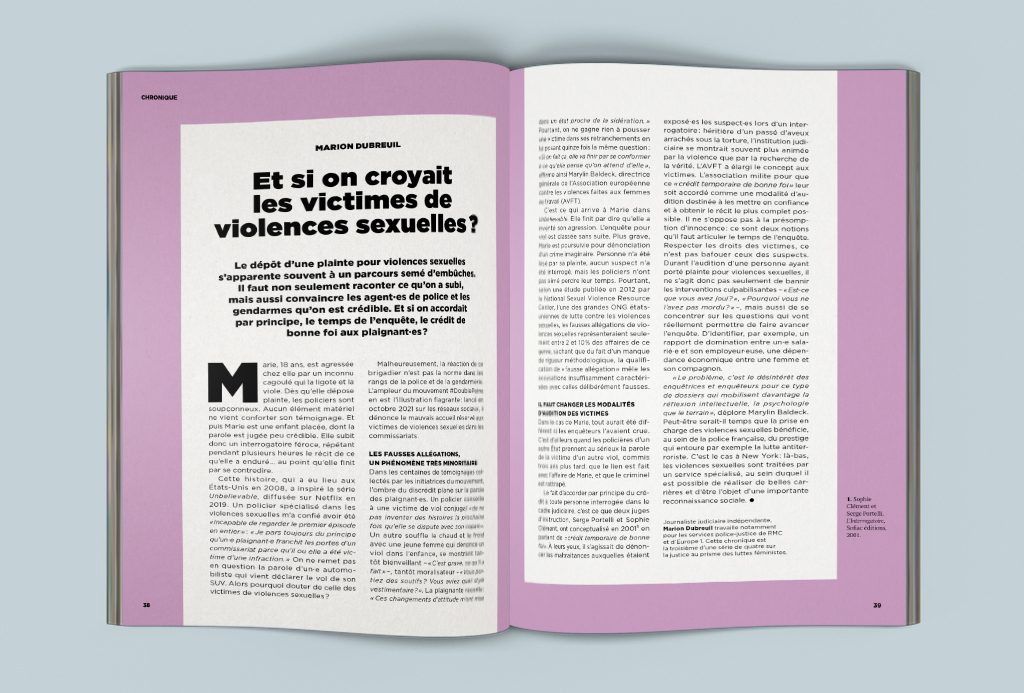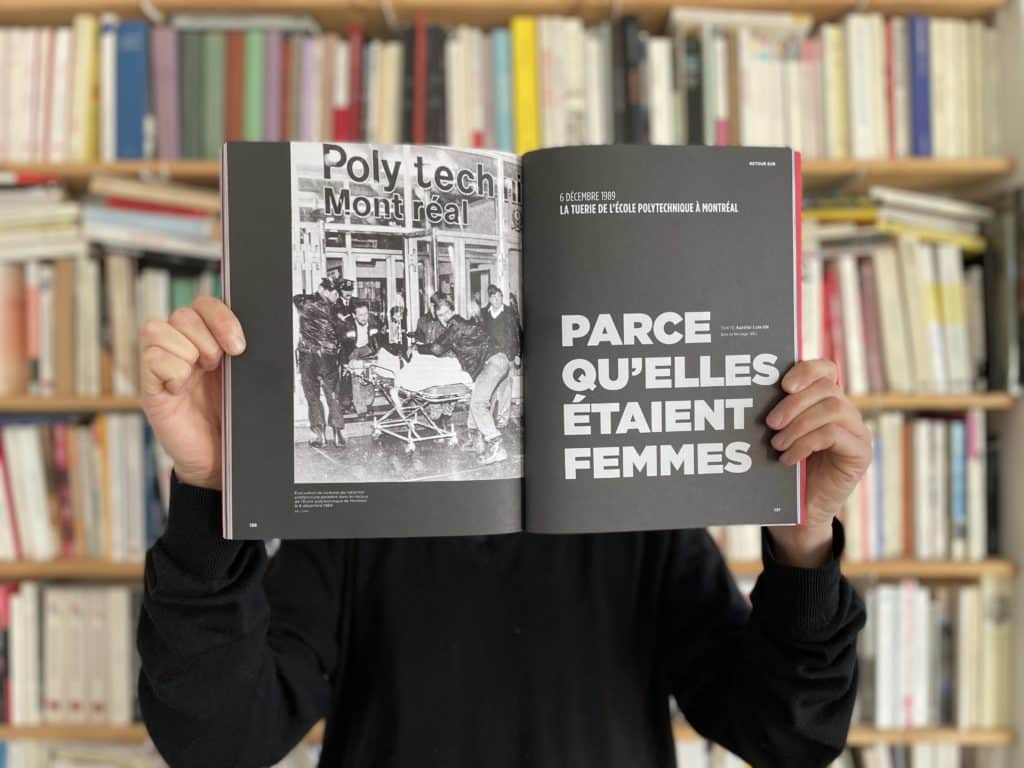Marie, 18 ans, est agressée chez elle par un inconnu cagoulé qui la ligote et la viole. Dès qu’elle dépose plainte, les policiers sont soupçonneux. Aucun élément matériel ne vient conforter son témoignage. Et puis Marie est une enfant placée, dont la parole est jugée peu crédible. Elle subit donc un interrogatoire féroce, répétant pendant plusieurs heures le récit de ce qu’elle a enduré… au point qu’elle finit par se contredire.
Cette histoire, qui a eu lieu aux États-Unis en 2008, a inspiré la série Unbelievable, diffusée sur Netflix en 2019. Un policier spécialisé dans les violences sexuelles m’a confié avoir été « incapable de regarder le premier épisode en entier » : « Je pars toujours du principe qu’un·e plaignant·e franchit les portes d’un commissariat parce qu’il ou elle a été victime d’une infraction. » On ne remet pas en question la parole d’un·e automobiliste qui vient déclarer le vol de son SUV. Alors pourquoi douter de celle des victimes de violences sexuelles ?
Malheureusement, la réaction de ce brigadier n’est pas la norme dans les rangs de la police et de la gendarmerie. L’ampleur du mouvement #DoublePeine en est l’illustration flagrante : lancé en octobre 2021 sur les réseaux sociaux, il dénonce le mauvais accueil réservé aux victimes de violences sexuelles dans les commissariats.
Les fausses allégations, un phénomène très minoritaire
Dans les centaines de témoignages collectés par les initiatrices du mouvement, l’ombre du discrédit plane sur la parole des plaignant·es. Un policier conseille à une victime de viol conjugal « de ne pas inventer des histoires la prochaine fois qu’elle se dispute avec son copain ». Un autre souffle le chaud et le froid avec une jeune femme qui dénonce un viol dans l’enfance, se montrant tantôt bienveillant – « C’est grave, ce qu’il a fait » –, tantôt moralisateur – « Vous portiez des soutifs ? Vous aviez quel style vestimentaire ? ». La plaignante raconte : « Ces changements d’attitude m’ont mise dans un état proche de la sidération. »
Pourtant, on ne gagne rien à pousser une victime dans ses retranchements en lui posant quinze fois la même question : « Si on fait ça, elle va finir par se conformer à ce qu’elle pense qu’on attend d’elle », affirme ainsi Marylin Baldeck, directrice générale de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT).
C’est ce qui arrive à Marie dans Unbelievable. Elle finit par dire qu’elle a inventé son agression. L’enquête pour viol est classée sans suite. Plus grave, Marie est poursuivie pour dénonciation d’un crime imaginaire. Personne n’a été lésé par sa plainte, aucun suspect n’a été interrogé, mais les policiers n’ont pas aimé perdre leur temps.
Pourtant, selon une étude publiée en 2012 par le National Sexual Violence Resource Center, l’une des grandes ONG états-uniennes de lutte contre les violences sexuelles, les fausses allégations de violences sexuelles représenteraient seulement entre 2 et 10 % des affaires de ce genre, sachant que du fait d’un manque de rigueur méthodologique, la qualification de « fausse allégation » mêle les accusations insuffisamment caractérisées avec celles délibérément fausses.
Il faut changer les modalités d’audition des victimes
Dans le cas de Marie, tout aurait été différent si les enquêteurs l’avaient crue. C’est d’ailleurs quand les policières d’un autre État prennent au sérieux la parole de la victime d’un autre viol, commis trois ans plus tard, que le lien est fait avec l’affaire de Marie, et que le criminel est rattrapé.
Le fait d’accorder par principe du crédit à toute personne interrogée dans le cadre judiciaire, c’est ce que deux juges d’instruction, Serge Portelli et Sophie Clément, ont conceptualisé en 20011Sophie Clément et Serge Portelli, L’Interrogatoire, Sofiac éditions, 2001. en parlant de « crédit temporaire de bonne foi ».
À leurs yeux, il s’agissait de dénoncer les maltraitances auxquelles étaient exposé·es les suspect·es lors d’un interrogatoire : héritière d’un passé d’aveux arrachés sous la torture, l’institution judiciaire se montrait souvent plus animée par la violence que par la recherche de la vérité. L’AVFT a élargi le concept aux victimes. L’association milite pour que ce « crédit temporaire de bonne foi » leur soit accordé comme une modalité d’audition destinée à les mettre en confiance et à obtenir le récit le plus complet possible. Il ne s’oppose pas à la présomption d’innocence : ce sont deux notions qu’il faut articuler le temps de l’enquête.
Respecter les droits des victimes, ce n’est pas bafouer ceux des suspects. Durant l’audition d’une personne ayant porté plainte pour violences sexuelles, il ne s’agit donc pas seulement de bannir les interventions culpabilisantes – « Est-ce que vous avez joui ? », « Pourquoi vous ne l’avez pas mordu ? » –, mais aussi de se concentrer sur les questions qui vont réellement permettre de faire avancer l’enquête. D’identifier, par exemple, un rapport de domination entre un·e salarié·e et son employeur·euse, une dépendance économique entre une femme et son compagnon.
« Le problème, c’est le désintérêt des enquêtrices et enquêteurs pour ce type de dossiers qui mobilisent davantage la réflexion intellectuelle, la psychologie que le terrain », déplore Marylin Baldeck.
Peut-être serait-il temps que la prise en charge des violences sexuelles bénéficie, au sein de la police française, du prestige qui entoure par exemple la lutte antiterroriste. C’est le cas à New York : là-bas, les violences sexuelles sont traitées par un service spécialisé, au sein duquel il est possible de réaliser de belles carrières et d’être l’objet d’une importante reconnaissance sociale. •