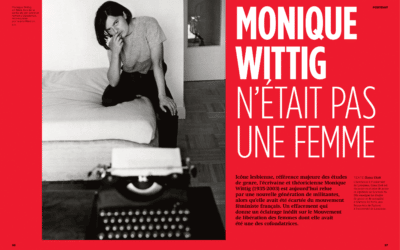En anglais, le terme queer signifie « bizarre » ou « étrange ». Il a d’abord été utilisé comme insulte (équivalente à « pédé », « gouine », « déviant·e », « tordu·e ») aux États-Unis dans les années 1990, pendant l’épidémie de sida. Puis, par un effet de retournement du stigmate, il a fait l’objet d’une réappropriation par les militant·es LGBTQIA, qui s’inscrivent dans une critique radicale du binarisme de genre (« il y a deux sexes, à la fois différenciés et hiérarchisés »). Les personnes queers rejettent les standards de l’hétérosexualité et de la binarité de genre ; elles revendiquent une identité qui subvertit les normes et les attendus sociaux. Aussi, la communauté queer peut-elle désigner la communauté LGBTQIA+, englobant toutes les identités possibles et plurielles de ses membres : lesbienne, gay, bisexuelle, trans, queer, intersexe, asexuelle… et bien plus.
Pionnière de la théorie queer, la poétesse états-unienne d’origine mexicaine, Gloria Anzaldúa, a utilisé le terme queer dès les années 1970 dans des manuscrits non publiés, et pour la première fois en 1981 dans son livre publié This Bridge Called My Back. Writings by Radical Women of Color. Elle s’en sert pour désigner toutes les personnes qui font l’expérience des marges et des frontières, peut-on lire dans l’article « Gloria Anzaldúa, penseuse de la théorie queer décoloniale » : « Ici vivent les gens louches, les pervers, les queers, les pénibles, les métis […], les demi-morts ; bref, ceux […] qui franchissent les confins du “normal” », écrit-elle.
Le dépassement revendiqué des normes sociales touche aussi l’institution familiale : au-delà du modèle de filiation biologique « un papa et une maman cisgenres et des enfants nés de leur union », la communauté LGBTQIA+ imagine d’autres modalités de faire famille. La sociologue Gabrielle Richard les évoque dans l’entretien « Les parents queers réinventent le faire-famille ». La famille cis-hétéroparentale « est un peu comme une veste qui serait trop petitedans laquelle beaucoup de personnes se sentent très à l’étroit, explique-t-elle. Être queer, c’est agrandir cette veste. »
Pour aller plus loin
Teresa de Lauretis, Théorie queer et cultures populaires, La Dispute, 2023 [2007].
Judith Butler, Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l’identité, trad. Cynthia Kraus, La Découverte, 2006 [1990].
Meg-John Barker, Jules Scheele, Queer Theory, une histoire graphique, trad. Valentine Dervaux et Rémy Toulouse, La Découverte, 2023.