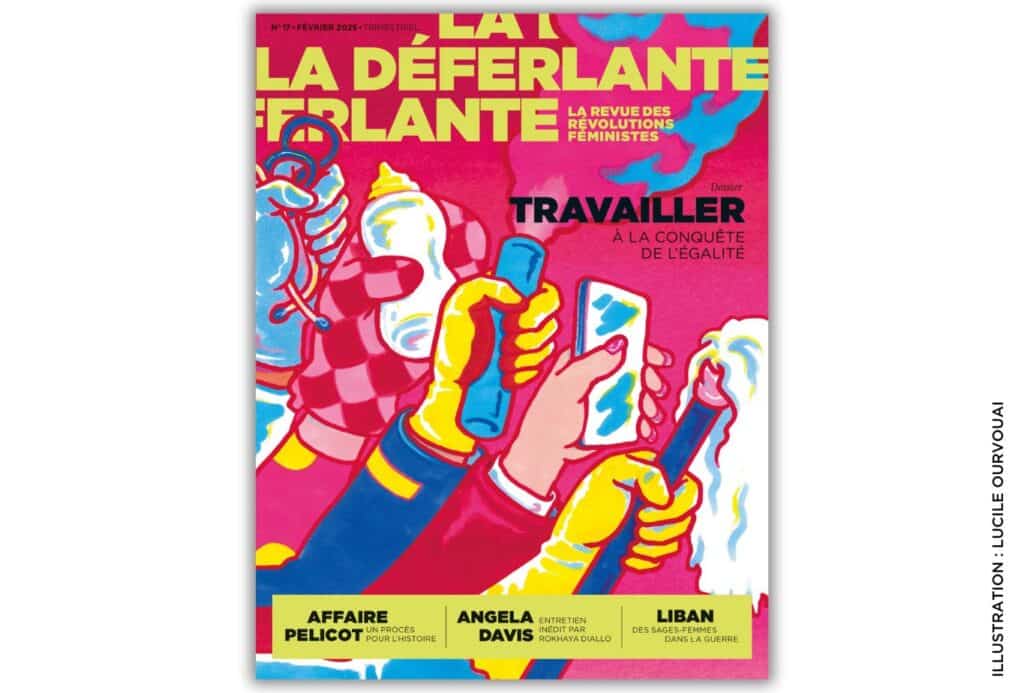Si elles sont rarement transmises à travers les générations ou relayées médiatiquement, les grèves de femmes jalonnent l’histoire ouvrière et politique, dans le monde entier. En France, des ovalistes de la soie à Lyon en 1869 aux femmes de chambre de l’Ibis Batignolles à Paris de 2019 à 2021, en passant par les cigarettières italiennes à Marseille en 1887 et les transbordeuses d’oranges à la frontière franco-espagnole en 1906 (1), des milliers de femmes mobilisées ont remporté des victoires majeures quant à leurs conditions de travail.
Ainsi, depuis la fin des années 2010, dans les cortèges féministes à travers le monde, fleurissent des slogans de grève générale parmi lesquels : « Si on s’arrête, le monde s’arrête ». Ils font écho à l’appel à la « grève féministe internationale » lancé en Argentine sous l’impulsion du collectif Ni Una Menos (Pas une de moins) pour le 8 mars 2017 (pour une définition de la grève féministe, consultez notre glossaire de concepts). Ce jour-là, dans toute l’Argentine 500 000 personnes se mobilisent, elles seront 800 000 l’année suivante. Le collectif, qui lutte contre les féminicides, avait appelé à se réunir en assemblée et décidé de recourir à la grève afin de relier les violences patriarcales aux violences capitalistes et impérialistes. L’idée est née à la suite du féminicide d’une adolescente de 16 ans, Lucía Pérez, droguée, violée, torturée et assassinée par plusieurs hommes cinq mois auparavant, le 8 octobre 2016, à Mar del Plata, suscitant un émoi retentissant bien au-delà des frontières du pays. Dans La Puissance féministe. Ou le désir de tout changer (Divergences, 2021), la chercheuse argentine Verónica Gago explique que ce choix du collectif Ni Una Menos a « transformé la mobilisation contre les féminicides, centrée sur cette seule revendication “Arrêtez de nous tuer”, en mouvement radical, massif, capable d’établir des liens nouveaux et de politiser le rejet de la violence de manière inédite ». De victimes, le #NosotrasParamos (Nous nous arrêtons) « a fait de nous des sujets politiques », écrit-elle.
« Dire “ça suffit !” à la violence, au temps qui nous file entre les doigts, ne plus accepter notre épuisement physique et psychique, qui entretient une exténuante précarité. »
Verónica Gago, La Puissance féministe. Ou le désir de tout changer.
Les grèves de la colère
La stratégie de la grève est adoptée dans de nombreux pays d’Amérique latine mais aussi en Pologne, en 2016, suite à l’interdiction du droit à l’avortement, ou encore en Espagne. Le 8 mars 2018, répondant à l’appel à la grève des féministes espagnoles, 5 millions de personnes manifestent dans les rues à travers tout le pays, dont beaucoup de femmes qui cessent le travail pour la première fois de leur vie. Cette mobilisation intervient dans un contexte de grande colère : quelques mois plus tôt, pendant le procès de « la Manada (2) » contre cinq hommes qui s’étaient filmés en train de violer une jeune femme lors des fêtes de Pampelune en 2016, des photos de la victime collectées par un détective privé ont été versées au dossier, incriminant sa tenue ou ses relations sociales. En réaction, des manifestations ont eu lieu à Madrid, Barcelone, Valladolid ou encore Séville, pendant que des militant·es étaient en train de monter une grève féministe. Les conditions étaient donc réunies pour que celle-ci prenne de l’ampleur.
L’année suivante, en 2019, la grève rassemble 6 millions de personnes. En juin, les membres de la Manada sont inculpés pour viol en appel. En 2022, une loi renforçant la législation contre le viol est votée (3).
Autre grève féministe massive, le 14 juin 2019 en Suisse, où 500 000 personnes se mobilisent pour lutter contre les inégalités de genre. Depuis, cet appel à la grève est reconduit avec succès chaque année à cette date (4). En France, porté par des collectifs locaux rassemblés depuis 2020 au sein de la Coordination féministe, le mot d’ordre commence à faire son chemin, notamment depuis le mouvement de lutte contre la réforme des retraites de 2023, réforme qui s’attaquait particulièrement aux femmes.
Un outil pour transformer le monde
« Il y a une temporalité de la grève qui met en pratique un refus : dire “ça suffit !” à la violence, au temps qui nous file entre les doigts, ne plus accepter notre épuisement physique et psychique, qui entretient une exténuante précarité, écrit encore Verónica Gago dans La Puissance féministe. C’est dire non aux mille et une tâches que nous assumons, qui ne font qu’augmenter notre charge de travail gratuit et obligatoire sans nous donner plus d’autonomie économique. C’est refuser que nos efforts et notre travail restent invisibles, et comprendre que cette invisibilité structure un régime politique fondé sur un mépris systématique envers ces tâches-là. » La chercheuse pointe ici le cœur de ce qu’est la réappropriation féministe de l’outil de la grève.
Ce refus, c’est d’abord celui de l’invisibilisation et du dénigrement, par les systèmes patriarcal et capitaliste, du travail « reproductif », c’est-à-dire du travail domestique, de soin aux autres, d’éducation. Un travail en majorité assumé par les filles, les femmes et les minorités de genre, notamment racisées, gratuitement ou en échange de bas salaires, et qui les assigne à l’exploitation, la précarité, et des horaires interminables. Par exemple, en France, les femmes perdent 38 % de leurs revenus dans les dix années qui suivent l’arrivée de leur premier enfant, tandis que ceux des hommes ne bougent pas, selon un rapport du Conseil d’analyse économique publié le 28 novembre 2024. Une baisse liée en partie à la forte augmentation de travail gratuit qu’elles doivent assumer. Ce travail – le cuidado pour les hispanophones, le care pour les anglophones – permet à la société capitaliste de fonctionner. Il convient donc de le remettre au centre, en le répartissant et en le rémunérant mieux, en le collectivisant.
Dans la lignée des féminismes matérialistes, marxistes et afroféministes des années 1970, les mouvements de grève féministe élargissent ainsi les délimitations traditionnelles de ce qui est reconnu comme du travail (5). « La grève féministe, c’est la vraie grève générale », expliquent les militant·es, c’est celle qui, en revendiquant de cesser tout le travail, qu’il soit salarié, informel ou gratuit, peut bloquer un pays, proposer une autre organisation sociale, transformer le monde. C’est une grève qui « a priori ne concerne, en termes d’intérêts directs, que les femmes et minorités de genre, mais qui se doit, pour arriver à ses fins, de concerner l’ensemble de la classe exploitée et opprimée », écrit la militante française Kim Attimon dans « De la théorie à la pratique, la grève féministe n’est pas automatique » (revue Les Cahiers d’A2C – Autonomie de classe, mars 2022).
Ces mouvements vont à rebours du féminisme libéral, qui prône pour les femmes une « égalité des chances de dominer », selon l’expression des universitaires Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya et Nancy Fraser dans leur manifeste Féminisme pour les 99 %. Un manifeste (La Découverte, 2019), c’est-à-dire le pouvoir, autant que les hommes, de détruire la planète et les droits sociaux ou de mener des politiques xénophobes en devenant cheffes de gouvernement ou de multinationale. Au contraire, il s’agit d’un féminisme « radical et transformateur », qui vise à mettre conjointement fin au patriarcat et au capitalisme, et qui s’allie aux mouvements antiracistes, écologistes, contre la transphobie…
Grand banquet féministe
Si la grève féministe peut être un redoutable outil de blocage, elle permet aussi « de se dégager du temps pour élaborer et construire ensemble le monde auquel on aspire et que l’on mérite », explique Val, du collectif NousToutes35 (NT35) à Rennes. C’est par exemple l’occasion d’expérimenter concrètement des formes de collectivisation du travail reproductif, pour éviter de faire reposer le soin aux enfants, entre autres, sur les ressources individuelles de chacune en matière de délégation et de négociation de ce travail. Et pour le faire sortir, un temps, de l’isolement entre quatre murs. NT35 a ainsi organisé la préparation collective d’un grand banquet féministe qui s’est tenu le 8 mars 2023.
À Marseille, la même année, des ateliers banderoles en plein air ouverts aux enfants ont été organisés, avec de la peinture adaptée. Le jour du 8 mars, sur la Zone d’occupation féministe du Vieux-Port, aux côtés de stands de différents collectifs, une équipe de militant·es de l’inter-orga Marseille8Mars (M8M) s’est relayée pour les garder, avec livres, crayons et jeux, dans un espace accueillant, avant de les embarquer dans la manifestation à bord d’un char en palettes construit pour l’occasion et paré des banderoles peintes pendant les ateliers.

Un processus plutôt qu’une fin en soi
Si elle peut être spectaculaire au moment du 8 mars ou du 14 juin, la grève féministe « n’est pas un événement isolé, c’est un processus », poursuit Verónica Gago. Comme toute grève, elle naît d’abord sur un terreau de luttes préexistant. En Argentine, par exemple, elle s’inscrit dans une filiation multiple : un mouvement des femmes ancien et renouvelé qui a lutté pour la légalisation de l’avortement et contre les féminicides ; les mères et grands-mères de la place de Mai qui, depuis 1977, manifestent pour leurs enfants et petits-enfants disparu·es de la dictature militaire ; les piqueteros, grand mouvement social des chômeur·euses des années 1990 contre les politiques d’austérité. Ensuite, elle se construit par une organisation à différents échelons, en coordinations nationales, assemblées et commissions locales, intersyndicales, etc.
En Suisse romande, par exemple, la grève féministe s’organise de façon très décentralisée, sur la base d’un consensus minimal autour d’une quinzaine de revendications, élaborées collectivement et consignées dans un Manifeste auquel adhère tout collectif estampillé « Grève féministe ». « Ça fait que, malgré des conflits et des désaccords, on lutte quand même ensemble », explique Vanessa, syndicaliste et militante de la Grève féministe du canton de Vaud. Il y a des collectifs dans les cantons et les universités, au niveau des villes et parfois même des quartiers, et de multiples façons de s’approprier l’outil. En Espagne, l’organisation est peu ou prou la même.
La relation aux syndicats est un enjeu de réussite important. En Suisse, la grève a vu le jour à l’initiative des syndicalistes féministes, et les deux années où la mobilisation a été la plus massive, 2019 et 2023, sont celles où s’est tenu, en amont, le congrès féministe de l’Union syndicale suisse. D’un côté, les syndicalistes féministes bataillent en interne pour imposer la grève féministe à l’agenda syndical. De l’autre, elles emmènent les féministes soutenir les mobilisations syndicales. Dans le du canton de Vaud, ces liens ont payé, avec des victoires comme l’augmentation des salaires minimaux des professionnel·les de santé et des réglementations sur le harcèlement sexuel.
En France, des liens se tissent à certains endroits, plus ou moins aisément. Des cortèges féministes ont été organisés dans de nombreuses manifestations contre la réforme des retraites en 2023, une partie des militant·es sont aussi syndiqué·es et, en 2024, les syndicats ont appelé à la grève le 8 mars. « La grève féministe, ce n’est pas que le 8 mars, c’est aussi regarder les grèves en féministe, ajoute Marion de M8M, et aller soutenir les mobilisations des femmes de chambre ou du secteur de la petite enfance. »
Une mobilisation permanente
Enfin, la grève féministe se construit par l’occupation quotidienne du terrain, pour la faire connaître, l’expliquer, y rallier toujours plus de monde. À Rennes, NT35 « s’est beaucoup employé à marteler ce mot d’ordre », explique Maria, y compris sous forme de chansons – notamment « sans nous le monde s’arrête », sur l’air de Freed from Desire, reprise dans toutes les manifs rennaises. Le collectif a « pris de la place dans la rue », au gré des manifestations, flash-mobs, collages, tractage… et a multiplié les moments de rencontre et d’organisation : assemblées, soirées, festivals, ciné-débats, temps d’élaboration collective et moments de transmission d’histoires de lutte, comme le centenaire de la grève des Penn Sardin de 1924 (lire l’évocation de la grève des sardinières dans l’encadré de l’article “Dans le Finistère l’adieu au sardinières”).
Au-delà des journées de mobilisation de masse, comment faire pour tout changer ? En Suisse, après des années « la tête dans le guidon » pour organiser le 14 juin, les militantes s’interrogent. « On encourage les gens à s’organiser toute l’année, peu importe où, association, syndicat, collectif, explique Vanessa, parce que ça ne va pas suffire de se mobiliser juste une fois dans l’année ». L’objectif, c’est d’entretenir un « état de mobilisation permanent » sur le terrain, écrit Kim Attimon. Pour cela, depuis 2022, NT35 a lancé des comités dans chaque quartier rennais, en plus de l’assemblée plénière. Il s’agit de « permettre aux personnes de s’organiser à côté de là où elles vivent ou travaillent, de les toucher au plus près de leurs problématiques, de favoriser les échanges et la solidarité en lien avec les associations et collectifs du quartier », explique Lo, membre du collectif NT35.
Pendant la campagne électorale de juin 2024, les plus actifs de ces comités féministes ont servi de support pour activer rapidement la mobilisation contre l’extrême droite – entretenir le terrain, c’est aussi une forme concrète d’antifascisme indispensable dans le contexte actuel. « S’organiser, militer, ça peut paraître fastidieux, parce que tu t’engages à avoir des conflits, gérer des trucs pénibles, conclut Marion de M8M. Mais ça fait aussi se sentir moins seul·e avec sa rage, ça fait vraiment du bien. Dans la période politique actuelle, on voit que les gens se mettent à avoir l’intérêt pour ça. Et ça, c’est gagné. »
Islande, 1975 : les femmes mettent le pays à l’arrêt
Ce fut un jour historique. Le 24 octobre 1975, 90 % des femmes en Islande se mettent en grève. Elles refusent de faire à manger, de garder les enfants et d’aller au travail.
Le pays tout entier est bloqué. Les écoles, les magasins et les banques ne peuvent pas ouvrir, les usines tournent au ralenti, les communications téléphoniques ne passent pas, faute d’opératrices. Ce « jour de congé des femmes », comme l’ont appelé les organisatrices, remplit son objectif : montrer que le travail des femmes, qui gagnent alors 60 % de moins que les hommes, est essentiel au bon fonctionnement de la société. Ce jour-là donc, les Islandaises prennent la rue et la parole, chantent et mangent ensemble, découvrent des brochures féministes d’autres pays apportées par les hôtesses de l’air en grève. Dans la foulée de cette grève d’une journée, les Islandaises obtiennent, entre autres, le droit à l’IVG, la création de crèches et des gages d’égalité.
Cinq ans plus tard, en 1980, l’Islande sera le premier pays au monde à élire une femme présidente, Vigdís Finnbogadóttir – qui participa à cette grève générale. Aujourd’hui, le pays est en tête des classements mondiaux sur l’égalité de genre.
(1) Deux BD font référence à ces deux événements : La Belle de mai, fabrique de révolutions, de Mathilde Ramadier et Élodie Durand (Futuropolis, 2024), et La Révolte des orangères de Thomas Azuélos (dans La Déferlante no3, 2021).
(3) Surnommé « Seul un oui est un oui », le texte de loi introduit l’obligation d’un accord explicite. Tout acte sexuel sans consentement explicite est, désormais, reconnu comme un viol.
(4) La date a été choisie en écho au 14 juin 1981, jour où la Suisse accepte l’introduction du principe d’égalité entre les hommes et les femmes dans la Constitution, en particulier dans les domaines de la famille, de l’instruction et du travail. Dix ans plus tard, le 14 juin 1991, une grande grève féministe avait eu lieu dans tout pays pour l’égalité dans le travail sous le slogan « Les femmes bras croisés, le pays perd pied ».
(5) Lire l’article « Chez soi, travail sans frontières ? » d’Elsa Sabado et Sylvie Fagnart.
Mathilde Blézat
Journaliste indépendante et coautrice de Notre corps nous-mêmes. Manuel féministe (Hors d’atteinte, 2020) et de Pour l’autodéfense féministe (Éditions de la dernière lettre, 2022).