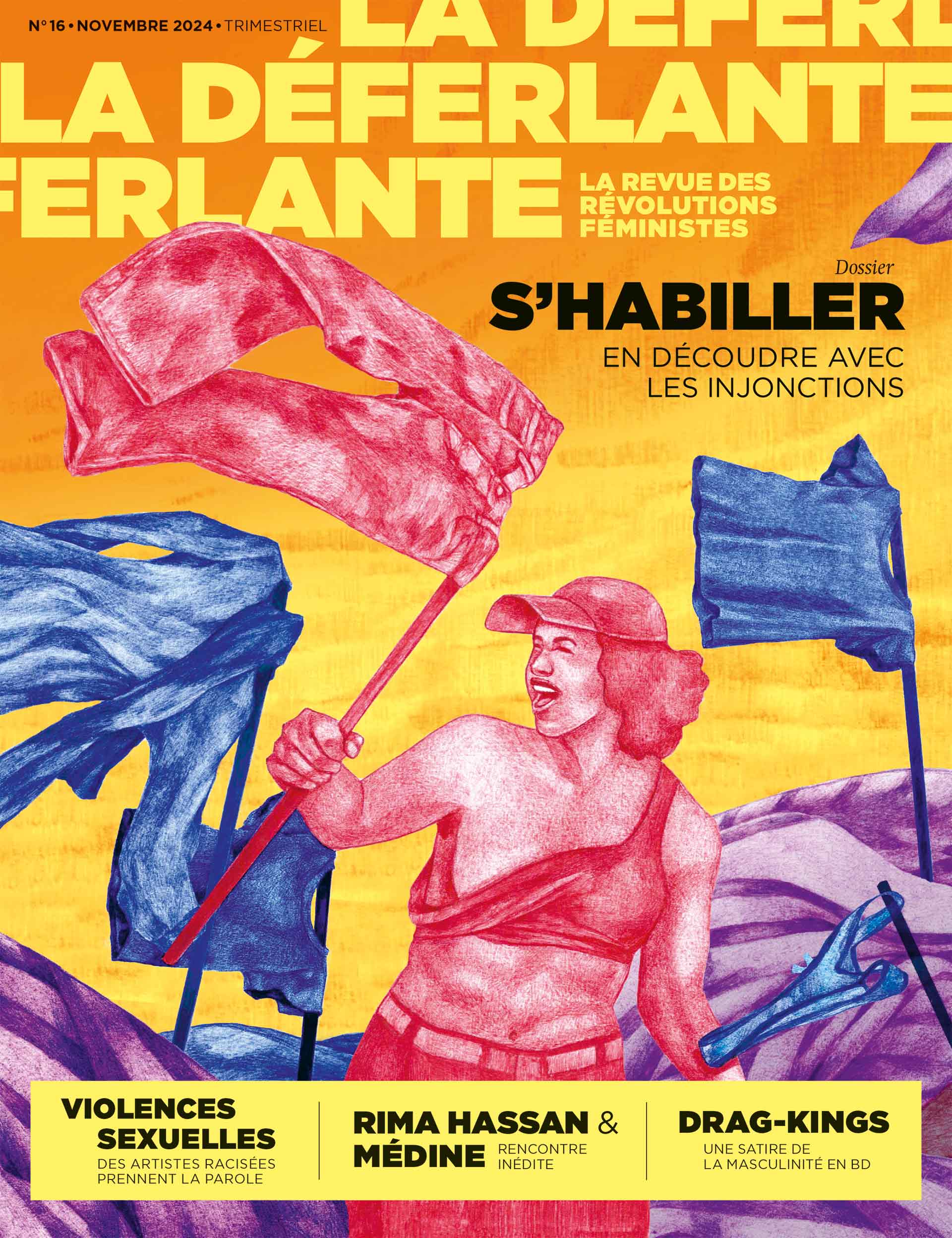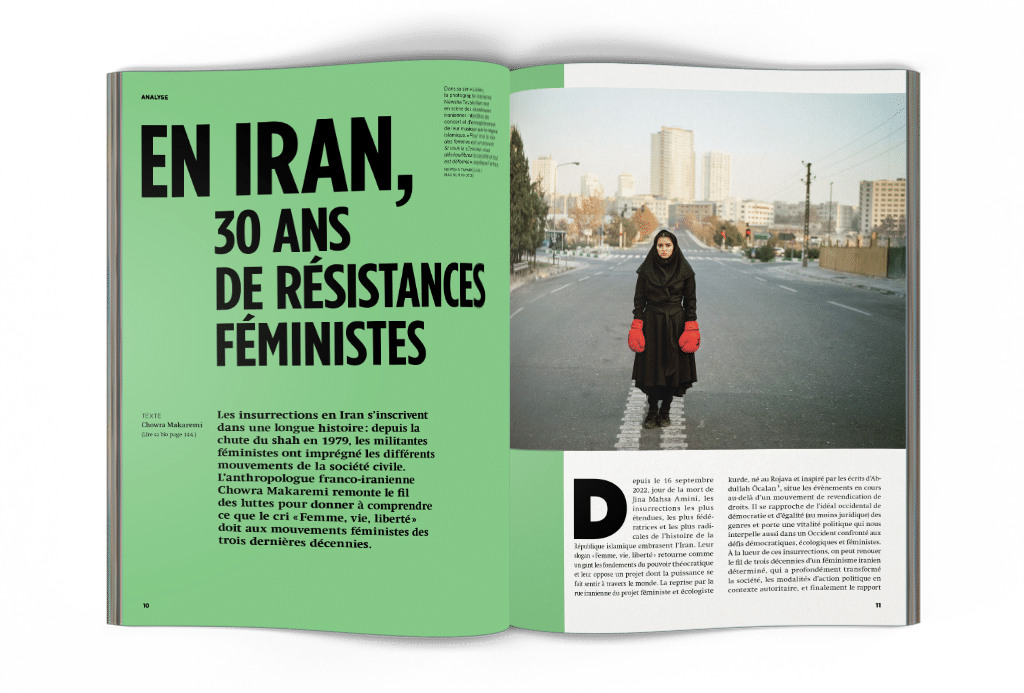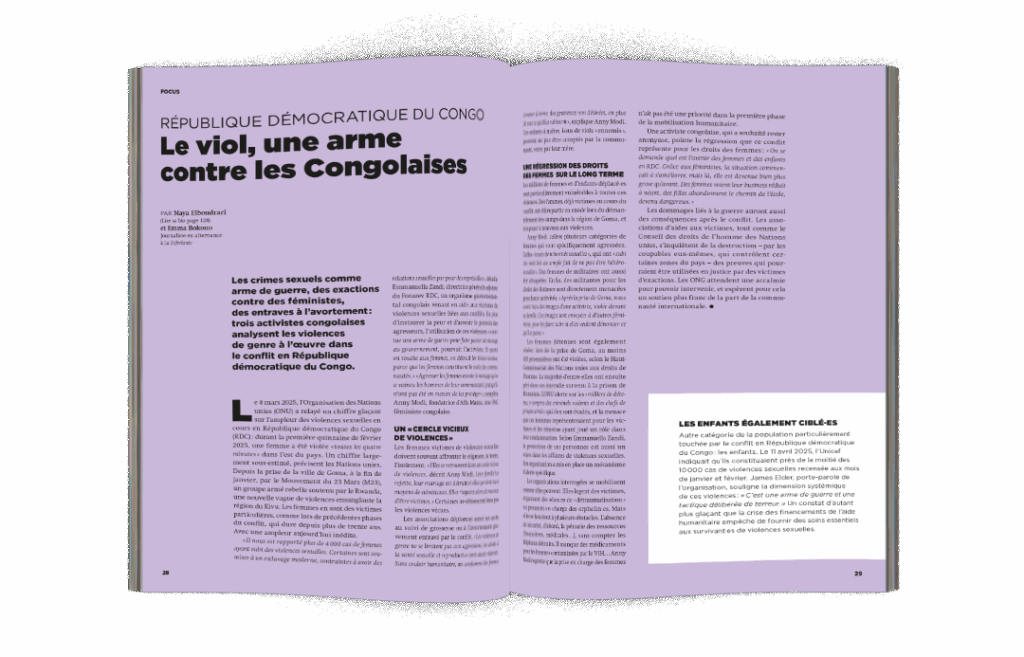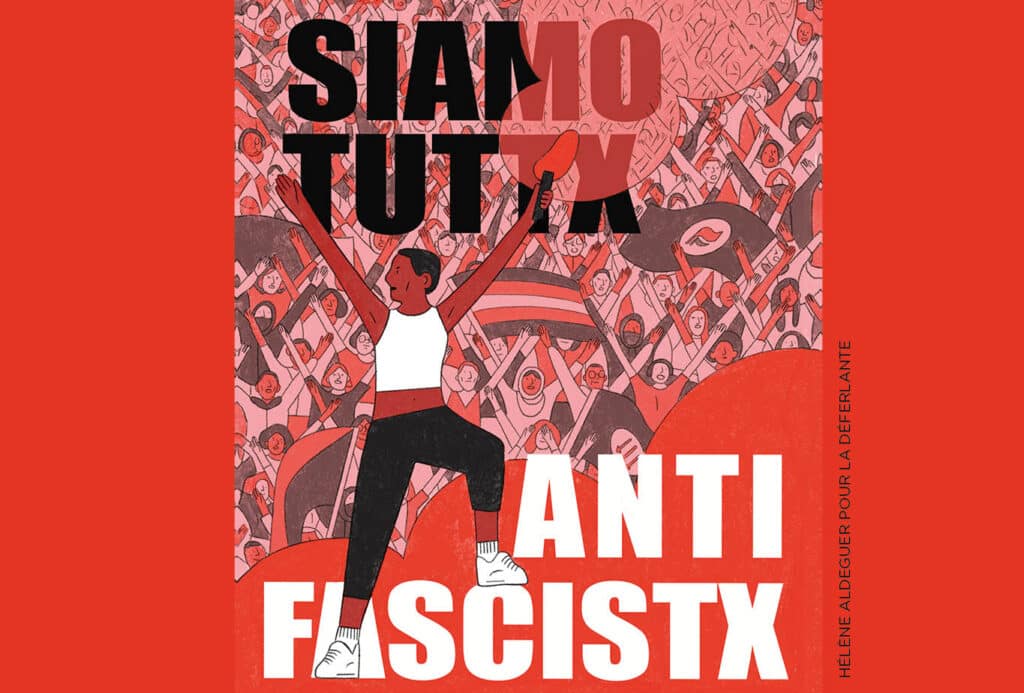« Vous me haïssez, mais vous ne me connaissez même pas », lâche la jeune boxeuse algérienne. Dans l’émission « Clique », sur Canal+, le 9 septembre 2024, Imane Khelif revient pour la première fois sur le cyberharcèlement massif dont elle a été victime quelques semaines auparavant. Humble, elle raconte son parcours, de son enfance dans un petit village d’Algérie jusqu’aux Jeux olympiques de Paris, où elle décroche le 9 août 2024 la médaille d’or chez les moins de 66 kilos.
Au-delà de son titre, c’est aussi pour le déferlement de haine qu’elle a subi qu’elle est connue dans le monde entier. Tout commence le 1er août 2024 : la boxeuse italienne Angela Carini abandonne en huitième de finale au bout de 46 secondes, après un direct d’Imane Khelif qui lui a « fait trop mal ». Elle quitte le ring sans saluer son adversaire, et souffle : « Ce n’est pas juste. » L’image devient virale, et les réseaux sociaux s’emballent.
Il n’en fallait pas plus pour que la désinformation s’installe : Imane Khelif ne serait pas vraiment une femme. « Les athlètes présentant des caractéristiques masculines ne devraient pas être autorisés à participer aux compétitions féminines », argue Giorgia Meloni, présidente du Conseil italien, figure de l’extrême droite européenne (lire La Déferlante n°15, août 2024). À sa suite, des personnalités de la sphère conservatrice suivies par des centaines de milliers d’abonné·es sur les réseaux sociaux s’en mêlent : « Je garderai les hommes hors du sport féminin ! » s’empresse de promettre l’ancien président américain Donald Trump sur son réseau Truth Social. Elon Musk, patron de X, commente d’un « absolument » le post de la nageuse états-unienne Riley Gaines affirmant que « les hommes n’ont rien à faire dans le sport féminin ». Sur X toujours, l’autrice britannique J. K. Rowling, connue pour ses positions transphobes, écrit : « Une image pourrait-elle mieux résumer notre nouveau mouvement pour les droits des hommes ? » sur une photo montrant Angela Carini en pleurs. Imane Khelif est massivement moquée, critiquée et dénigrée. « C’est la première figure de femme nord-africaine qui subit un cyberharcèlement de cette ampleur, dans un déferlement de transphobie, de racisme, de sexisme et de classisme », observe la journaliste, réalisatrice et autrice Nesrine Slaoui. Si dès le 1er août, le Comité international olympique (CIO) répète qu’Imane Khelif est « née femme, enregistrée comme femme, vit sa vie en tant que femme, boxe en tant que femme », la violence ne diminue pas, au contraire.
C’est qu’Imane Khelif ne répond pas aux injonctions qui pèsent sur elle. « C’est une femme, algérienne, musulmane, excellant à l’échelle internationale, dans une discipline perçue comme masculine », résume Johanna-Soraya Cayre Benamrouche, militante féministe et cofondatrice de Féministes contre le cyberharcèlement. Un mélange de racisme et de sexisme typique de l’arabomisogynie (1), selon le concept théorisé par Nesrine Slaoui. Pour la docteure en sciences de l’information et de la communication Natacha Lapeyroux, qui s’intéresse à la médiatisation des athlètes féminines, le cas d’Imane Khelif est emblématique de ce qui est opposé aux sportives non blanches : « On accepte qu’elles boxent, mais elles doivent montrer des gages de féminité, dans leur manière de vivre ou leur apparence physique. Les stéréotypes sont fondés sur des normes hétéros occidentales qui imprègnent encore nos imaginaires. » Le corps d’Imane Khelif est passé au crible, de sa musculature à sa coupe de cheveux. On lui demande de « prouver » sa féminité, de fournir tests ADN et certificats médicaux, on spécule sur sa génétique et ses taux d’hormones. « Ce qui est arrivé à Imane Khelif est l’expression de la postcolonialité, des LGBT+phobies et du patriarcat à une échelle globale », ajoute Johanna-Soraya Cayre Benamrouche.
Dans le viseur : Les LGBT+, les racisé·es et les jeunes femmes
Ainsi, quelques jours après qu’Imane Khelif a remporté la médaille d’or, Aimée-Noël Mbiyozo, chercheuse de l’Institute for Security Studies (ISS) Africa, notait que « tous les cas connus de femmes athlètes disqualifiées concernaient des femmes du Sud global, la plupart […] d’Afrique (2) ». Elle cite les cas des athlètes africaines Caster Semenya, Margaret Wambui ou Maximila Imali, entravées dans leur carrière depuis que la Fédération internationale d’athlétisme a commencé, en 2019, à exclure les femmes ayant un taux de testostérone supérieur à 5 nanomoles par litre de sang. Pour pouvoir concourir, elles doivent suivre un traitement invasif inhibiteur de testostérone. « Ces tests “de féminité” ont été une pratique racialisée qui a impacté les femmes du Sud global. Le CIO les a bannis, car ils sont non scientifiques et dégradants », commente Andrea Florence, avocate et directrice de Sport & Rights Alliance, une coalition d’organisations qui lutte pour le respect des droits humains dans le sport.
À cette violence institutionnelle s’ajoute la violence en ligne que peuvent subir non seulement les athlètes racisées, mais toute personne racisée présente en ligne. Dans une étude de Féministes contre le cyberharcèlement et Ipsos réalisée en 2022, 4 personnes sur 10 déclarent avoir déjà été victimes de cyberviolences en France. Ces violences visent en particulier les personnes LGBT+ (85 %), les personnes racisées (71 %) et les femmes de moins de 35 ans (65 %). Si cette haine est généralisée, la violence est particulièrement forte sur certains réseaux sociaux : dans une étude d’Amnesty International de 2018, on apprenait que sur le réseau social X (encore appelé Twitter à ce moment-là), les femmes noires étaient 84 % plus susceptibles que les femmes blanches d’être mentionnées dans des tweets abusifs ou problématiques. « Les moyens numériques permettent à des groupes sociaux ayant un dénominateur commun de se coordonner et d’agir ensemble. La dématérialisation n’est pas à l’origine de cette haine, mais participe à objectiver les femmes et à les déshumaniser », analyse Johanna-Soraya Cayre Benamrouche.
Ingérence internationale
Dans le cas d’Imane Khelif, les cyberattaques sont d’abord venues des États-Unis, de Grande-Bretagne, d’Italie, et plus généralement des pays occidentaux. Elles s’ancrent dans un climat de transphobie ambiante, alimenté par des courants conservateurs et réactionnaires vent debout contre les droits des personnes trans. Ces courants se servent des réseaux sociaux pour propager désinformation et violence. Cela se cristallise autour de la question du sport, alors que de nombreuses délégations sportives interdisent aux femmes trans de participer à des compétitions, comme la fédération internationale d’athlétisme ou celle d’échecs.
Le tweet de J. K. Rowling dénonçant « le sourire narquois d’un homme qui se sait protégé par un établissement sportif misogyne », accompagné d’une photo de la boxeuse, a dépassé les 122 millions de vues.
Ce cyberharcèlement, explique la chercheuse Natacha Lapeyroux, s’intègre ainsi à « des stratégies politiques plus fortes : convaincus que l’Algérie aurait envoyé une femme trans aux Jeux olympiques, des cyberharceleurs ont attaqué Imane Khelif sur ce mythe du “lobby LGBT” ». Les JO, plus grand événement sportif mondial, font figure d’aubaine. « Cela tombe sous le sens que les extrêmes droites utilisent cette affaire pour montrer leurs insécurités et leur racisme », commente ainsi Andrea Florence. Certaines publications haineuses sur X atteignent des sommets d’audience : par exemple, le tweet de J. K. Rowling dénonçant « le sourire narquois d’un homme qui se sait protégé par un établissement sportif misogyne », accompagné d’une photo de la boxeuse, a dépassé les 122 millions de vues.
Cette polémique a rapidement pris une tournure géopolitique. Parmi les arguments des détracteurs et détractrices de la boxeuse algérienne : le fait qu’elle ait été exclue des Mondiaux de 2023 à New Delhi par la Fédération internationale de boxe (IBA) après un « test d’éligibilité » – une décision contestée par le CIO, au motif qu’elle a été « prise sans aucune procédure appropriée ». L’IBA est une instance privée, non reconnue par le CIO, notamment à cause de scandales d’arbitrages, de dettes et de trafic d’héroïne. Umar Kremlev, son directeur général, est par ailleurs un proche de Vladimir Poutine. Après la victoire de Khelif, Kremlev s’est dépêché de donner une conférence de presse : il a reproché au président du CIO, Thomas Bach, de tuer le sport féminin et l’a traité de « sodomite en chef ». Sur la scène politique et médiatique russe, jusqu’aux plus hauts sommets de l’État, les réactions ne se sont pas fait attendre : au début de septembre 2024, Vladimir Poutine, sans nommer Imane Khelif, a qualifié sa victoire d’« injuste » et a indiqué que « n’importe quel homme peut simplement se déclarer femme et participer à n’importe quelle compétition sans donner aux femmes la moindre chance de remporter des médailles, encore moins de premières places ». Une manière d’alimenter le soft power sur les questions de genre qu’il exerce depuis des années : à travers de nombreuses lois anti-LGBT+, Poutine veut montrer son opposition à un Occident qu’il perçoit comme « sataniste » et décadent, opposé aux « valeurs traditionnelles » qu’il défend. « On a fait d’Imane Khelif le symbole d’une idéologie à combattre pour mieux imposer le statu quo qui prône une vision essentialiste du genre », résume Johanna-Soraya Cayre Benamrouche.
Lire aussi : la newsletter de La Déferlante : « La guerre des mœurs de Vladimir Poutine », Audrey Lebel, 12 mai 2023
Selon Alice Apostoly, spécialiste de la diplomatie féministe et des questions de genre à l’international, cofondatrice de l’Institut du genre en géopolitique, « on se retrouve avec deux blocs qui s’éloignent de plus en plus : l’un avec des pays qui soutiennent les notions d’égalité de genre, et l’autre avec des pays qui s’y opposent ». Dans ce second bloc, on trouve des dirigeant·es d’extrême droite, qui luttent contre « l’idéologie du genre », des États-Unis de Trump au Brésil de Bolsonaro, en passant par la Russie de Poutine ou la Hongrie d’Orbán et l’Italie de Giorgia Meloni. « On assiste à une diabolisation du féminisme intersectionnel qui facilite les attaques transphobes. Le genre est dans le viseur de ces puissances », insiste Alice Apostoly.
Peu de cyberharceleurs sur le banc des prévenus
Les plaintes pour cyberviolences sont peu nombreuses à déboucher sur un procès et donnent souvent lieu à de longs et coûteuses démarches pour les plaignant·es. Fréquemment victime de campagnes de cyberharcèlement, la journaliste et essayiste Rokhaya Diallo en sait quelque chose. À ce jour, un seul des procès qu’elle a intentés a abouti à une condamnation : en 2014, le tribunal correctionnel de Paris a condamné à 2 000 euros d’amende et 1 000 euros de dommages et intérêts un homme qui avait appelé à la violer sur le réseau Twitter.
Dernièrement, deux autres cas médiatiques en France ont toutefois montré que ces questions sont davantage prises au sérieux. La journaliste Nadia Daam a été victime d’un cyberharcèlement massif en 2017, à la suite d’une chronique qu’elle avait faite pour Europe 1 sur le forum jeuxvideo.com : des informations personnelles ont été révélées, elle a reçu des centaines de menaces de mort et de viol. Des attaques qui l’avaient forcée à déménager. En 2019, un homme a été condamné à cinq mois de prison avec sursis et 2 500 euros pour préjudice moral. En 2022, la cour d’appel de Rennes a ajouté un sursis probatoire de trois ans, 4 000 euros de dommages et intérêts et l’obligation de se soumettre à des soins psychiatriques, pour menace de crime envers Nadia Daam et sa famille.
Durant l’hiver 2023–2024, c’est l’agente d’influenceur·euses Magali Berdah qui est victime de cyberharcèlement massif, sexiste et antisémite, à la suite des dénonciations du rappeur Booba sur des arnaques commises par des influenceur·euses. Dans cette affaire, en mars 2024, 28 personnes ont été jugées pour cyberharcèlement aggravé, menaces de mort ou encore menaces de crime, écopant de peines de prison allant jusqu’à un an ferme.
Cela se traduit notamment par l’émergence d’alliances transnationales prétendant protéger les « valeurs de la famille », une famille forcément hétérosexuelle, cisgenre et si possible catholique. Par exemple, en octobre 2020, une trentaine d’États ont signé la Déclaration de consensus de Genève, un texte d’alliance sans valeur juridique, qui vise à condamner l’avortement. Parmi ses signataires, les États-Unis, la Pologne ou la Hongrie, mais aussi de nombreux États africains, des pays du Golfe, le Brésil, le Paraguay, la Biélorussie, ou encore l’Indonésie (3). Les mouvements antiféministes et masculinistes deviennent globaux, organisés, hors ligne comme en ligne, en témoignent les attaques contre les féministes en Corée du Sud (4), contre le droit à l’avortement ou contre les droits des familles homoparentales et des personnes trans dans de nombreux pays.
La difficulté d’obtenir justice
Le 10 août 2024, Nabil Boudi, avocat au barreau de Paris, annonce sur X qu’Imane Khelif a saisi son cabinet et a déposé plainte « pour des faits de cyberharcèlement aggravé auprès du pôle de lutte contre la haine en ligne du parquet de Paris ». Ce dernier a ouvert une enquête préliminaire pour harcèlement aggravé et injure publique en raison du genre et de l’origine et provocation publique à la discrimination. Car si le cyberharcèlement a été international et s’est, par définition, produit en ligne, c’est en France qu’Imane Khelif a porté plainte : c’est là où elle se trouvait au moment où les abus ont été perpétrés. Il se trouve que « la France est l’un des pays au monde dont le dispositif légal est le plus avancé autour des cyberviolences. Certains discours sont juridiquement reconnus comme violents et pouvant causer des dommages et des préjudices », indique Ketsia Mutombo, de Féministes contre le cyberharcèlement.
Reste à savoir si Imane Khelif obtiendra réparation. Rien n’est moins sûr. En effet, les cyberviolences, quand elles sont rapportées, sont peu condamnées. « Notre étude de 2022 montre qu’une victime sur trois s’est vu refuser le dépôt de plainte, et que seulement 30 % des plaintes ont abouti à l’ouverture de poursuites », indique Ketsia Mutombo. En cause, le manque de formation des forces de l’ordre et de la justice sur les cyberviolences, souvent considérées comme moins graves que les autres, et donc moins prioritaires. Pour les cas dont les auteur·ices et les victimes proviennent de pays différents, l’affaire est encore plus complexe : les juridictions nationales se renvoient la balle, ne s’estimant parfois pas compétentes, tandis que certaines lois nationales sont encore en retard par rapport à la réalité d’Internet. De plus, les instances de protection des victimes contre la haine en ligne manquent souvent de moyens, à l’instar de la plateforme Pharos (5), qui ne compte qu’une cinquantaine d’enquêteur·ices pour des milliers de signalements chaque mois.
Pour les victimes françaises de cyberviolences, certaines associations, comme France Victimes, e‑Enfance ou la Fondation des femmes, proposent des aides juridiques, mais souvent les procédures sont longues, malgré l’existence de preuves. Si certaines affaires médiatiques, comme celles de la journaliste Nadia Daam ou de l’agente d’influenceur·euses Magali Berdah (lire l’encadré ci-contre), ont pu montrer que la justice prend de plus en plus en compte les cas de cyberviolences, la route reste longue. « Les voies judiciaires peuvent être coûteuses, épuisantes, traumatisantes, soupire Andrea Florence. Si Imane Khelif choisit la voie légale et que ça lui permet de guérir, je l’encourage. Mais pour beaucoup de victimes, la justice n’est pas toujours signe d’apaisement. » •
Cet article a été édité par Mathilde Blézat.
(1) Nesrine Slaoui, Notre dignité. Un féminisme pour les Maghrébines en milieux hostiles (Stock, 2024). Inspirée de la notion de « misogynoir » [lire l’encadré page 39], l’arabomisogynie désigne l’intersection du racisme et du sexisme que subissent les femmes arabes ou perçues comme telles.
(2) Aimée-Noël Mbiyozo, « Quand les athlètes africaines seront-elles assez féminines ? », ISS Today, 13 août 2024.
(3) Les États-Unis et le Brésil ont, depuis, retiré leur signature.
(4) En Corée du Sud, les mouvements masculinistes se renforcent depuis plusieurs années. Voir aussi la carte page 10, et le portfolio d’Agnès Dherbeys dans notre numéro 15, « Résister en féministes », août 2024.