Dans le milieu des start-up, on aime les bonnes histoires. Ida Tin en a plusieurs à son répertoire. L’entrepreneuse danoise a cofondé Clue en 2012, une application qui permet de suivre son cycle menstruel sur smartphone. Dans la presse, elle raconte que son propre service l’a aidée à tomber enceinte.
Parfois, elle mentionne son enfance à voyager à moto avec ses parents, et comment cela lui a ouvert les yeux sur l’importance des droits reproductifs partout dans le monde. Souvent, elle insiste sur les difficultés qu’elle a eues pour lever des fonds pour son entreprise, face à des investisseurs majoritairement masculins qui ne voyaient pas le potentiel de son projet.
Mais il y a une autre histoire sur laquelle Ida Tin est moins loquace : comment Clue, aux côtés d’autres applications de suivi des règles, a été accusée de mettre en danger les personnes menstruées aux États-Unis, à la suite de l’abrogation du célèbre arrêt Roe vs Wade en juin 2022 (1). Et si ces outils, très pratiques pour connaître l’arrivée des menstruations et surveiller d’autres paramètres de santé gynécologique, se retournaient contre leurs utilisateur·ices ? Et si leurs données intimes se retrouvaient entre les mains de la justice, laquelle pourrait les condamner pour avortement illégal ? « Si vous utilisez une application de suivi des règles, supprimez-la tout de suite », recommandait carrément une entrepreneuse dans un tweet partagé plus de 60 000 fois en 2022.
Psychose injustifiée ou réveil salutaire ? Dans tous les cas, cette séquence a provoqué un fort malaise dans l’industrie de la femtech, qui revendiquait jusqu’ici une image féministe. C’est justement Ida Tin qui a inventé en 2016 le terme (abréviation de female technology) pour désigner l’activité des start-up liées à la santé gynécologique et au bien-être des personnes s’identifiant comme femmes. Elles développent objets connectés, applications ou plateformes consacrées à la santé reproductive ou périnéale, à la maternité, au post-partum, au bien-être sexuel, à la ménopause, à certaines maladies chroniques (endométriose, syndrome des ovaires polykystiques (2)) et, donc, au suivi des menstruations à des fins de contraception, d’aide à la fertilité ou simplement pour mieux s’informer. Dans ce dernier cas, on peut aussi parler de « menstrutech » [un terme proposé par l’autrice de ces lignes en 2017 et repris depuis par plusieurs médias français].
La femtech est un marché en pleine croissance. En 2020, sa valorisation était estimée à 21,7 milliards de dollars, d’après l’agence FemTech Analytics, qui prévoit qu’elle sera multipliée au moins par trois d’ici à 2027. Mais c’est aussi un secteur qui a longtemps été sous-valorisé dans le milieu des nouvelles technologies, et dont le développement est encore entravé par le sexisme ambiant. « Dès lors qu’un sujet est rattaché aux femmes ou à la santé gynécologique, il y a cette impression qu’il s’agit d’une niche », explique Marion Coville, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’université de Poitiers, qui mène des recherches sur la femtech depuis plusieurs années. « Peu importe que, d’un point de vue numérique, cela puisse concerner la moitié de la population. Étant donné que la plupart des espaces de prise de décision scientifique ou économique sont dominés par les hommes, les questions qui touchent les femmes seront toujours considérées comme de moindre intérêt ou clivantes. »
21,7 milliards de dollars
C’est la valeur estimée de la femtech en 2020, selon l’agence FemTech Analytics, qui prévoit un triplement de ce chiffre d’ici à 2027.
Un fait illustre bien ce dédain : l’industrie des nouvelles technologies, toujours à l’affût de nouveaux marchés à investir, a mis très longtemps avant de s’intéresser aux règles. Dès 2014, Apple était critiqué par certains titres de la presse spécialisée américaine lors du lancement de sa première application dédiée à la santé, HealthKit : celle-ci était capable de compter les pas ou de mesurer le pouls, mais pas de suivre ses menstruations – symbole édifiant d’un écosystème du numérique dominé par des hommes incapables de prendre en compte des besoins qui ne sont pas les leurs.
Un monde d’entrepreneuses
Ce relatif désintérêt des géants du numérique a laissé la voie libre aux start-up. Clue revendique aujourd’hui 11 millions d’utilisateur·ices régulier·es, qui ouvrent l’application tous les mois. Elle compte parmi ses concurrentes Glow (entreprise cofondée par Max Lechvin, également cofondateur de Paypal), Flo ou Natural Cycles (qui fonctionne avec un thermomètre, et qui est la première application de menstrutech à avoir été autorisée comme moyen de contraception aux États-Unis). Au-delà des règles, des entreprises s’intéressent à d’autres enjeux de santé. C’est le cas d’Elvie, qui propose un tire-lait et un rééducateur de périnée connectés, ou Bloomlife, qui développe un dispositif de surveillance des femmes enceintes et des fœtus. Il existe aussi des sites d’e‑commerce spécialisés dans la contraception et la santé gynécologique (The Pill Club), des plateformes de diagnostic de maladies chroniques (EndoDiag pour l’endométriose) ou de téléconsultations reservées aux femmes (Maven Clinic). Une grande diversité de produits, qui attire de plus en plus d’investissements. En 2022, les start-up de la femtech ont levé 1,16 milliard de dollars à l’échelle mondiale : un chiffre en augmentation de 300 % depuis 2016, d’après les estimations de la plateforme PitchBook. À noter cependant : cela ne représente que 13 % du total des fonds levés par le secteur de la santé connectée dans le monde.
Ces start-up de la femtech sont confrontées à divers freins dans leur développement. D’abord, elles sont souvent dirigées par des femmes : 70 % des entreprises du secteur ont au moins une cofondatrice, d’après des estimations du cabinet McKinsey, un taux largement supérieur à la moyenne des start-up du numérique. Or, ces dirigeantes accèdent moins facilement aux capitaux que leurs confrères. En France, 88 % du montant total levé par des start-up en 2021 a été capté par des équipes 100 % masculines. L’autre frein est tout simplement lié au fait que le secteur se consacre à des sujets considérés comme féminins, moins valorisés. Les entrepreneuses du secteur subissent d’ailleurs une forte pression pour justifier l’utilité de leur projet, et sont souvent poussées à prendre leur cas personnel comme illustration. « Dans la femtech, il y a une certaine injonction au storytelling, peut-être davantage que dans d’autres secteurs du numérique », estime Jane Douat, directrice technique et cofondatrice d’Omena, une application française dédiée à la ménopause. « On attend de toi que tu aies eu l’idée de ton produit à la suite d’une histoire très intime, parfois dramatique. Personne ne demande au fondateur d’une application de comptabilité de raconter son accouchement difficile ! »
Améliorer les connaissances sur la santé des femmes
Beaucoup d’entrepreneuses de la femtech revendiquent quelque chose de rare dans le milieu des start-up : un certain engagement politique. Il ne s’agit pas seulement de résoudre des problèmes individuels, mais de dénoncer les manquements d’un système. « La particularité de la femtech est qu’elle se trouve au croisement de plusieurs sujets sensibles : l’innovation, la médecine et la transformation sociétale », remarque Juliette Mauro, fondatrice de My S Life, une plateforme d’information et d’échanges sur la santé gynécologique et sexuelle. « On essaie souvent de ramener ces start-up sur des thématiques dites de femmes, de quotidien ou de consommation, alors qu’on parle de projets qui réfléchissent à la démarche patiente-médecin, avec un impact potentiel sur la société et la santé publique. » À la fin de 2022, cette entrepreneuse a cofondé l’association Femtech France avec deux autres consœurs, Christel Bony et Delphine Moulu.
Leur but : fédérer les entreprises françaises du secteur (il en existait 81 fin 2022) pour les rendre plus visibles et faciliter les liens avec d’autres acteur·ices, comme des professionnel·les de santé (médecins, mutuelles), des laboratoires ou encore l’industrie. Car pour elles, l’enjeu principal de la femtech est de faire avancer les connaissances en matière de santé des femmes, et ainsi d’améliorer la prise en charge sur le long terme. « On a besoin de faire progresser la recherche, et ces entreprises peuvent y aider avec les données qu’elles collectent », explique Delphine Moulu. Les partenariats avec des universités ou des laboratoires de recherche sont ainsi fréquents dans la femtech.
Apple, qui a finalement ajouté une option de suivi des règles sur son application de santé, travaille depuis plusieurs années avec l’université de Harvard, aux États-Unis, et a déjà contribué à des travaux universitaires sur les douleurs des règles, le syndrome des ovaires polykystiques ou l’endométriose. Mais ces collaborations peuvent aussi se faire avec des entreprises plus inattendues. Par exemple, en 2021, L’Oréal a annoncé s’associer à Clue pour « enrichir la connaissance scientifique des effets hormonaux sur la santé de la peau ».
Au cœur de l’intime
Dans la femtech comme dans le reste des industries numériques, la richesse des firmes repose sur l’accumulation d’informations concernant les internautes et, très souvent, leur exploitation à des fins publicitaires. Néanmoins, le sujet est particulièrement sensible pour la femtech, car son activité touche à l’intime. En 2019, l’organisation anglaise Privacy International épinglait les pratiques de six applications de suivi des règles qui partageaient avec Facebook des données plus ou moins sensibles (selon les cas), via un outil publicitaire proposé par le réseau social. En 2020, l’entreprise à l’origine de l’application Glow a accepté de verser 250 000 dollars à l’État de Californie après la découverte de plusieurs failles de sécurité. En 2021, la Federal Trade Commission (l’agence fédérale américaine chargée de défendre les droits des consommateurs et des consommatrices) a forcé l’outil Flo à clarifier auprès de son audience le type d’informations collectées et de quelle manière elles pouvaient être exploitées par des entreprises tierces, notamment Google et Facebook. Enfin, en 2022, le site américain Vice révélait qu’un site spécialisé dans la revente de données proposait une base permettant d’identifier des personnes ayant téléchargé des applications de suivi des règles. La situation est complexe. Les pratiques des entreprises diffèrent grandement en fonction des services proposés, de leur modèle économique, de leur clientèle (professionnel·les de santé ou grand public), de leur méthode pour anonymiser les données ou encore de la manière dont celles-ci sont stockées.
13 %
des fonds levés dans le secteur de la santé connectée en 2022 le sont par des start-up de la femtech.
Leurs obligations ne sont d’ailleurs pas les mêmes aux États-Unis et en France où, depuis 2018, c’est le Règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD) qui fait loi. Ce texte est censé garantir le consentement éclairé des internautes, qui ont le droit de réclamer des informations sur l’exploitation de leurs données personnelles ainsi que leur suppression. Le texte prévoit aussi un cadre spécifique pour les données de santé, définies comme « celles relatives à la santé physique ou mentale, passée, présente ou future ». Elles doivent faire l’objet d’un hébergement sécurisé particulier. Néanmoins, des zones de flou persistent. D’après la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), une information « à partir de laquelle aucune conséquence ne peut être tirée [sur] l’état de santé de la personne concernée » n’est pas une donnée de santé. Par exemple, une application qui permettrait de collecter un nombre de pas journalier, en dehors d’un contexte de suivi médical, n’entre a priori pas dans ce cadre encore plus protecteur.
Menaces pour la vie privée
Ce débat sur la protection des données a été relancé durant l’été 2022, après la violente restriction du droit à l’avortement aux États-Unis. Des personnes utilisant ces applications de suivi des règles se sont inquiétées de la surveillance numérique dont elles pourraient faire l’objet. Mais le problème dépasse largement les entreprises de la femtech : ce sont toutes nos traces numériques qui sont potentiellement traquées – recherches sur Google, e‑mails, discussions via des applications de messagerie, publications sur des réseaux sociaux, etc. Il existe déjà des cas, dans le système judiciaire américain, où des femmes ont été condamnées pour des avortements illégaux à cause de ces banales activités en ligne.
« Je pense sincèrement qu’on peut développer des technologies plus éthiques. Même en se faisant de l’argent dessus ! La clé, c’est la transparence », explique Marie Kochsiek. Cette sociologue et développeuse allemande est à l’origine, avec deux amies, de Drip, une application de suivi des règles d’un genre un peu particulier. Elle est open source (c’est-à-dire que n’importe qui peut accéder à son code pour vérifier son fonctionnement ou suggérer des modifications), et stocke les données des internautes uniquement sur leur smartphone. Personne d’autre n’y a accès. Gratuite et non commerciale, elle est financée exclusivement grâce à des bourses du gouvernement allemand et de la fondation Mozilla (organisme à but non lucratif, notamment connu pour développer le navigateur web Firefox). Drip revendiquait plus de 38 000 téléchargements en avril 2023, un peu moins d’un an après sa mise à disposition sur les magasins d’applications traditionnels. La majorité de ses utilisateur·ices sur iPhone habite aux États-Unis. « Quand on a commencé notre projet, c’était parfois difficile de convaincre les autres de son intérêt. Au final, je pense que tout le monde a compris en 2022 », se souvient la développeuse. « D’ailleurs, après ce qui s’est passé aux États-Unis, plusieurs applications ont proposé des options pour anonymiser les données ou les stocker de manière plus sécurisée. Mais si ces options ne sont pas enclenchées par défaut, à quoi ça sert ? C’est juste un changement cosmétique pour donner bonne conscience à ces entreprises. »
D’autant que la non-prise en compte des enjeux de vie privée n’est pas le seul reproche fait à la femtech. On remet en question la fiabilité de leurs informations et prédictions ; leurs discours et leur marketing qui renforcent les normes de genre ; leur essentialisation du corps féminin autour de ses fonctions reproductives ; leur utilisation par des mutuelles ou des entreprises pour surveiller les désirs de grossesse de leurs employé·es ; leur idéologie politique parfois douteuse. À la fin de 2022, une longue enquête du site américain Business Insider révélait ainsi la popularité croissante du mouvement nataliste dans la Silicon Valley, qui souhaite « réinventer la reproduction » avec des entreprises proposant des aides à la fertilité, des utérus artificiels ou des tests génétiques sur les embryons, accessibles seulement aux plus fortuné·es.
Répondre aux besoins
Faut-il condamner toute la femtech pour autant ? L’approche de Drip, ainsi que celle d’autres projets non commerciaux similaires (Euki, Periodical), est plutôt d’œuvrer à une réappropriation de ces technologies. Si des femmes utilisent des applications ou d’autres services connectés dans leur parcours santé, il faut leur proposer de meilleurs outils, plutôt que leur reprocher leurs besoins. Car derrière le succès de la femtech se cachent en fait des usages riches et divers : des femmes qui utilisent ces applications comme filet de sécurité en plus d’une contraception classique, des malades chroniques qui souhaitent enregistrer leurs douleurs, des adolescent·es qui n’ont pas forcément accès à des informations sur les règles et/ou la sexualité dans leur famille, des personnes déçues de leur relation avec leur médecin, etc.
250 000 dollars
C’est la somme versée à l’État de Californie en 2020 par l’entreprise qui a créé Glow, une application de suivi menstruel qui présentait plusieurs failles de sécurité.
« Ce phénomène nous interpelle, car il révèle un manquement dans la prise en charge publique de beaucoup d’aspects de la santé des femmes. En conséquence, on assiste à un détournement de leurs démarches vers des entreprises privées », explique Catherine Vidal, neurobiologiste et coresponsable du groupe de travail Genre et recherche en santé, du comité d’éthique de l’Inserm. Dans ce cadre, elle a mené début 2023 une série d’auditions sur la femtech, après avoir travaillé sur la menstrutech en 2022 : « Bien sûr, cela soulève de nombreux problèmes éthiques. Mais cela démontre aussi un besoin de fournir des espaces et des plateformes de qualité aux femmes et à leurs revendications de santé. »

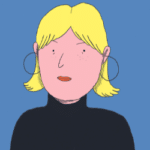
(1) L’arrêt dit Roe vs Wade est une disposition constitutionnelle datant de 1973 et garantissant le droit à l’avortement dans tout le pays. Son abrogation par la Cour suprême des États-Unis permet aux États d’interdire l’avortement.
(2) Le syndrome des ovaires polykystiques, fréquent, est dû à un dérèglement hormonal.





