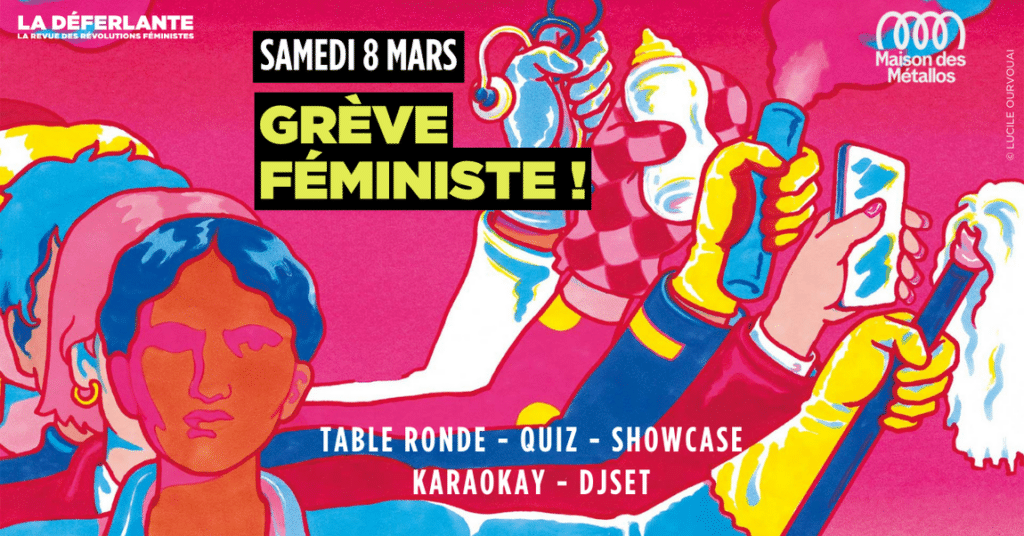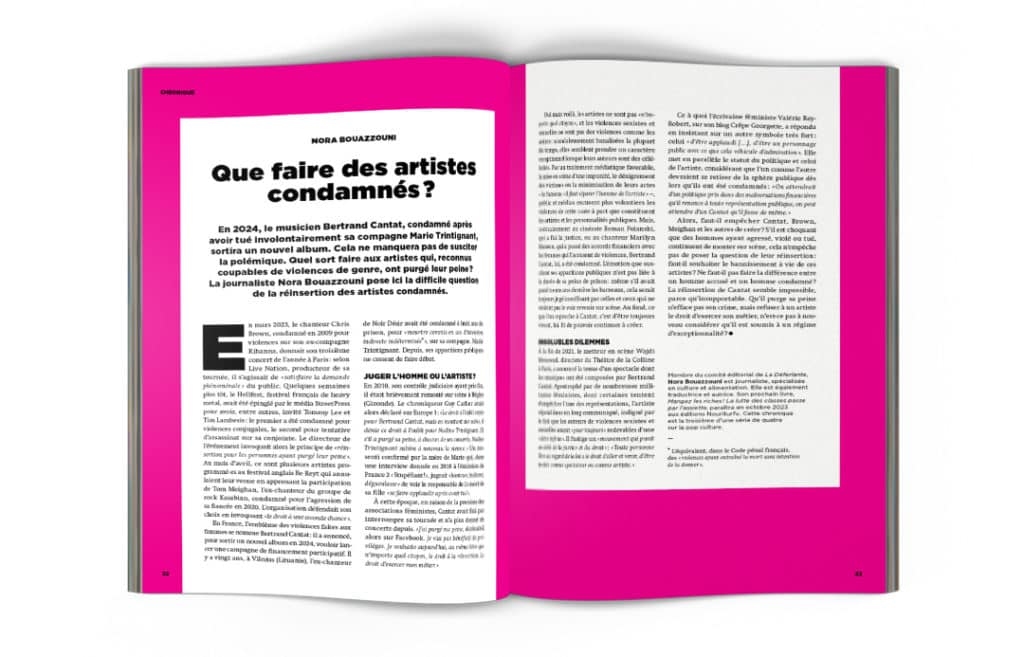En novembre 2022, les député·es inauguraient dans les jardins de l’Assemblée nationale, une statue de Simone Veil. En 2018, un an à peine après sa disparition et à l’initiative d’Emmanuel Macron, l’ancienne ministre de la Santé était entrée au Panthéon. Il faut dire que son parcours exceptionnel épouse de manière frappante l’histoire du XXe siècle, dans ce qu’elle a de plus épouvantable – l’expérience de la Shoah –, mais aussi de réconciliateur – Veil fut une actrice importante de la construction européenne – et d’émancipateur pour les femmes : il y a cinquante ans, le 17 janvier 1975, Simone Veil faisait adopter par le Parlement la loi légalisant l’interruption volontaire de grossesse (IVG) en France. Mais comme tout totem politique, la figure de l’ancienne ministre est aussi convoquée à d’autres fins, en l’occurrence pour neutraliser une autre mémoire, celle des féministes de gauche, et pour figer le cadre idéologique des enjeux reproductifs en France.
La loi de 1975 : un texte de compromis
L’historienne Bibia Pavard, autrice d’une thèse sur les dynamiques de lutte pour la contraception et l’avortement en France entre 1956 et 1979, y qualifie la loi Veil de « victoire paradoxale » pour les femmes : « Simone Veil a contribué à l’aboutissement de la revendication féministe de libre disposition de soi pour les femmes, tout en repoussant les mobilisations collectives dans un hors-champ. »
De fait, au tournant des années 1970, à force de mobilisations, les féministes parviennent à mettre la question de l’IVG à l’agenda politique, comme l’explique la sociologue Lucile Ruault dans La Déferlante 13. Nommée en 1974 ministre de la Santé par Giscard d’Estaing, Simone Veil est prévenue par son prédécesseur, Michel Poniatowski qu’elle doit faire vite : « Sinon vous arriverez un matin au ministère et vous découvrirez qu’une équipe du MLAC [Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception] squatte votre bureau et s’apprête à y pratiquer un avortement. »
Mais pour que les député·es de droite adoptent cette loi progressiste, Simone Veil doit multiplier les concessions : il ne s’agit pas d’ouvrir des droits, mais avant tout de répondre à une urgence sanitaire, « mettre fin à une situation de désordre et d’injustice », comme elle le déclare en présentant sa loi devant l’Assemblée nationale. Dans l’esprit du texte, les femmes, avant d’être des sujets politiques dignes de droits, sont des personnes en souffrance : l’avortement « restera toujours un drame », souligne Veil, et sa pratique doit être une compétence dévolue uniquement aux médecins, seul·es habilité·es à effectuer cet acte (là où certaines militantes du MLAC défendent l’idée que c’est aux femmes elles-mêmes de se l’approprier). Hors de question, par ailleurs, qu’il soit remboursé par la Sécurité sociale : il faudra attendre 1982 et le retour de la gauche au pouvoir pour que ce point soit modifié.
Une rhétorique doloriste
Aujourd’hui, le cadrage hérité de la loi Veil imprègne encore l’imaginaire politique français. À ce titre, il était frappant d’entendre à l’hiver 2022 Emmanuel Macron – né trois ans après le vote de ladite loi et qui faisait alors encore mine de s’afficher en modernisateur du pays –, reprendre à son compte la rhétorique doloriste et culpabilisante de la droite de 1974 : « L’avortement est un droit, mais c’est toujours un drame pour une femme », déclarait-il dans le cadre de la longue bataille parlementaire qui, en mars 2022, étendait l’accès à l’IVG de 12 à 14 semaines de grossesse (un délai déjà en vigueur depuis 2010 en Espagne, par exemple). Si finalement, après des mois d’atermoiements du parti présidentiel, l’IVG a fini par faire son entrée dans la Constitution en mars 2024, elle ne figure qu’à titre de « liberté », et non de « droit ».
De nouvelles demandes de justice reproductive
Plus largement, la dynamique mémorielle autour de la figure de Simone Veil a probablement contribué à cornériser la lutte pour l’avortement, en la désolidarisant d’autres enjeux reproductifs. Car, en miroir des femmes qui n’ont pas accès à l’IVG, il y a toutes celles auxquelles on conteste la possibilité d’avoir des enfants : dans les années 1970, alors que la loi Veil est débattue en France hexagonale, à La Réunion, des femmes pauvres et racisées sont victimes d’avortements et de stérilisations forcées, ainsi que l’ont montré les chercheuses Myriam Paris et Françoise Vergès. Comme au Groenland à partir des années 1960 ou au Pérou dans les années 1990, les pratiques eugénistes ont cours, partout dans le monde et à toutes les époques, selon des critères qui mêlent racisme, sexisme, considérations classistes et validistes. En décembre 2022, le Parlement européen adoptait un rapport dénonçant le fait que dans 13 pays européens, la stérilisation forcée des personnes handicapées demeure légale.
Pour lutter contre ce type de discriminations, les féministes afro-américaines ont élaboré le concept de « justice reproductive ». Dans un entretien à La Déferlante, l’anthropologue et militante Mounia El Kotni explique quels en sont les trois piliers : « le droit de ne pas avoir d’enfants et de pouvoir revendiquer le fait d’être childfree […] ; inversement, le droit d’avoir des enfants et donc de ne pas être stérilisé·e de force, de pouvoir accoucher comme on le souhaite […] ; le droit d’élever ses enfants dans un environnement non toxique. »
« Presque dix ans après le mariage pour tous·tes, les personnes transgenres sont toujours exclues de la PMA »
Alors que la demande de « justice reproductive » commence à s’exprimer comme telle en France, une partie des mobilisations féministes a justement porté ces dernières années sur l’accès aux droits reproductifs de groupes sociaux qui en sont privés. Là encore, les forces politiques (de gauche comme de droite) ont navigué entre franche opposition et frilosité de principe. Il a en effet fallu attendre 2021, presque dix ans après le vote ouvrant le mariage à tous·tes, pour que les femmes seules et les lesbiennes puissent accéder à la PMA (voir notre dossier « Réinventer la famille », de septembre 2022). Les personnes transgenres, qui jusqu’en 2016 devaient accepter la stérilisation pour pouvoir transitionner, en sont par ailleurs toujours exclues.
Alors que la droite œuvre à faire de la loi de 1975 une borne mémorielle sacralisée, l’héritage de ce dispositif législatif implique, pour les féministes de gauche, un constant travail de recontextualisation et d’élargissement. Paradoxalement, il faut lutter contre la mémoire de la loi Veil afin d’en questionner les limites, de saisir les problématiques qu’elle a laissées de côté et d’ouvrir d’autres chantiers de lutte.