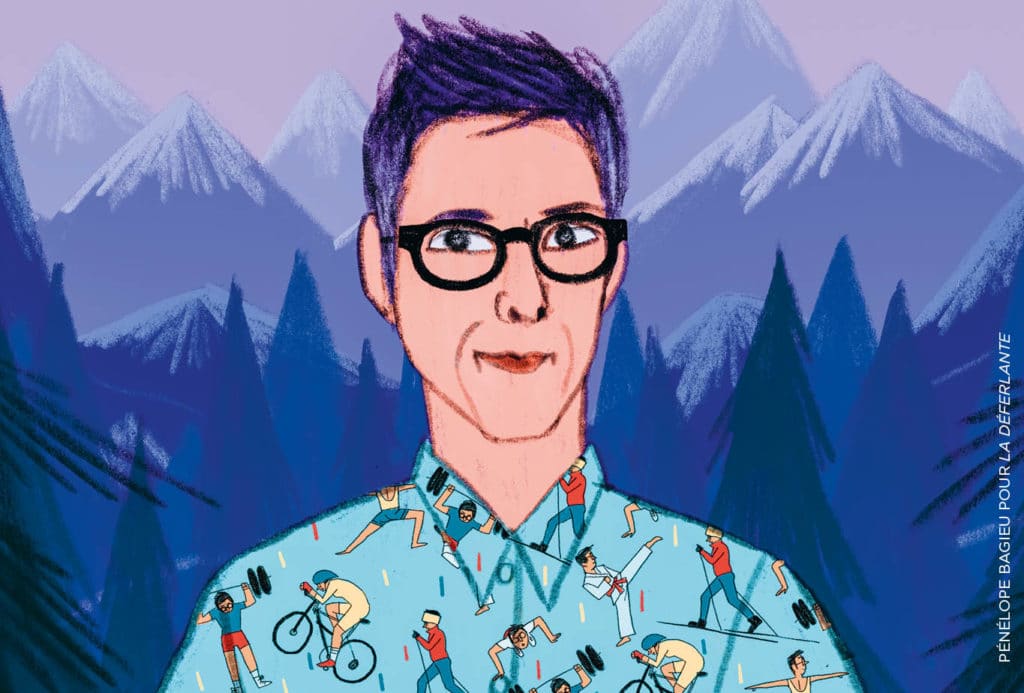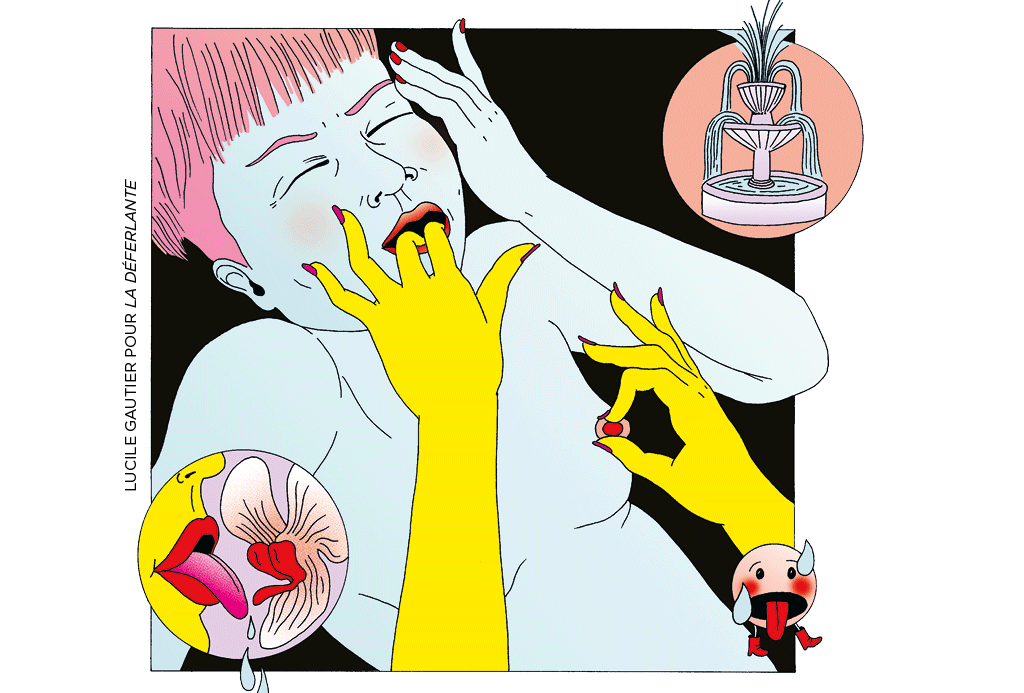En 1910, le couturier Paul Poiret – célèbre pour avoir « libéré la femme du corset » – lance une collection orientaliste lors d’une soirée mémorable intitulée « La mille et deuxième nuit », en référence aux célèbres contes qui viennent d’être traduits en français. Le texte de l’invitation est édifiant.
Revisitant un imaginaire persan bourré de stéréotypes, il promet pour cet événement : une danseuse « mince & flexible comme le rameau de l’Arbre Tan », un « vieux potier myope », un « marchand d’esclaves dont la moins belle vaut mille dinars d’or », un « savetier pouilleux » et un « tailleur cacochyme »…
L’orientalisme : tout commence au milieu du XVIIIe siècle avec ce mouvement artistique et littéraire qui a contribué à ancrer l’industrie naissante de la mode dans un « ailleurs » fantasmé, expression de la domination de l’Occident sur l’Orient. Pour l’écrivain palestinien Edward Saïd, qui décrivit la pensée orientaliste dès 1978, ce « style occidental de domination, de restructuration et d’autorité sur l’Orient » est pensé autour d’une esthétique occidentale, et plus précisément française.
Les expositions universelles et les nombreux zoos humains, mettant en scène des corps non blancs exotisés devant un public européen, ont été, dès la fin des années 1800, une source inépuisable d’inspiration pour les industries créatives. Jusqu’à la fin du XXe siècle, ils nourrissent notamment l’imagination des couturiers comme Jeanne Lanvin ou plus tard Yves Saint Laurent, qui se plaisent à « découvrir » et collectionner les objets, tissus, drapés issus de cultures « orientales ».
Pour l’historien d’art Khémaïs Ben Lakhdar, auteur de L’Appropriation culturelle. Histoire, domination et création : aux origines d’un pillage occidental (Stock 2024), les liens entre l’expansion des empires coloniaux européens et l’orientalisme de la couture parisienne à la fin du XIXe et au début du XXe siècle pourraient se résumer à une expression : « l’appropriation culturelle ». Ce mécanisme d’oppression, par le biais duquel une personne ou un groupe en situation de domination pille les ressources d’un groupe minorisé en décontextualisant l’objet pillé à des fins capitalistes, perpétue des stéréotypes colonialistes et raciaux. Parmi les exemples récents les plus marquants, on peut évoquer Dolce & Gabbana et sa publicité pour promouvoir son arrivée sur le marché chinois, mettant en scène une mannequin asiatique tentant de manger une pizza et des spaghettis avec des baguettes. De son côté, Prada a été critiqué pour avoir créé un pull orné d’une bouche rouge évoquant un blackface (1).
Sous la pression des réseaux sociaux, ces polémiques ont entraîné des excuses publiques, sans rien changer en profondeur. La journaliste et critique de mode Mélody Thomas parle d’une « économie de la visibilité », qui pousserait les marques à policer provisoirement leur communication, avant de revenir à leur cible et à leurs valeurs originelles. Dans La mode est politique (Les Insolentes, 2022), elle décrit cette industrie comme un miroir grossissant de sujets de société impliquant des personnes minorisées, qui sont encore quotidiennement invisibilisées, manipulées, volées et silenciées.
Continuum colonial
Même quand elles sont racisées, les personnes qui travaillent dans la mode sont prises dans un système de représentation qui relève de l’appropriation culturelle. En 2023, l’artiste, musicien, producteur et styliste états-unien Pharrell Williams est nommé directeur artistique de la collection Homme chez Louis Vuitton. Inspirée du Far West, sa troisième collection, présentée en janvier 2024, est censée, selon la communication de la maison de couture, « réinventer le vestiaire du western américain », et par là rendre hommage à aux cultures natives nord-américaines. Le défilé spectacle a suscité de nombreuses réactions positives et a été plébiscité pour son « inclusivité ».
Pourtant, Khémaïs Ben Lakhdar l’utilise dans ses cours comme un cas d’école qui dit l’inverse : « Le continuum colonial est fascinant. Le défilé s’est déroulé au jardin d’acclimatation, qui, ironiquement, est aussi le lieu de la monstration des sauvages à Paris, où les zoos humains ont été installés au début du XXe siècle. Tandis que Buffalo Bill faisait sensation avec un spectacle sur “les Indiens et les cowboys” (2). Ni les producteurs du défilé, ni Pharrell Williams, ni la marque… personne n’a fait le rapprochement ! Ils sont tellement ignorants de cette histoire coloniale qu’ils reproduisent la même chose. » Le communiqué de presse de la collection – pas plus que le site de Louis Vuitton – ne mentionne les quatre couturiers et couturières natives américaines qui ont collaboré à cette collection : Lauren Good Day, Trae Littlesky, Jocy Littlesky et Kendra Red House.
« Décoloniser la mode, c’est aussi couvrir d’autres fashion weeks que celles de Paris, Milan, New York et Londres, afin de montrer que la mode se construit et s’organise en dehors de l’Occident. »
Khémaïs Ben Lakhdar, historien
Les mannequins, clés d’une réelle évolution
Pour l’essayiste Christelle Bakima Poundza, autrice de Corps noirs. Réflexions sur la mode et les femmes noires (Les Insolentes, 2023), « plusieurs projets concrétisés au début des années 2020 doivent beaucoup au mouvement antiraciste né en 2013 aux États-Unis Black Lives Matter, le problème est que le sujet est resté sur la morale, or il est ailleurs ». Comme elle, Khémaïs Ben Lakhdar pense que ce sont les moyens de production et l’utilisation de certains matériaux qu’il faut remettre en question : « Décoloniser la mode, c’est aussi demander à des journalistes de couvrir d’autres fashion weeks que les quatre plus importantes que sont Paris, Milan, New York et Londres, afin de montrer que la mode se construit et s’organise en dehors de l’Occident. C’est un réseau qui doit être global, en repensant la chaîne en entier. »
L’effondrement de l’immeuble du Rana Plaza en 2013, qui a fait plus de 1 130 mort·es à Dacca au Bangladesh, a sonné l’alerte sur les conditions catastrophiques dans lesquelles les marques occidentales font fabriquer leurs produits à l’autre bout du monde (lire notre reportage en Turquie et l’entretien avec Audrey Millet). Pour Mélody Thomas, c’est un enjeu de formation : « La mode en France est limitée par les notions de méritocratie et d’universalisme et tend à recruter les étudiant·es sur des critères très sélectifs avec des coûts d’admission élevés. L’idéologie française reste passéiste sur l’histoire du costume, sans jamais évoquer l’histoire des colonies ni les rapports Nord-Sud, ce qui permettrait pourtant aux étudiant·es d’en savoir plus sur l’industrie qu’ils vont intégrer. »
Au-delà de l’enseignement de l’histoire, il importe, pour déconstruire les logiques d’oppression, de prendre en compte les réalités de genre, de corpulences et de cultures, en plus des questions raciales. Les mannequins sont « les clés pour une réelle évolution, car ce sont celles qui voient tous les ressorts de cette industrie, des coulisses aux médias, elles sont en contact avec tout le monde », estime Christelle Bakima Poundza, qui les replace au centre de sa réflexion. Dans son essai Corps noirs. Réflexions sur la mode et les femmes noires, elle affirme : « L’industrie s’en sert comme faire-valoir […] et n’hésite pas à enfermer ces femmes dans le narratif unidimensionnel de la jeune fille noire africaine sortie de la pauvreté grâce au mannequinat. » Une référence aux processus de fétichisation, d’animalisation et de misogynoir (lire l’encadré dans l’article “L’aube d’un #MeToo pour les femmes racisées”) dont elles restent victimes, à plus forte raison quand elles sont originaires d’Afrique, et plus précisément du Soudan du Sud, comme c’est très souvent le cas sur les podiums ces dernières années.
« L’idéologie française reste passéiste sur l’histoire du costume, sans jamais évoquer l’histoire des colonies ni des rapports Nord-Sud »
Mélody Thomas
Certaines initiatives, comme celle de la maison Chanel qui présente, depuis deux décennies, une collection « métiers d’art » autour du savoir-faire des brodeuses, plumassières ou encore des modistes, vont dans la bonne direction, souligne Khémaïs Ben Lakhdar. Pour son vingtième anniversaire, l’équipe de la directrice artistique Virginie Viard (qui a annoncé son départ en juin 2024) a choisi Dakar, au Sénégal, pour présenter sa collection. « Ils sont allés apprendre auprès des artisans locaux, en découvrant que d’autres étaient sans doute mieux formés, avec un réel savoir-faire », note l’historien.
Des emprunts culturels recontextualisés
Certain·es créateur·ices semblent être pour le moment les plus aptes à faire changer la vision d’un ancien monde. Mélody Thomas cite le créateur Raul Lopez, fondateur de la marque Luar, « qui repense les questions queer », tandis que Khémaïs Ben Lakhdar salue l’approche « réflexive et artisanale » de Grace Wales Bonner : « Elle intègre la notion d’hybridité qui est une des notions clés de la pensée postcoloniale, entre la Grande-Bretagne et la Jamaïque notamment. » Cette créatrice, qui était pressentie pour reprendre la maison Louis Vuitton, propose après chacun de ses défilés une bibliographie et des informations approfondies afin de recontextualiser les emprunts et inspirations culturelles de ses créations.
Pour Christelle Bakima Poundza, la personne qui pourrait être véritablement l’incarnation d’une mode décoloniale, voire décolonisée est Marvin M’toumo. Cet artiste designer, scénographe, performeur, poète guadeloupéen, propose une mode de haute couture pluridisciplinaire : « Il raconte quelque chose dans ses collections, qui sont des performances. C’est un acteur qui repense la mode avec des choses qui se voient. Son casting, les espaces dans lesquels il présente ses collections changent totalement le rapport de qui regarde quoi », avance l’autrice.
Un rappel que la haute couture hexagonale n’est pas seulement une industrie, mais une institution qui se pense comme un héritage de traditions. « Il serait peut-être temps d’intégrer des chercheurs et penseurs aux studios, suggère Khémaïs Ben Lakhdar. Pour faire les bons liens et donner le bon contexte. Alors, on pourra éventuellement décoloniser la mode. »
(1) La pratique du blackface (littéralement, « visage noir ») consiste, pour une personne blanche, à se grimer en personne noire, soit pour se moquer, soit pour tirer avantage de la culture noire, comme le faisaient aux États-Unis les jazzmen blancs.
(2) Dans ce spectacle qui a tourné en France en 1889 puis en 1905, des Natifs et Natives américain·es étaient sommé·es de jouer leur propre rôle de vaincu·es. Cette esthétique de western a, par la suite, puissamment imprégné l’imaginaire occidental.