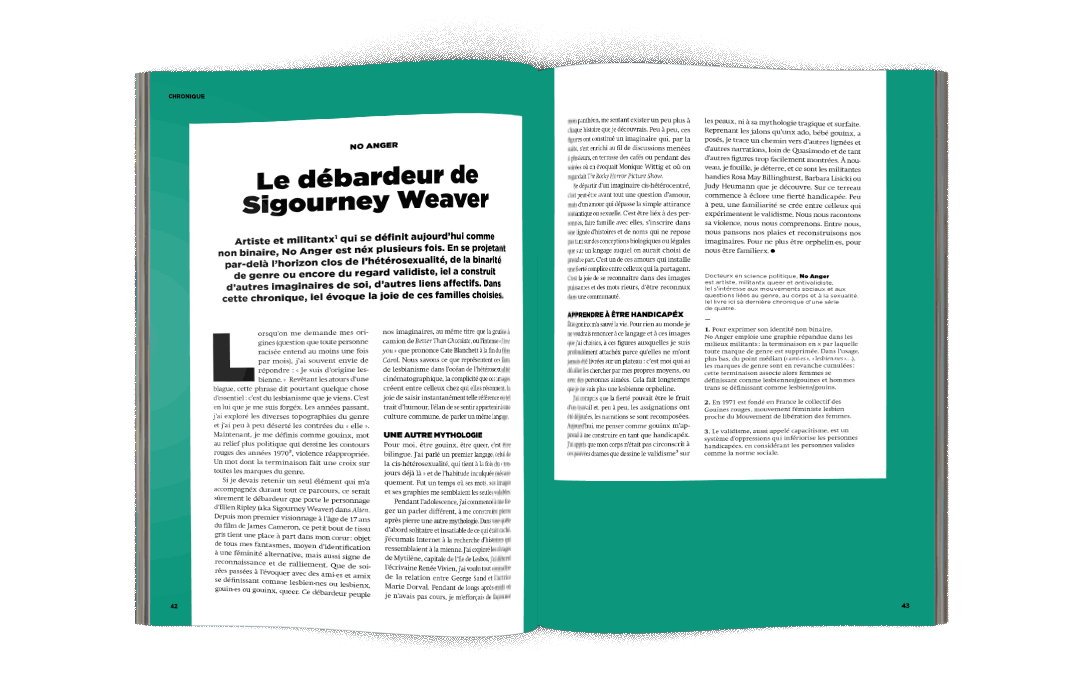Lorsqu’on me demande mes origines (question que toute personne racisée entend au moins une fois par mois), j’ai souvent envie de répondre : « Je suis d’origine lesbienne. » Revêtant les atours d’une blague, cette phrase dit pourtant quelque chose d’essentiel : c’est du lesbianisme que je viens. C’est en lui que je me suis forgéx (1). Les années passant, j’ai exploré les diverses topographies du genre et j’ai peu à peu déserté les contrées du « elle ». Maintenant, je me définis comme gouinx, mot au relief plus politique qui dessine les contours rouges des années 1970 (2), violence réappropriée. Un mot dont la terminaison fait une croix sur toutes les marques du genre.
Si je devais retenir un seul élément qui m’a accompagnéx durant tout ce parcours, ce serait sûrement le débardeur que porte le personnage d’Ellen Ripley (aka Sigourney Weaver) dans Alien. Depuis mon premier visionnage à l’âge de 17 ans du film de James Cameron, ce petit bout de tissu gris tient une place à part dans mon cœur : objet de tous mes fantasmes, moyen d’identification à une féminité alternative, mais aussi signe de reconnaissance et de ralliement. Que de soirées passées à l’évoquer avec des ami·es et amix se définissant comme lesbien·nes ou lesbienx, gouin·es ou gouinx, queer. Ce débardeur peuple nos imaginaires, au même titre que la gouine à camion de Better Than Chocolate, ou l’intense « I love you » que prononce Cate Blanchett à la fin du film Carol. Nous savons ce que représentent ces îlots de lesbianisme dans l’océan de l’hétérosexualité cinématographique, la complicité que ces images créent entre celleux chez qui elles résonnent, la joie de saisir instantanément telle référence ou tel trait d’humour, l’élan de se sentir appartenir à une culture commune, de parler un même langage.
Une autre mythologie
Pour moi, être gouinx, être queer, c’est être bilingue. J’ai parlé un premier langage, celui de la cis-hétérosexualité, qui tient à la fois du « toujours déjà là » et de l’habitude inculquée mécaniquement. Fut un temps où ses mots, ses images et ses graphies me semblaient les seules valables.
Pendant l’adolescence, j’ai commencé à me forger un parler différent, à me construire pierre après pierre une autre mythologie. Dans une quête d’abord solitaire et insatiable de ce qui était caché, j’écumais Internet à la recherche d’histoires qui ressemblaient à la mienne. J’ai exploré les rivages de Mytilène, capitale de l’île de Lesbos, j’ai déterré l’écrivaine Renée Vivien, j’ai voulu tout connaître de la relation entre George Sand et l’actrice Marie Dorval. Pendant de longs après-midi où je n’avais pas cours, je m’efforçais de façonner mon panthéon, me sentant exister un peu plus à chaque histoire que je découvrais. Peu à peu, ces figures ont constitué un imaginaire qui, par la suite, s’est enrichi au fil de discussions menées à plusieurs, en terrasse des cafés ou pendant des soirées où on évoquait Monique Wittig et où on regardait The Rocky Horror Picture Show.
Se départir d’un imaginaire cis-hétérocentré, c’est peut-être avant tout une question d’amour, mais d’un amour qui dépasse la simple attirance romantique ou sexuelle. C’est être liéx à des personnes, faire famille avec elles, s’inscrire dans une lignée d’histoires et de noms qui ne repose pas tant sur des conceptions biologiques ou légales que sur un langage auquel on aurait choisi de prendre part. C’est un de ces amours qui installe une fierté complice entre celleux qui la partagent. C’est la joie de se reconnaître dans des images puissantes et des mots rieurs, d’être reconnux dans une communauté.
Apprendre à être handicapéx
Être gouinx m’a sauvé la vie. Pour rien au monde je ne voudrais renoncer à ce langage et à ces images que j’ai choisies, à ces figures auxquelles je suis profondément attachéx parce qu’elles ne m’ont jamais été livrées sur un plateau : c’est moi qui ai dû aller les chercher par mes propres moyens, ou avec des personnes aimées. Cela fait longtemps que je ne suis plus une lesbienne orpheline.
J’ai compris que la fierté pouvait être le fruit d’un travail et, peu à peu, les assignations ont été déjouées, les narrations se sont recomposées. Aujourd’hui, me penser comme gouinx m’apprend à me construire en tant que handicapéx. J’ai appris que mon corps n’était pas circonscrit à ces pauvres drames que dessine le validisme (3) sur les peaux, ni à sa mythologie tragique et surfaite. Reprenant les jalons qu’unx ado, bébé gouinx, a posés, je trace un chemin vers d’autres lignées et d’autres narrations, loin de Quasimodo et de tant d’autres figures trop facilement montrées. À nouveau, je fouille, je déterre, et ce sont les militantes handies Rosa May Billinghurst, Barbara Lisicki ou Judy Heumann que je découvre. Sur ce terreau commence à éclore une fierté handicapée. Peu à peu, une familiarité se crée entre celleux qui expérimentent le validisme. Nous nous racontons sa violence, nous nous comprenons. Entre nous, nous pansons nos plaies et reconstruisons nos imaginaires. Pour ne plus être orphelin·es, pour nous être familierx. •
Docteurx en science politique, No Anger est artiste, militantx queer et antivalidiste. Iel s’intéresse aux mouvements sociaux et aux questions liées au genre, au corps et à la sexualité. Iel livre ici sa dernière chronique d’une série de quatre.
(1) Pour exprimer son identité non binaire, No Anger emploie une graphie répandue dans les milieux militants : la terminaison en x par laquelle toute marque de genre est supprimée. Dans l’usage, plus bas, du point médian («ami·es», «lesbien·nes»…), les marques de genre sont en revanche cumulées : cette terminaison associe alors femmes se définissant comme lesbiennes/gouines et hommes trans se définissant comme lesbiens/gouins.
(2) En 1971 est fondé en France le collectif des Gouines rouges, mouvement féministe lesbien proche du Mouvement de libération des femmes.
(3) Le validisme, aussi appelé capacitisme, est un système d’oppressions qui infériorise les personnes handicapées, en considérant les personnes valides comme la norme sociale.