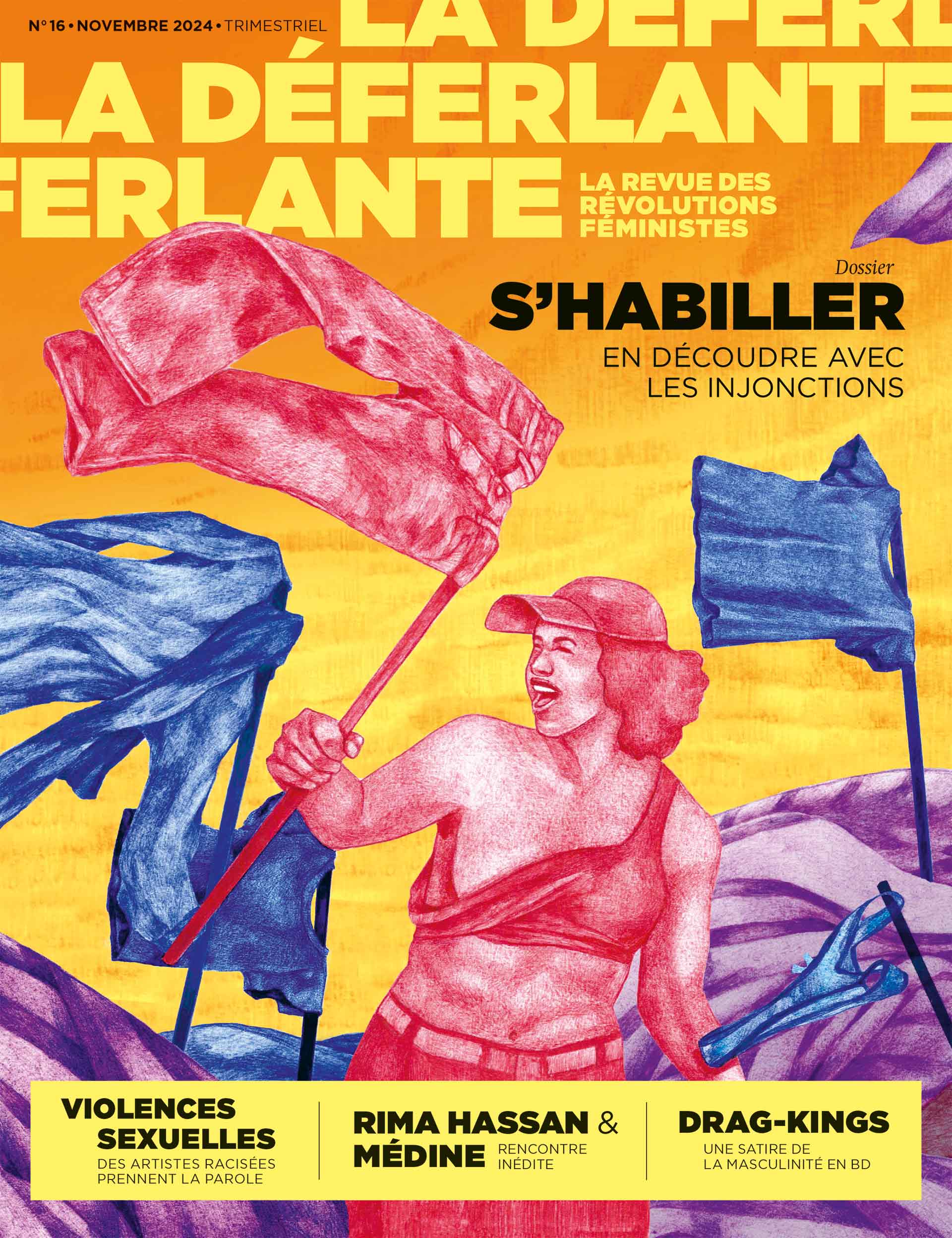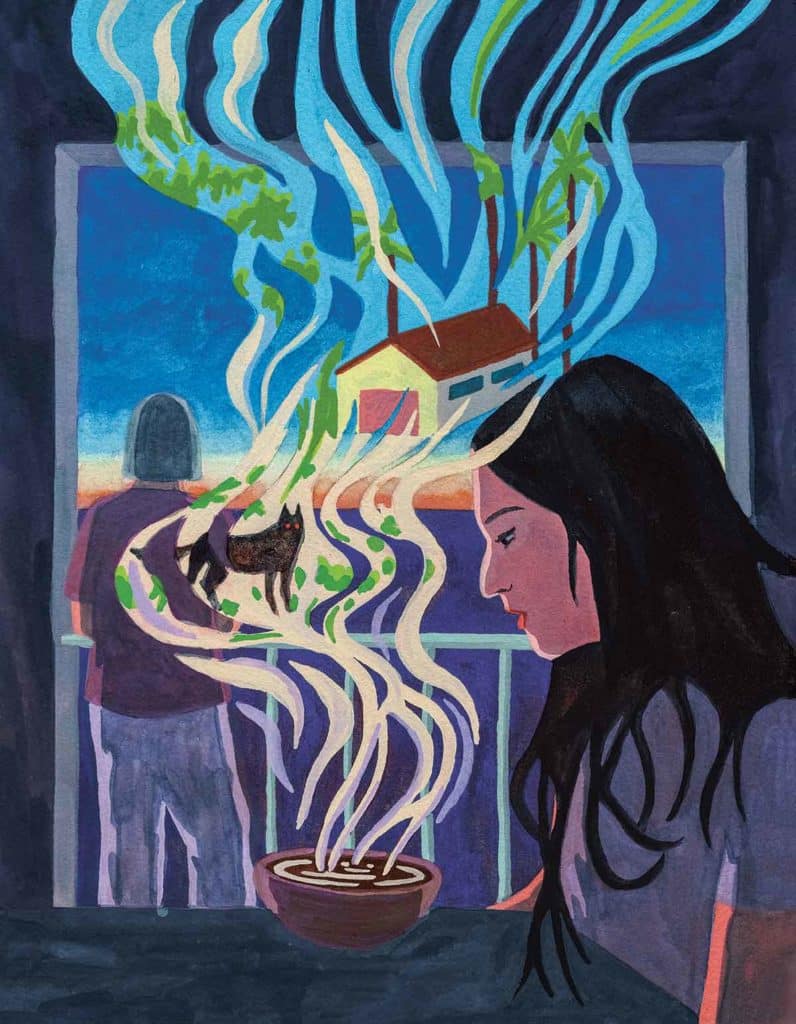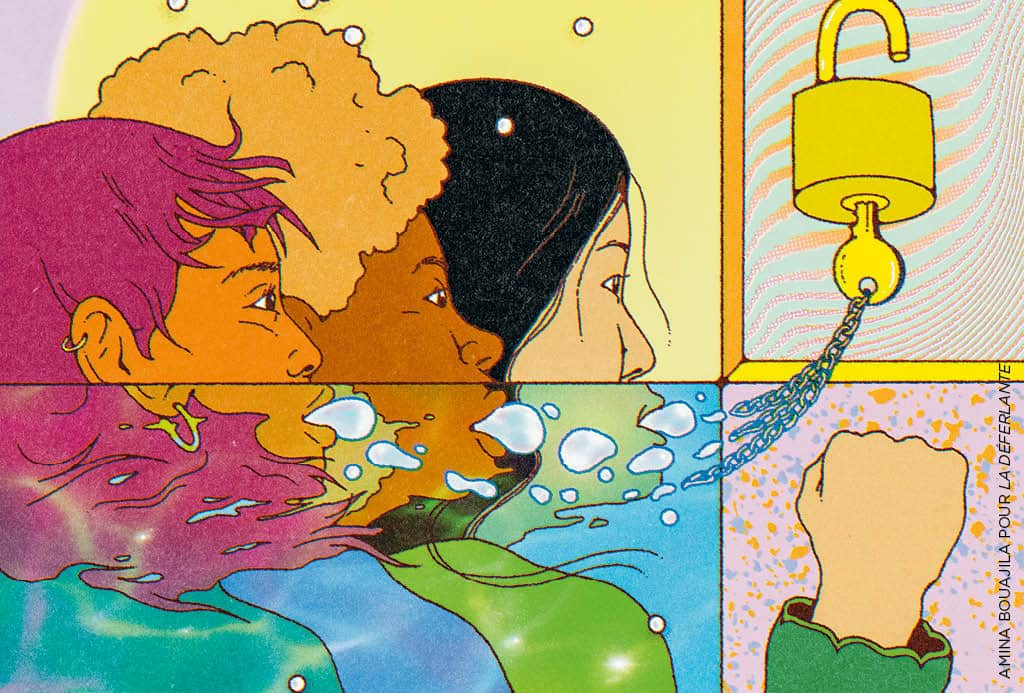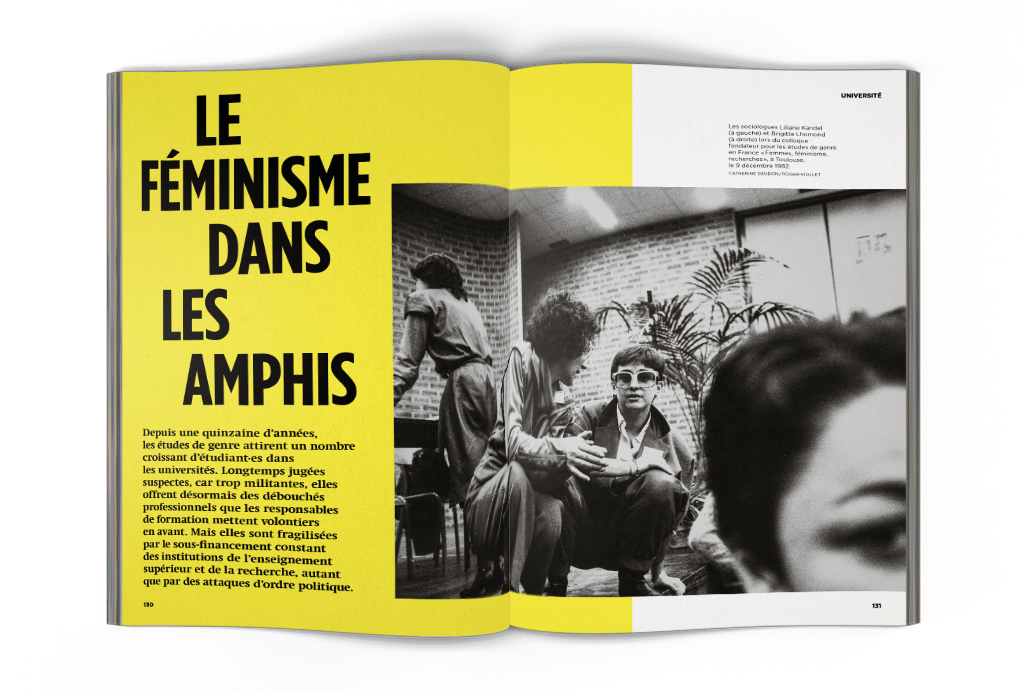Dans vos travaux, vous vous appliquez à retracer l’histoire de la production industrielle des vêtements. Quels liens faites-vous entre le colonialisme, l’esclavage et l’industrie de la mode ?
Au XVIIe siècle, dans le cadre d’une forte concurrence franco-britannique, la France et l’Angleterre entreprennent de coloniser le monde. Il leur faut habiller les marins et les soldats.
À Oxford, Londres et Paris, on assiste au début du prêt-à-porter, avec des femmes qui confectionnent des uniformes en série dans des conditions déplorables. De manière générale, la sécurité nationale et la guerre ont été des moteurs de l’industrie de la mode. Les premières baskets sont fabriquées pour l’armée à la fin du XIXe siècle, avec la semelle en caoutchouc vulcanisé, initialement conçue pour tenir sur les ponts des bateaux. Ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, le nylon utilisé pour les parachutes sert de collants.
L’autre élément indissociable de cette production, c’est la pratique de l’esclavage et le développement de la culture du coton. Cette matière première n’aurait jamais dû finir en fibres pour vêtements, car c’est une plante fragile, qui supporte mal le soleil ou la pluie selon les périodes. Aux États-Unis, le travail pénible de cueillette et d’égrenage est effectué par des esclaves noir·es. Après l’abolition (1865), c’est la main‑d’œuvre noire, puis mexicaine qui poursuit ce labeur dans les champs de coton.
Depuis l’avènement de la fast-fashion dans les années 1990, tout s’accélère. On fabrique des vêtements grâce à la pétrochimie et en délocalisant les usines : on ne peut pas produire au prix et à la vitesse des entreprises chinoises comme Temu ou Shein, pour le prêt-à-porter, sans recourir à des pratiques qui s’apparentent à de l’esclavage moderne, avec des cadences qui vont jusqu’à quatorze heures de travail par jour.
L’industrie de la mode a toujours été une industrie très féminisée. Comment l’expliquer ?
Depuis l’Antiquité, on a construit l’idée que les femmes seraient plus précises, donc meilleures ouvrières pour la couture. La main‑d’œuvre féminine est surtout avantageuse pour cette industrie parce qu’elle perçoit ce qu’on considère comme un salaire d’appoint par rapport à celui du mari ou du père : elles sont donc moins rémunérées. Au XIXe siècle, la machine à coudre permet de reléguer les filles hors de l’usine. Elles vont alors travailler à plusieurs dans des chambres de bonne, avec le risque d’attraper la tuberculose… Cette discrimination spatiale renforce leur exploitation.
L’effondrement du Rana Plaza au Bangladesh en 2013 a mis en lumière les conditions de travail infernales des ateliers de confection de vêtements. Qu’est-ce qui a changé depuis ?
Au Bangladesh, deuxième pays exportateur de vêtements au monde, les choses ont bougé dans les grandes villes grâce aux syndicats. Il y a eu des augmentations de salaire, mais on n’arrive toujours pas à un salaire vital. Les enfants continuent à travailler. Et, souvent, les grandes marques ne veulent pas payer d’augmentations. Certains États producteurs y sont même récalcitrants, de peur de devoir augmenter ensuite le salaire minimum. Il y a toujours des systèmes d’exploitation extrême, comme celui que subit la minorité ouïghoure en Chine. Les entreprises de textile savent très bien où elles s’installent. Si on regarde les listes de fournisseurs transmises par les marques Benetton et Gucci, on observe que la présence de syndicats y est très minoritaire.
Par le biais d’une puissante communication, les marques de vêtements mettent pourtant en avant leurs actions philanthropiques, avec leurs fondations pour les femmes, leurs écoles financées dans certains pays, etc. Primark, par exemple, se veut très clean, mais fait produire ses vêtements au Myanmar, dirigé par une junte militaire qui ne respecte pas les droits humains. On sauverait la planète si on s’intéressait d’abord aux droits humains. En Inde, au Pakistan et en Chine, des villages se dépeuplent car l’eau est contaminée aux pesticides [utilisés dans la culture intensive du coton], et les gens meurent à cause des teintures textiles.
Quelles sont les pistes pour sortir de ce système ?
En France, ce qui reste de notre rayonnement à l’international tient à notre industrie du luxe, avec des groupes comme Chanel ou LVMH. En juin 2024, une filiale italienne de Christian Dior (LVMH), Manufacturers Dior Srl, a été épinglée pour avoir sous-traité sa production à des entreprises chinoises accusées de travail forcé. Des faits similaires ont été reprochés à Gucci, Prada ou Burberry. Puisque l’on tient à ce rayonnement, on leur passe tout, même quand ils oublient de payer le fisc (1).
C’est aux pays d’être plus contraignants vis-à-vis des entreprises sur tous les plans, dans le luxe comme dans la fast-fashion. Mais l’Union européenne nous dit pour le moment que ce n’est pas dans son agenda, et la loi de 2017 sur le « devoir de vigilance » [lire l’encadré ci-dessous] n’a eu que peu d’impact pour le moment. Le problème, c’est qu’on considère trop rarement les chefs d’entreprise comme responsables de leurs industries. Quand une situation condamnable est découverte, les responsables de H&M se défendent toujours en arguant : « On ne savait pas, on part tout de suite. » Il faudrait leur dire : « Tu touches des milliards de bénéfices ? Alors tu n’avais qu’à vérifier. »
Après le choc du Rana Plaza, le devoir de vigilance
Le 24 avril 2013, à Dacca (Bangladesh), un bâtiment où sont installés plusieurs ateliers de confection s’effondre, causant la mort d’au moins 1 130 personnes, dont 80 % de femmes, et faisant 2 500 blessé·es. Les patrons des ateliers, sous-traitants de marques européennes de fast-fashion comme Mango ou Primark, avaient refusé de suivre les consignes de sécurité après l’apparition de fissures, causées par les générateurs électriques fonctionnant à plein régime sur le toit du bâtiment.
C’est à la suite de cet accident qu’a été instaurée en France la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, dans tous les domaines d’activité, de plus de 5 000 salarié·es en France ou 10 000 ailleurs dans le monde. Elles doivent désormais établir et mettre en œuvre un plan de vigilance visant à prévenir les risques d’atteinte grave aux droits humains ou à l’environnement du fait de leurs activités ou de celles de leurs sous-traitants. Cette loi n’a pour le moment entraîné qu’une seule condamnation : celle, en 2023 du groupe public La Poste, dont des sous-traitants avaient employé des personnes sans-papiers. En mai 2024, l’Union européenne a également adopté une directive sur le devoir de vigilance, pour les entreprises employant plus de 1 000 personnes et réalisant un chiffre d’affaires mondial supérieur à 450 millions d’euros.
(1) Selon une enquête de Mediapart publiée en décembre 2023, « Face à LVMH, le fisc coincé dans ses contradictions » de Florence Loève, le fisc français a renoncé, fin décembre 2023, à poursuivre LVMH malgré des soupçons de fraude fiscale concernant une filiale, la centrale de trésorerie du groupe, domiciliée en Belgique.